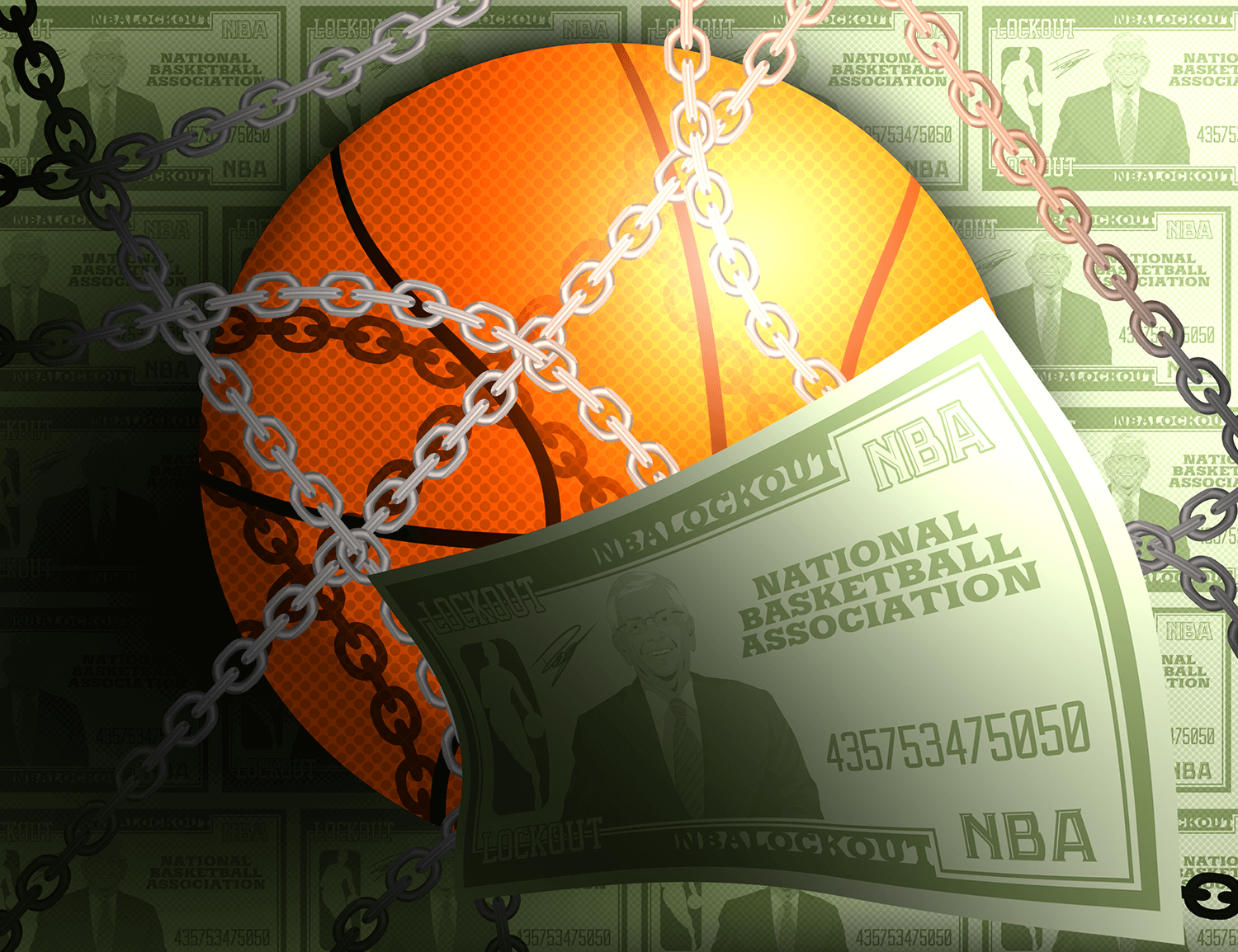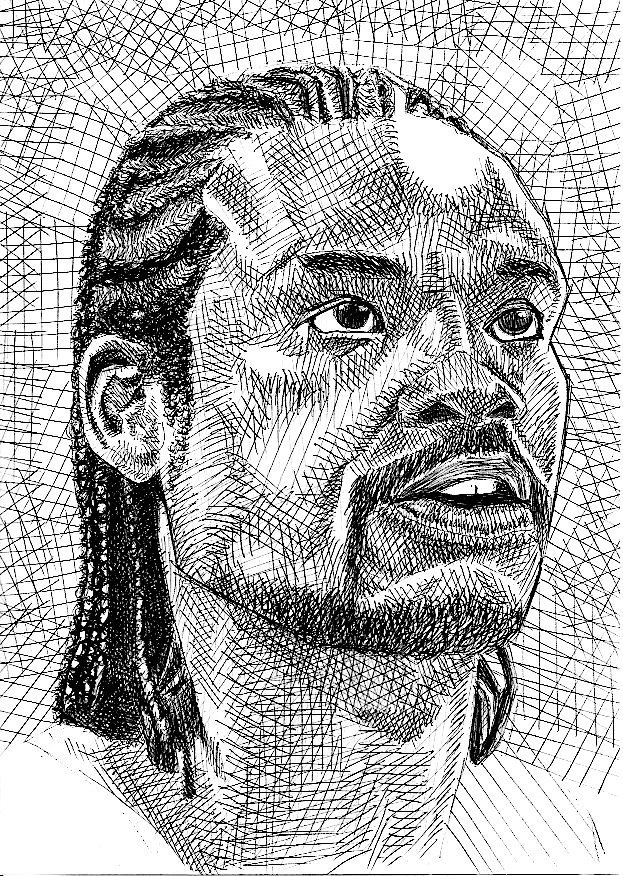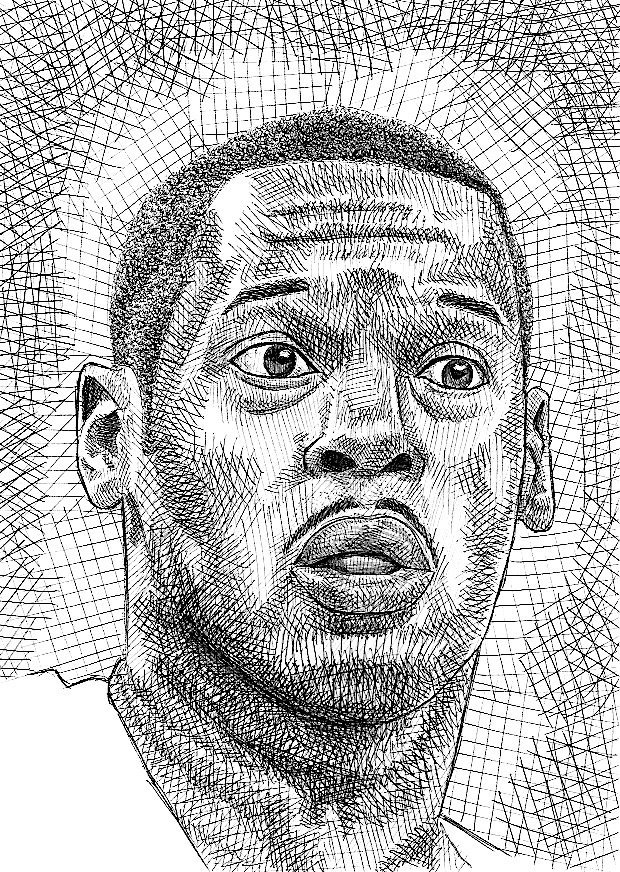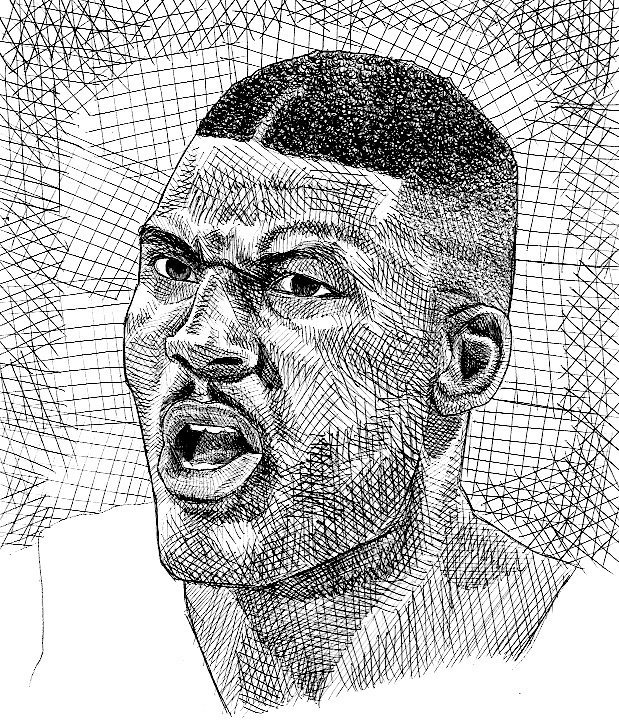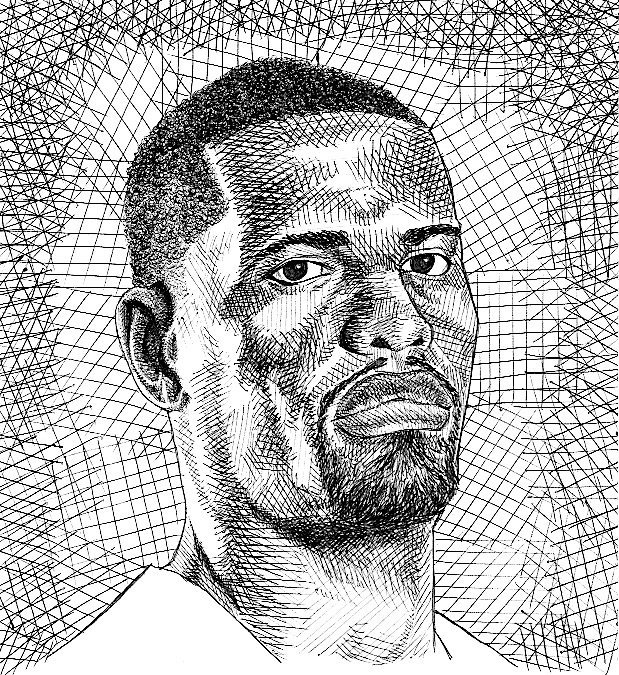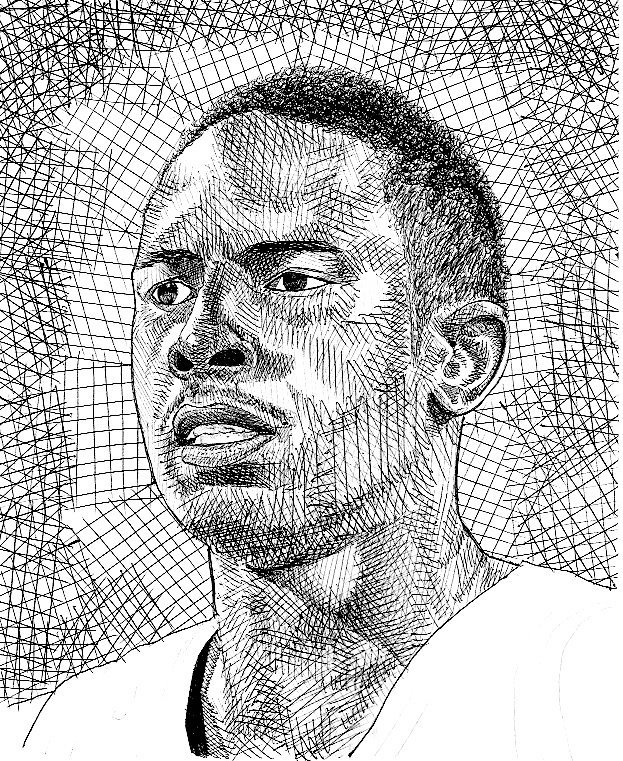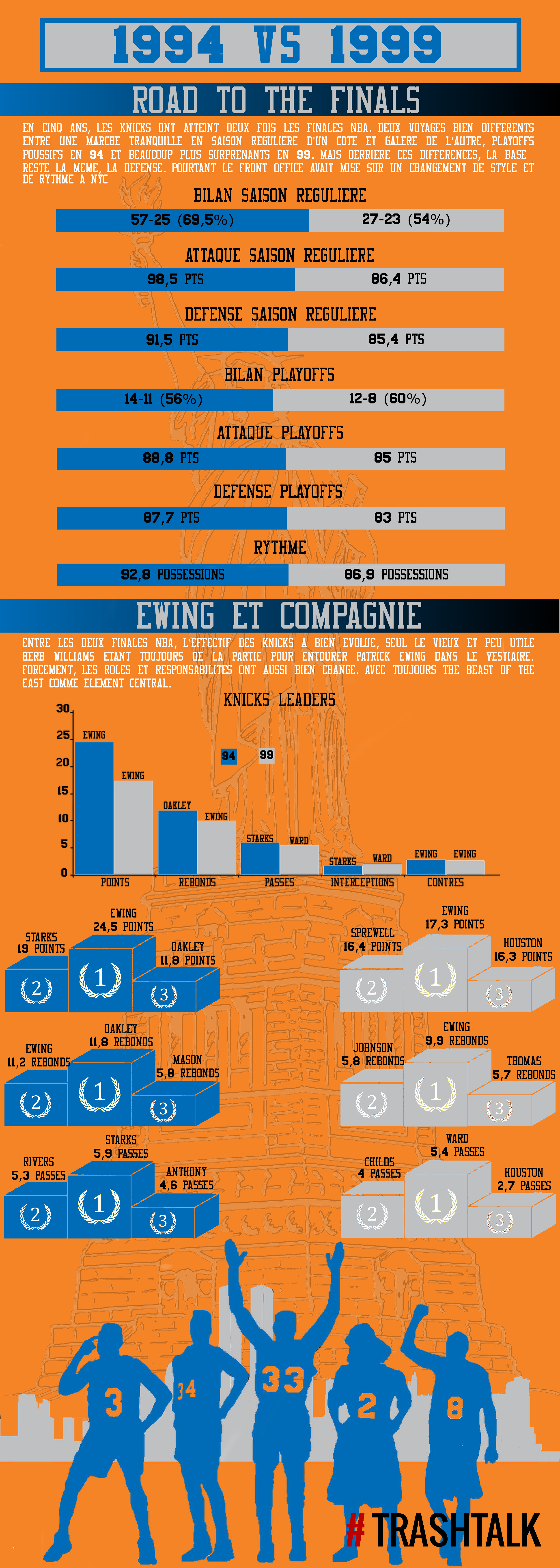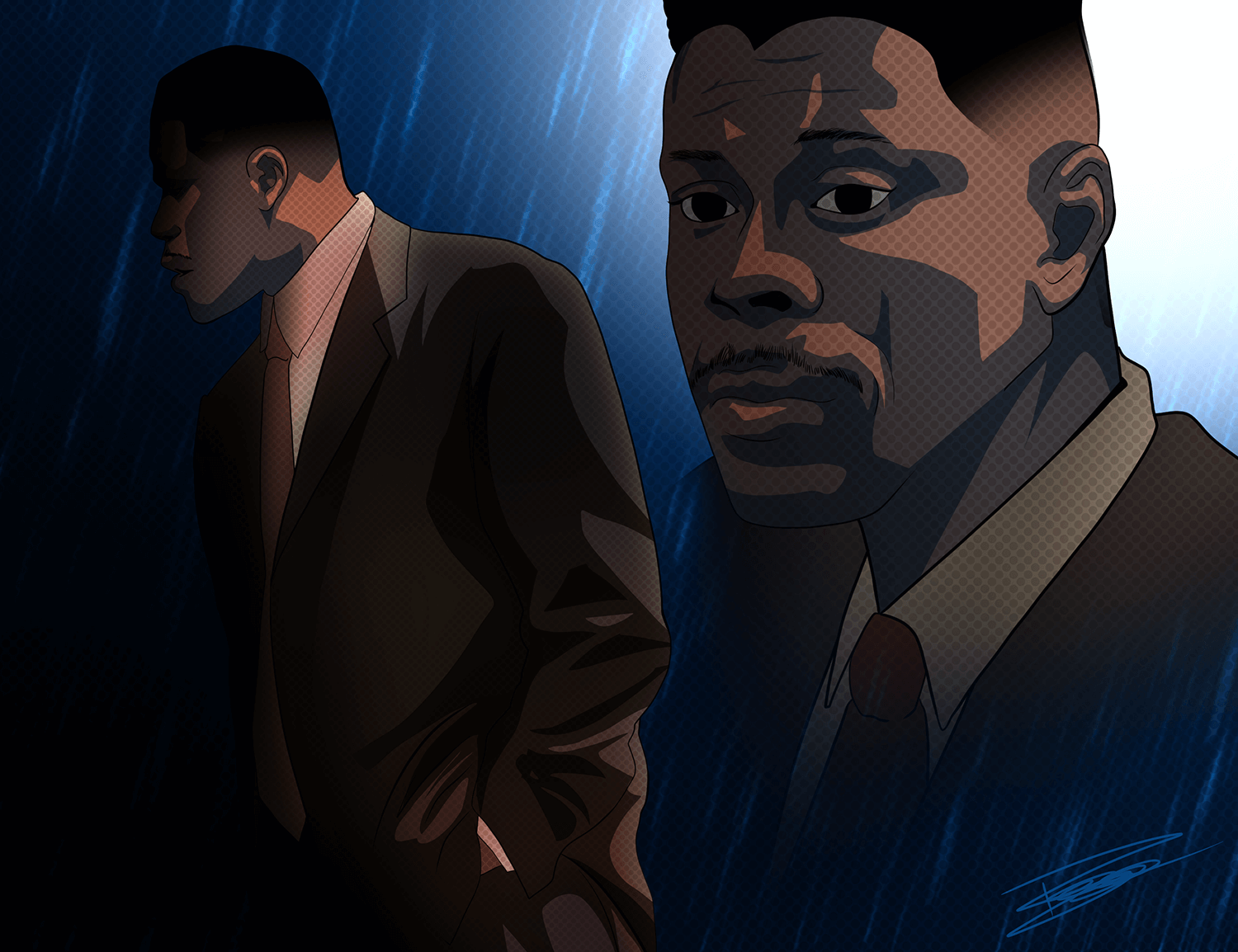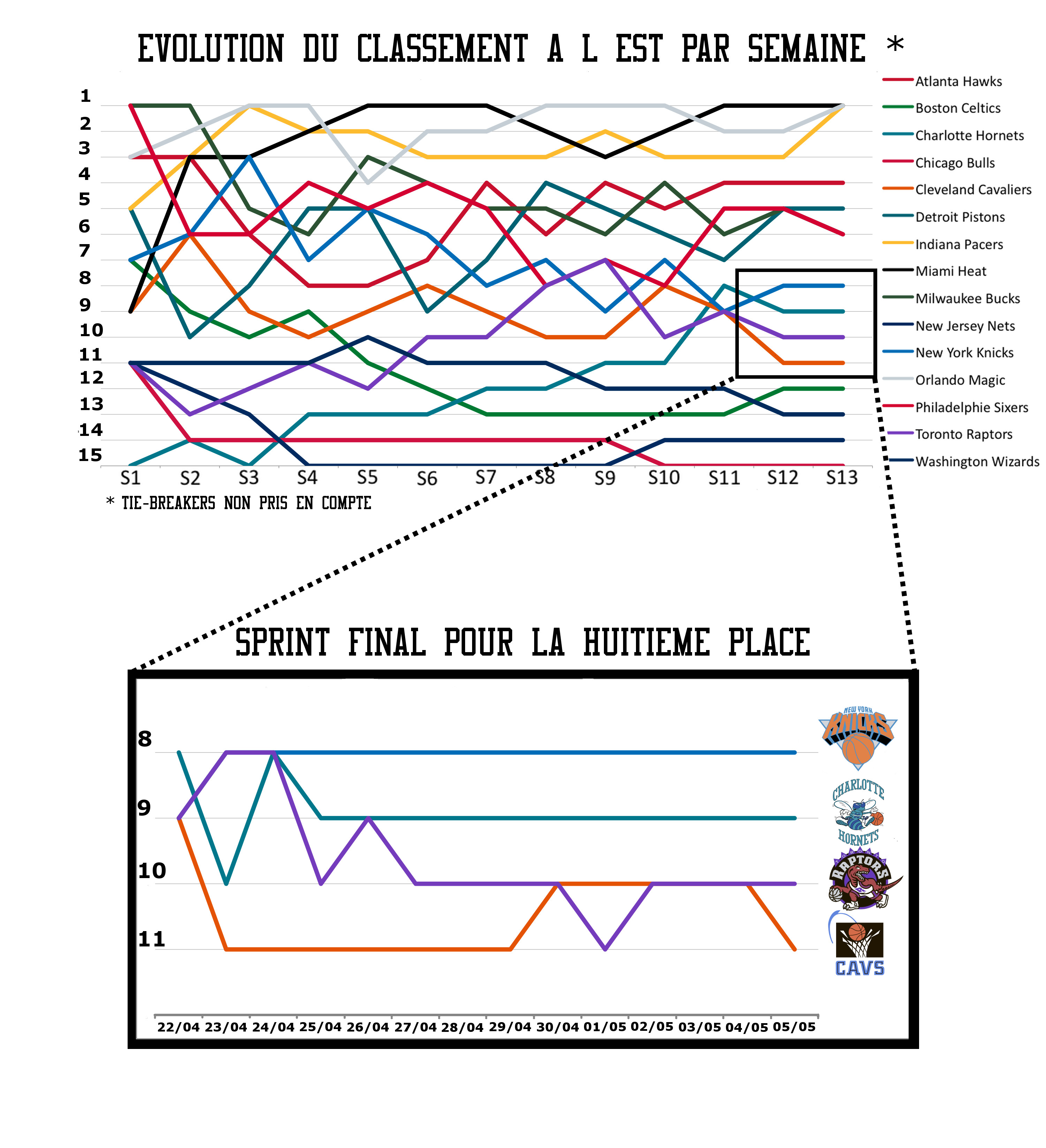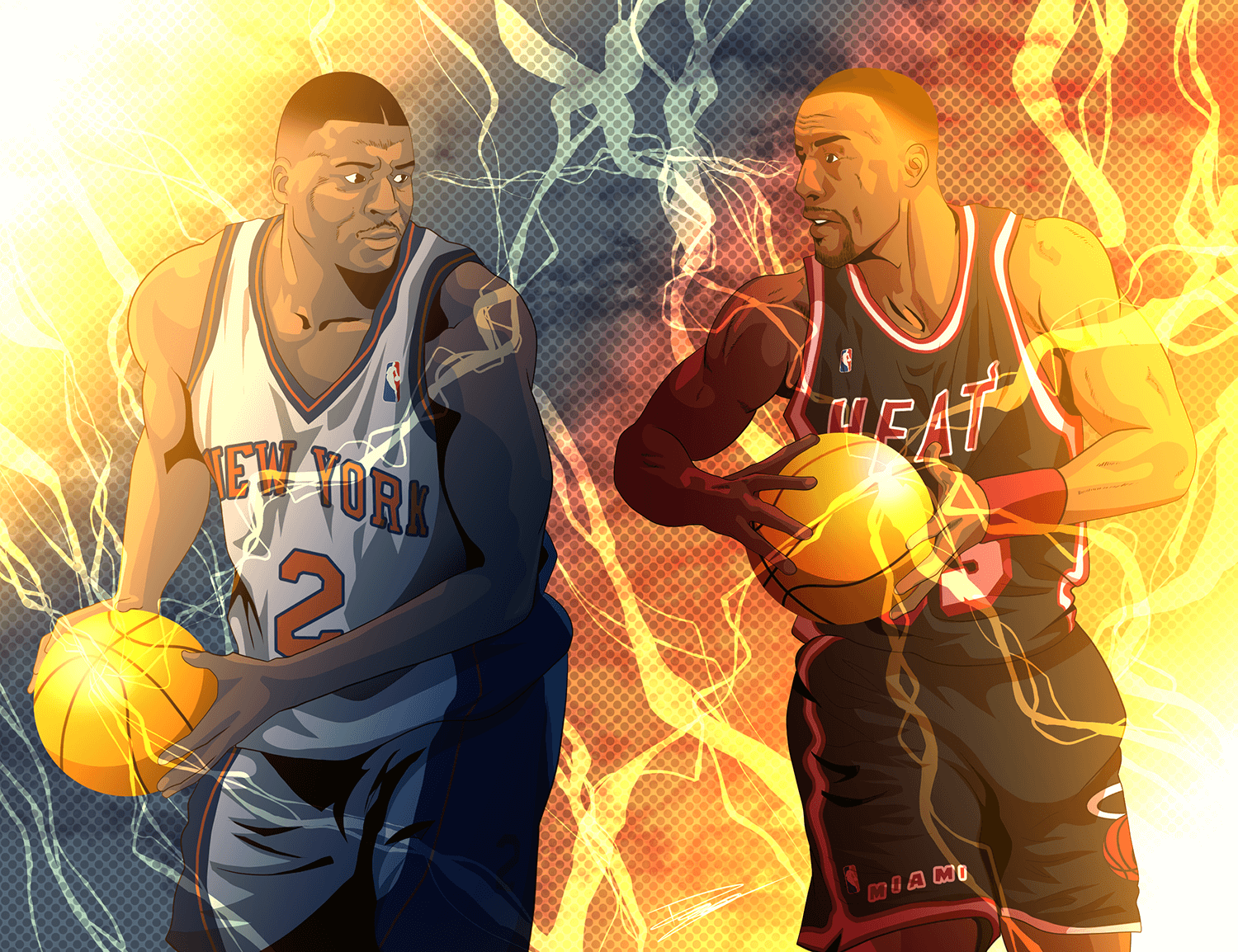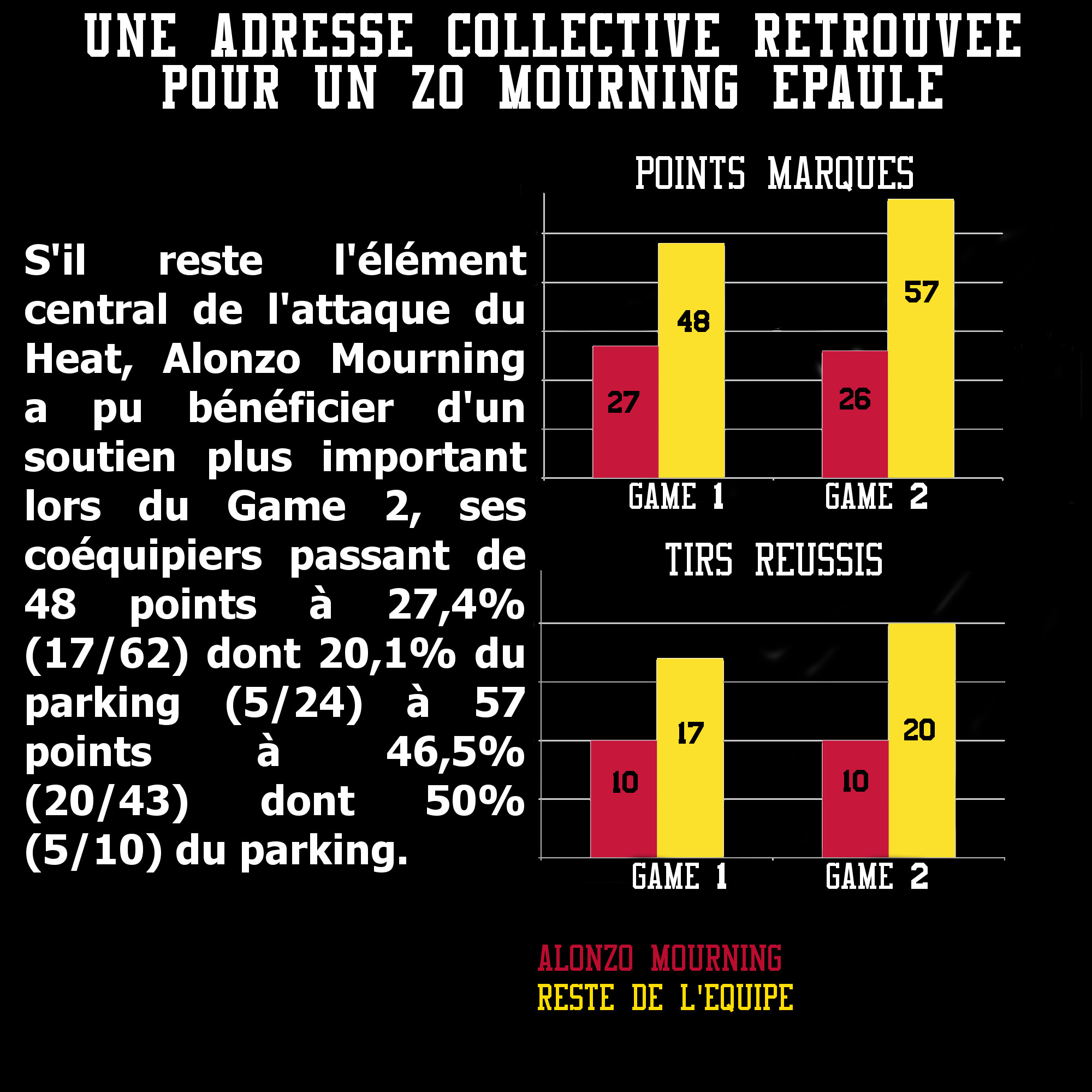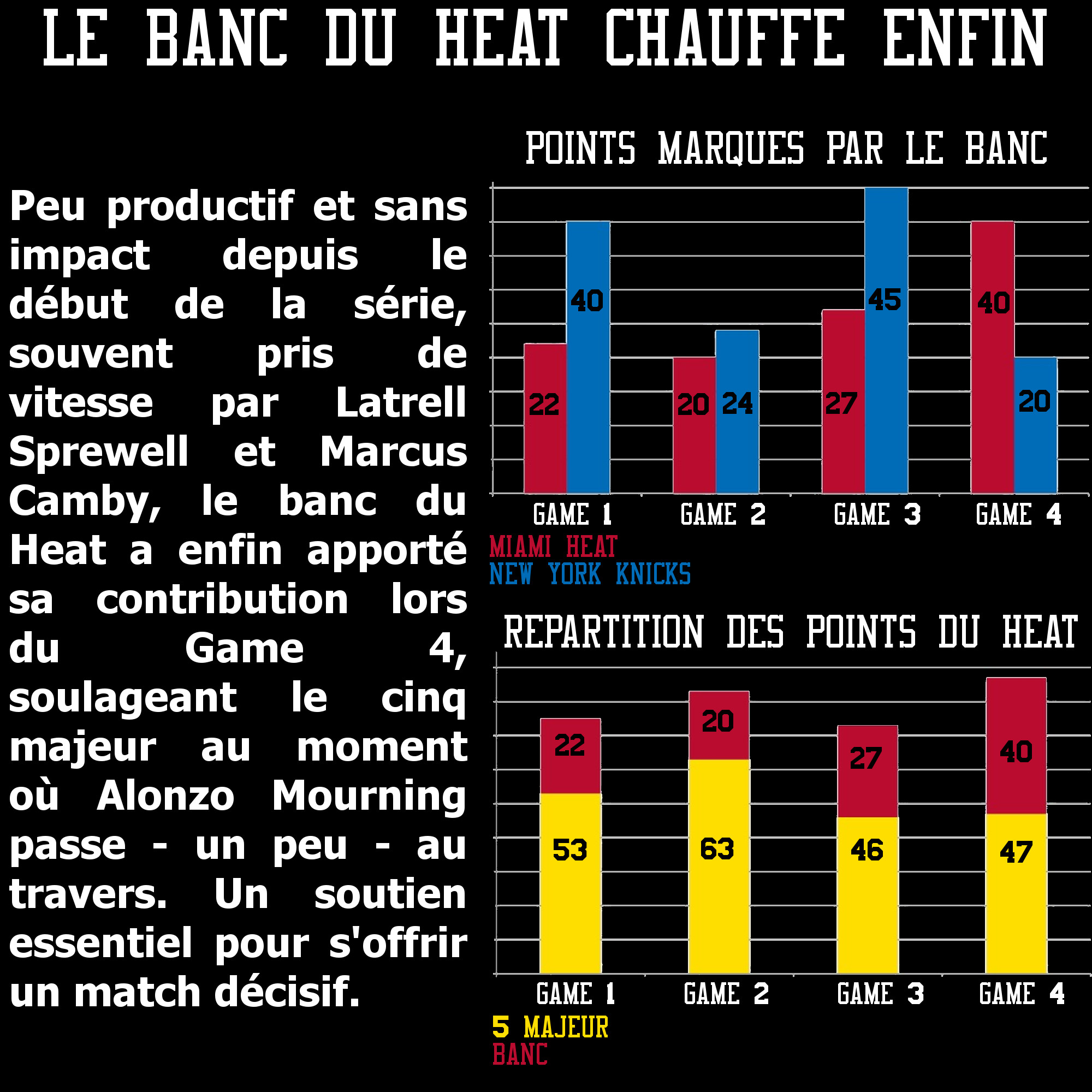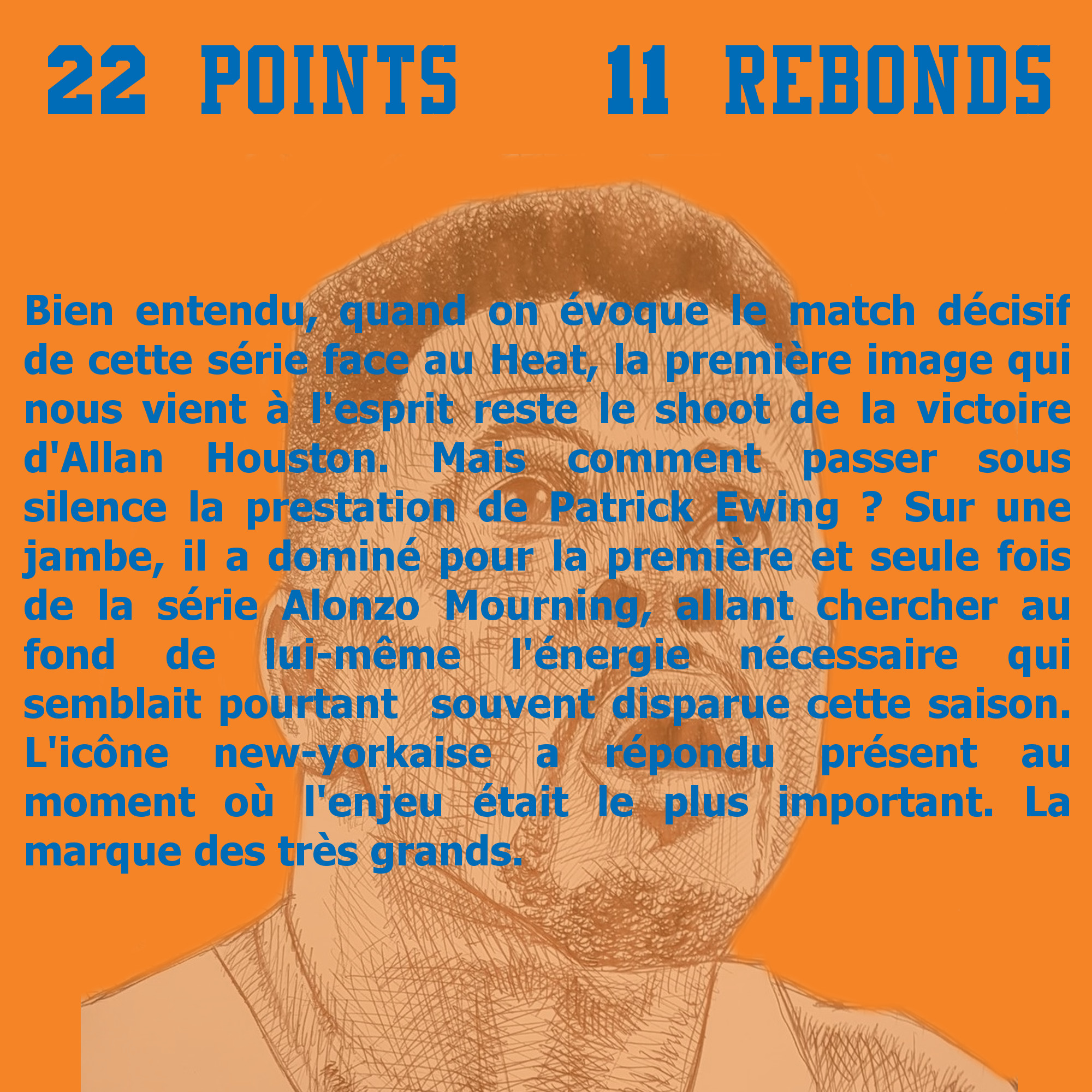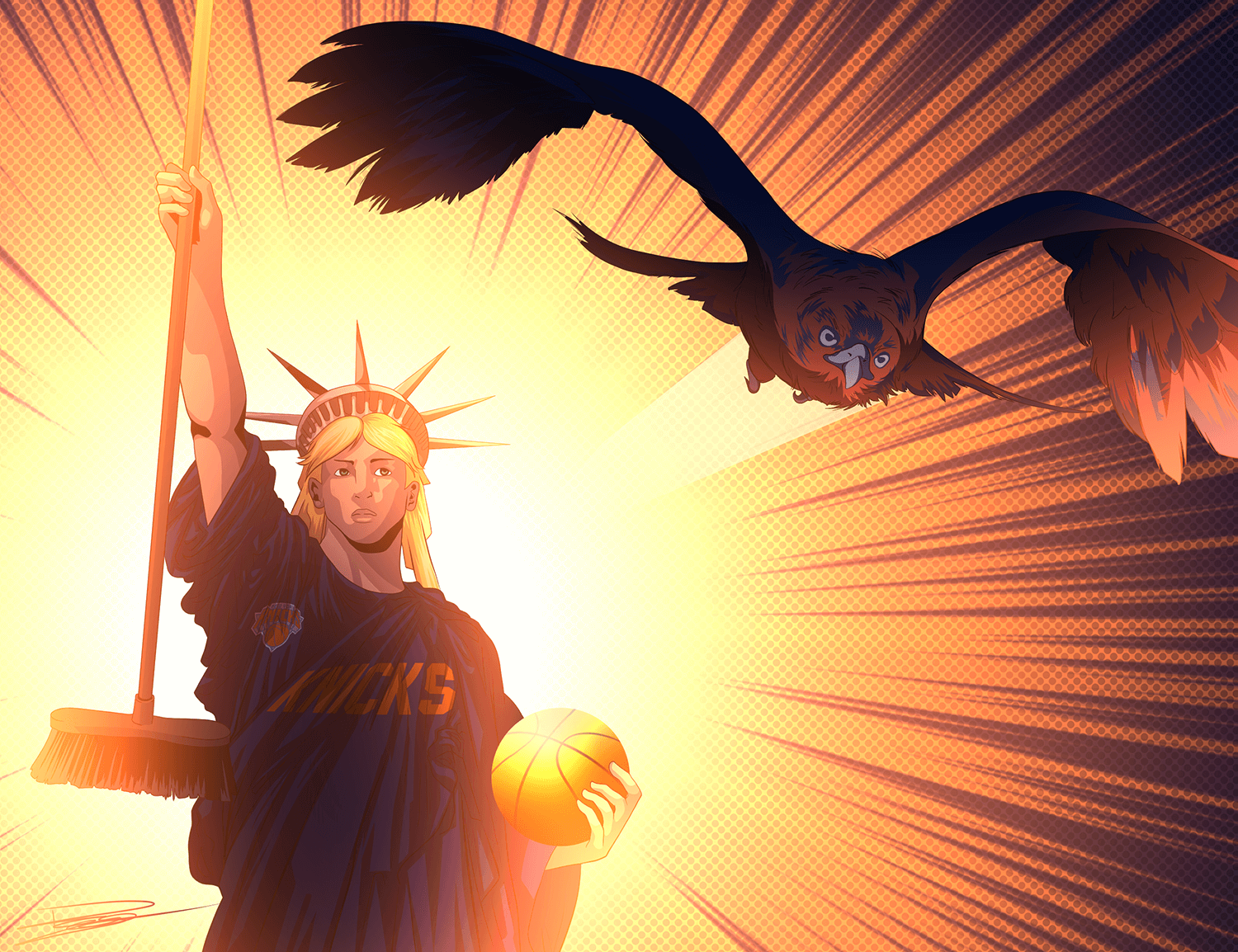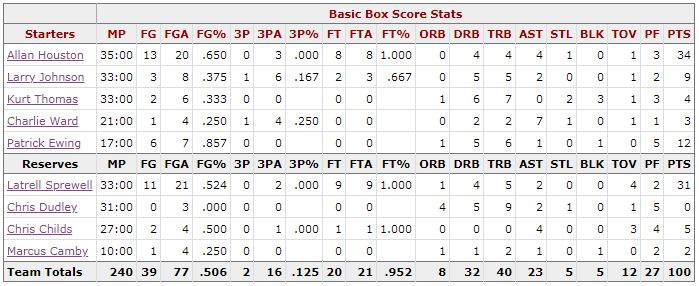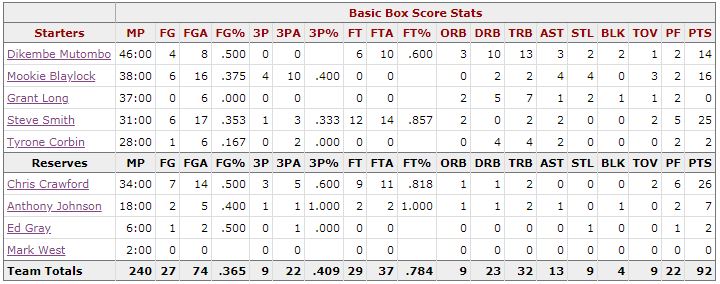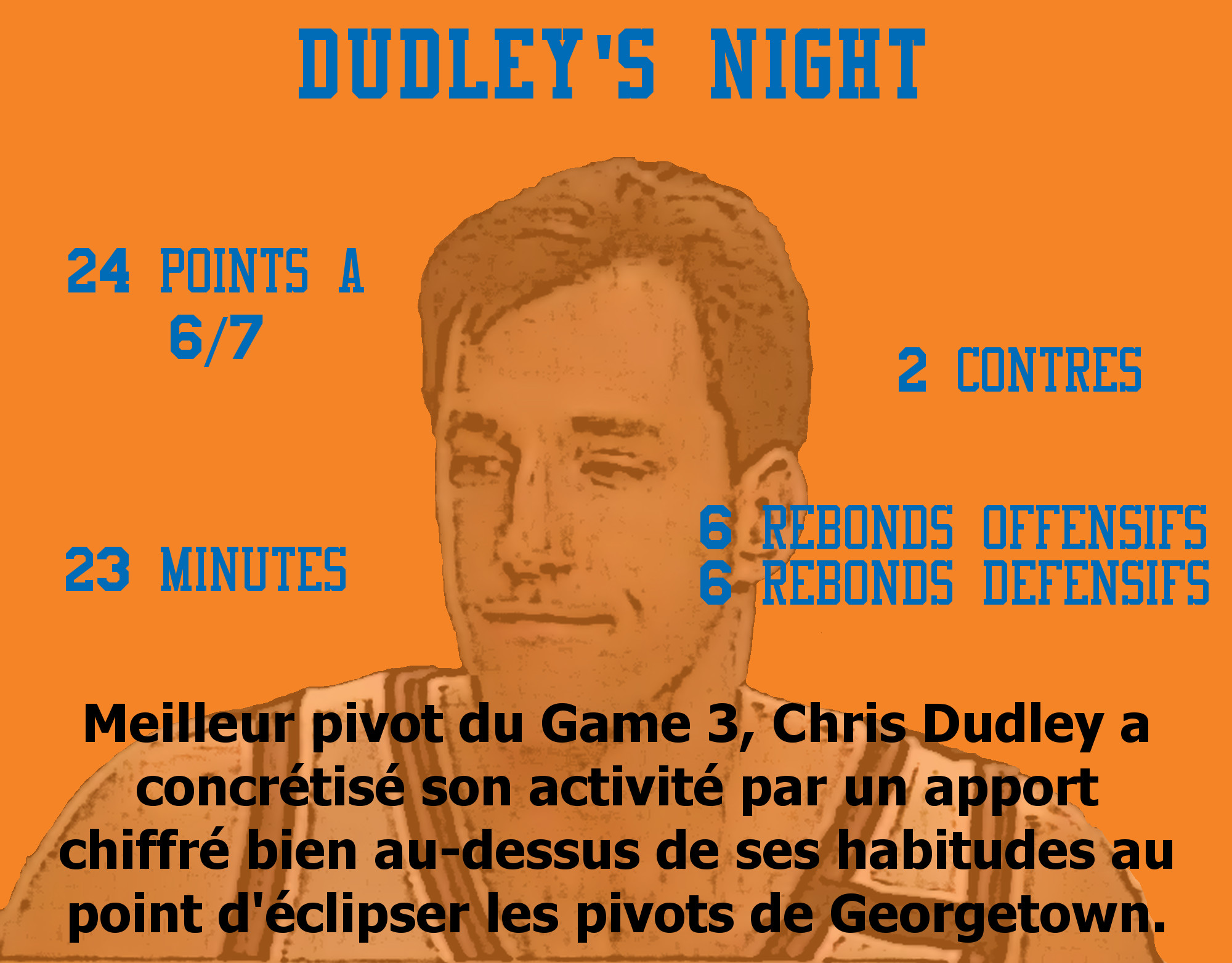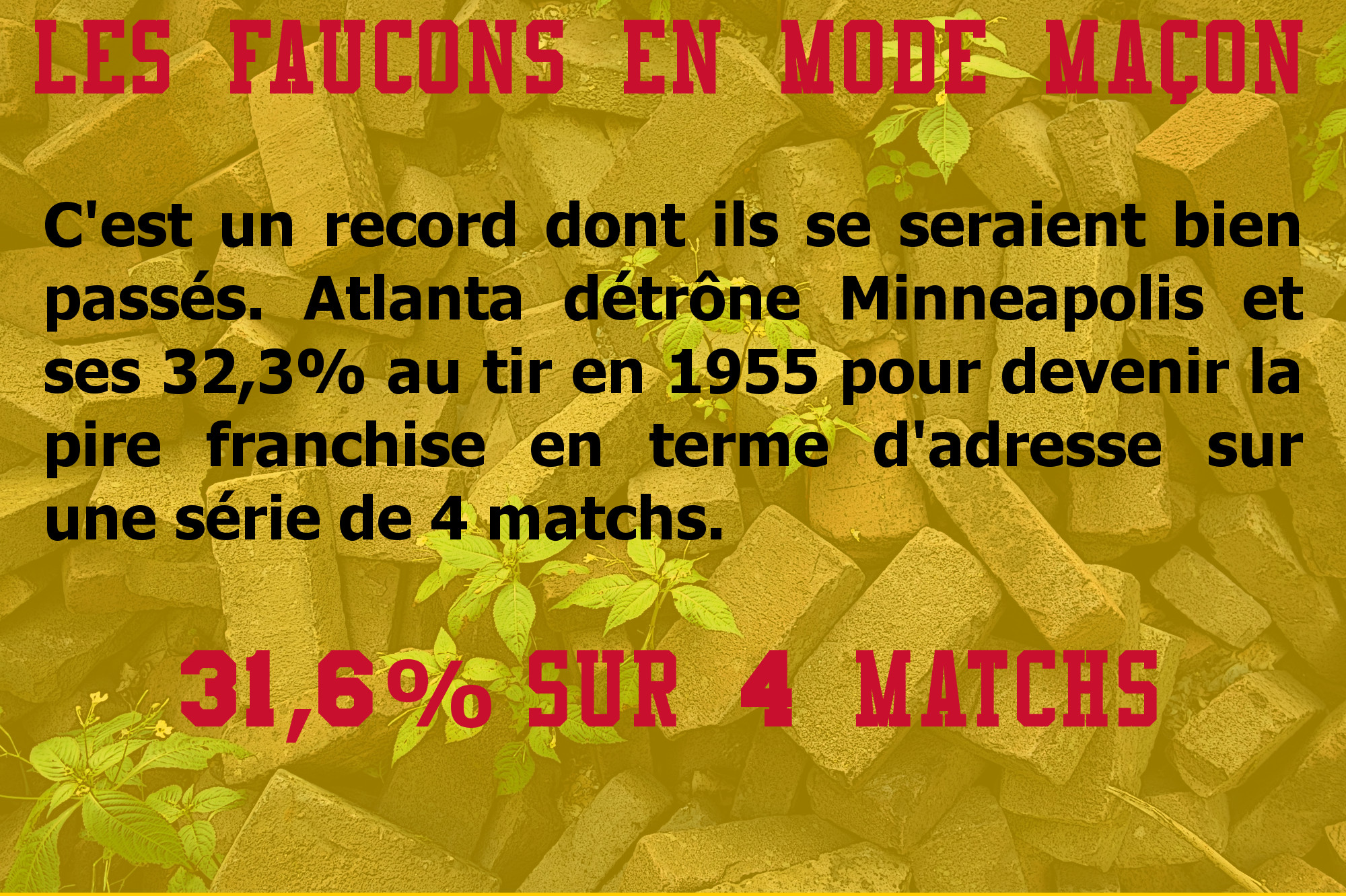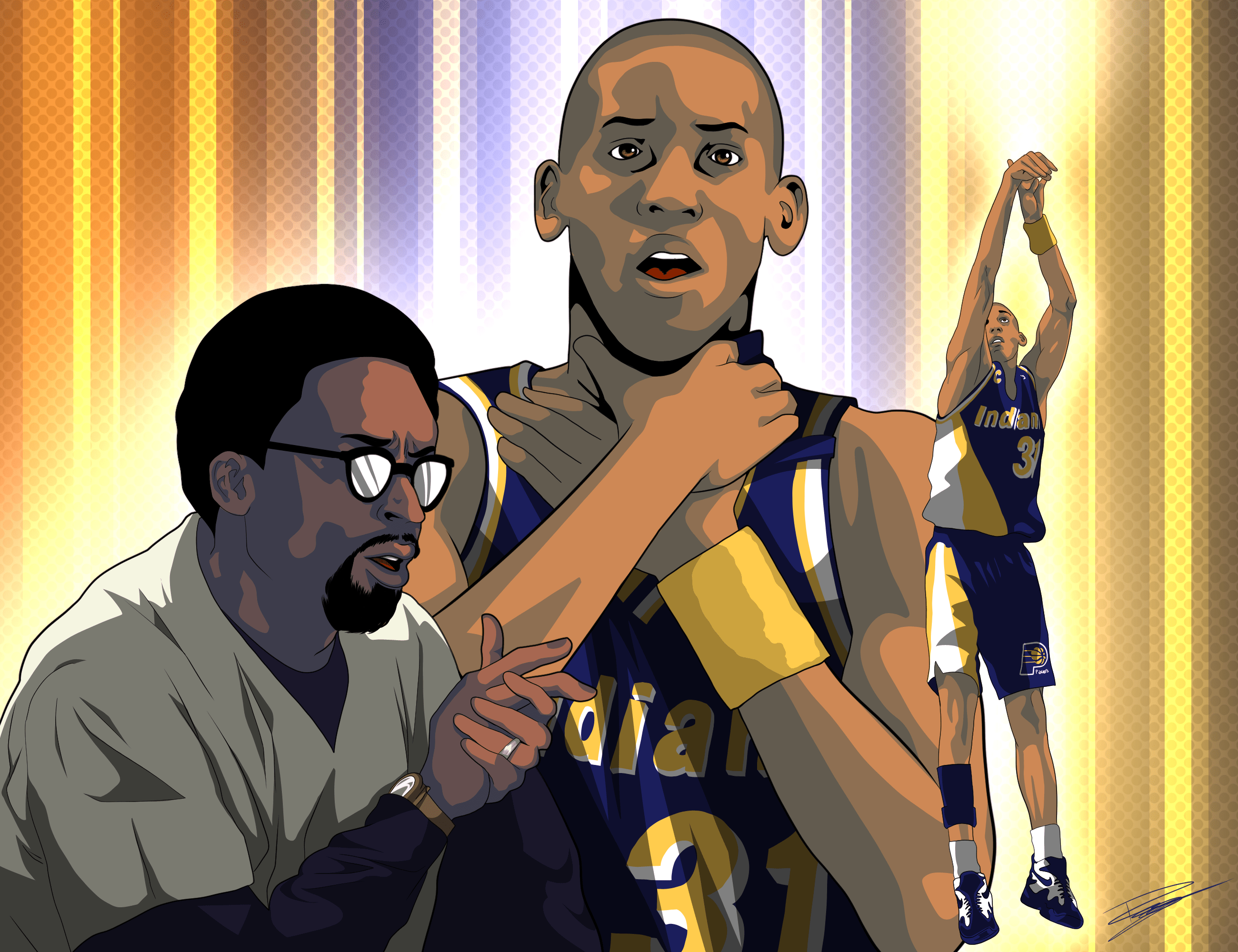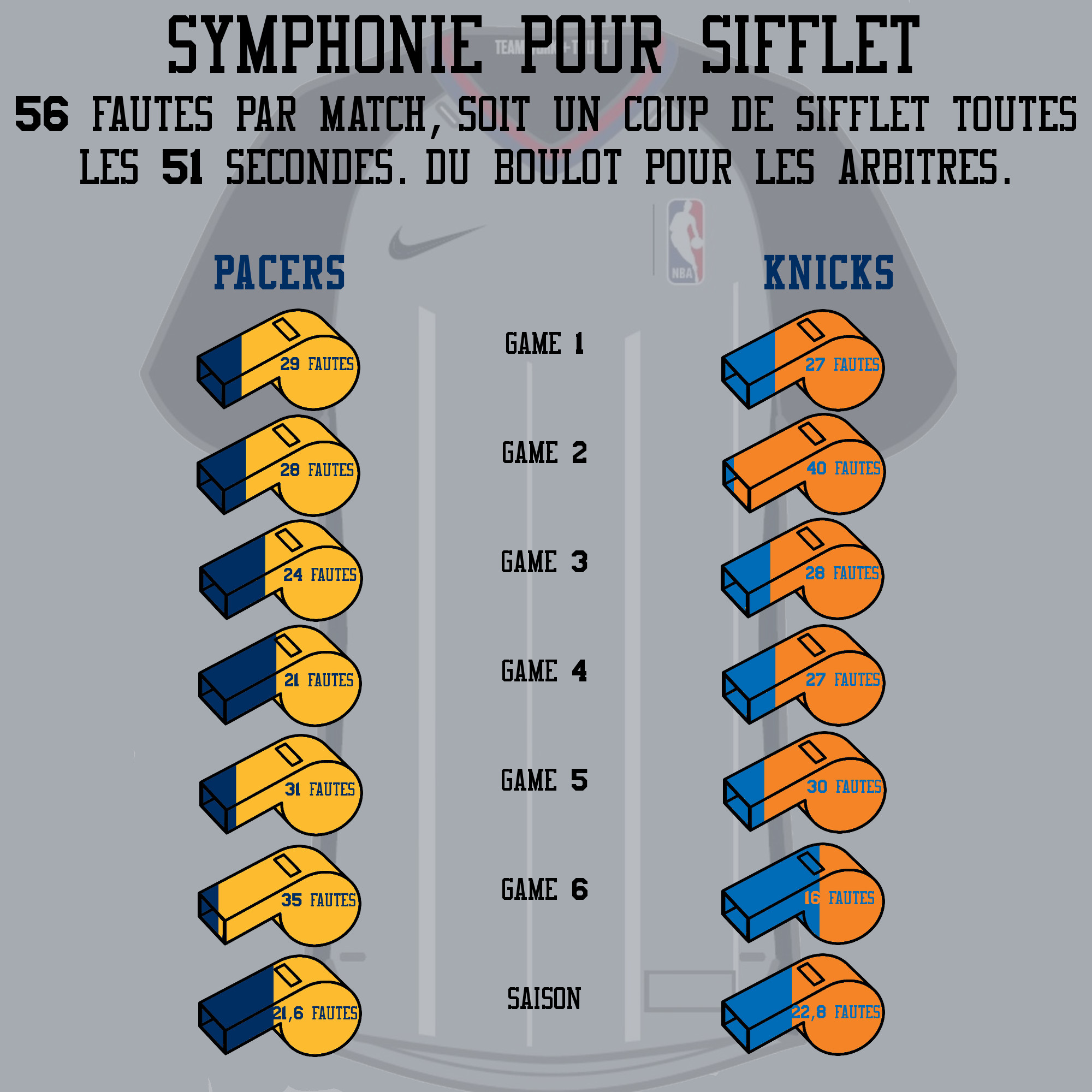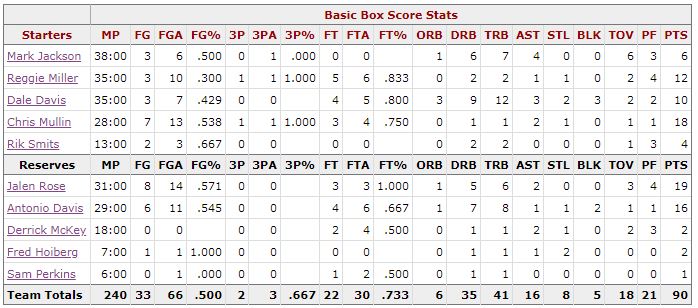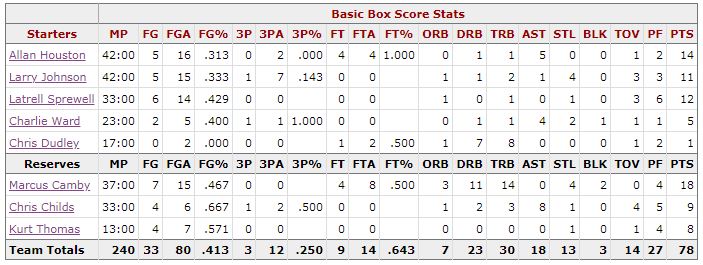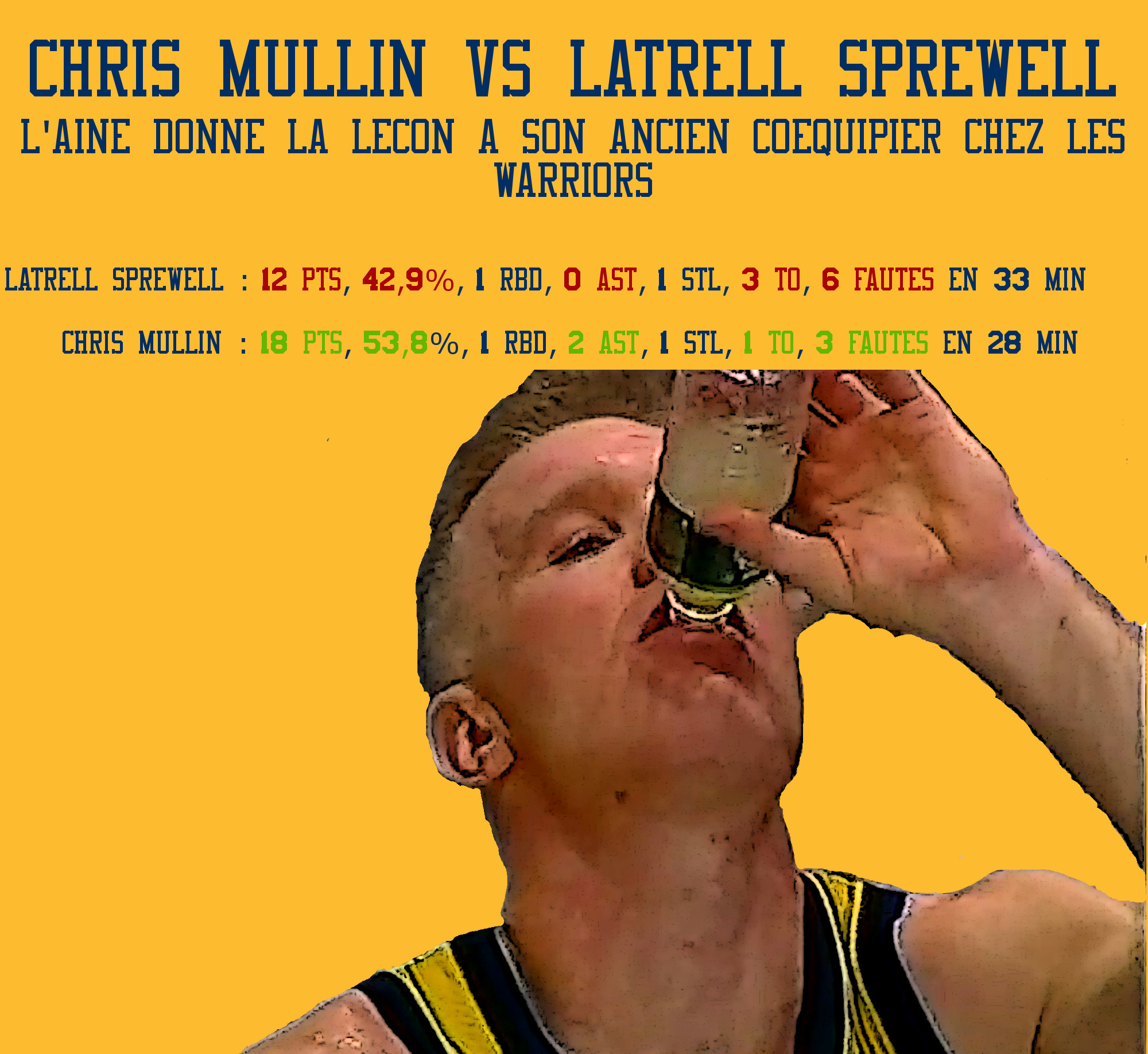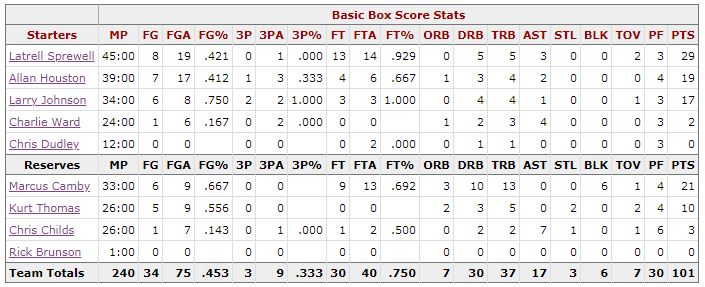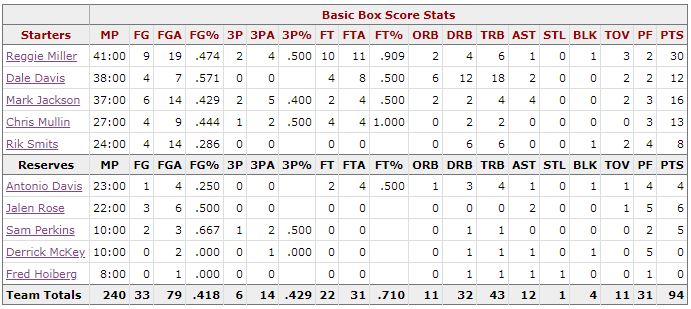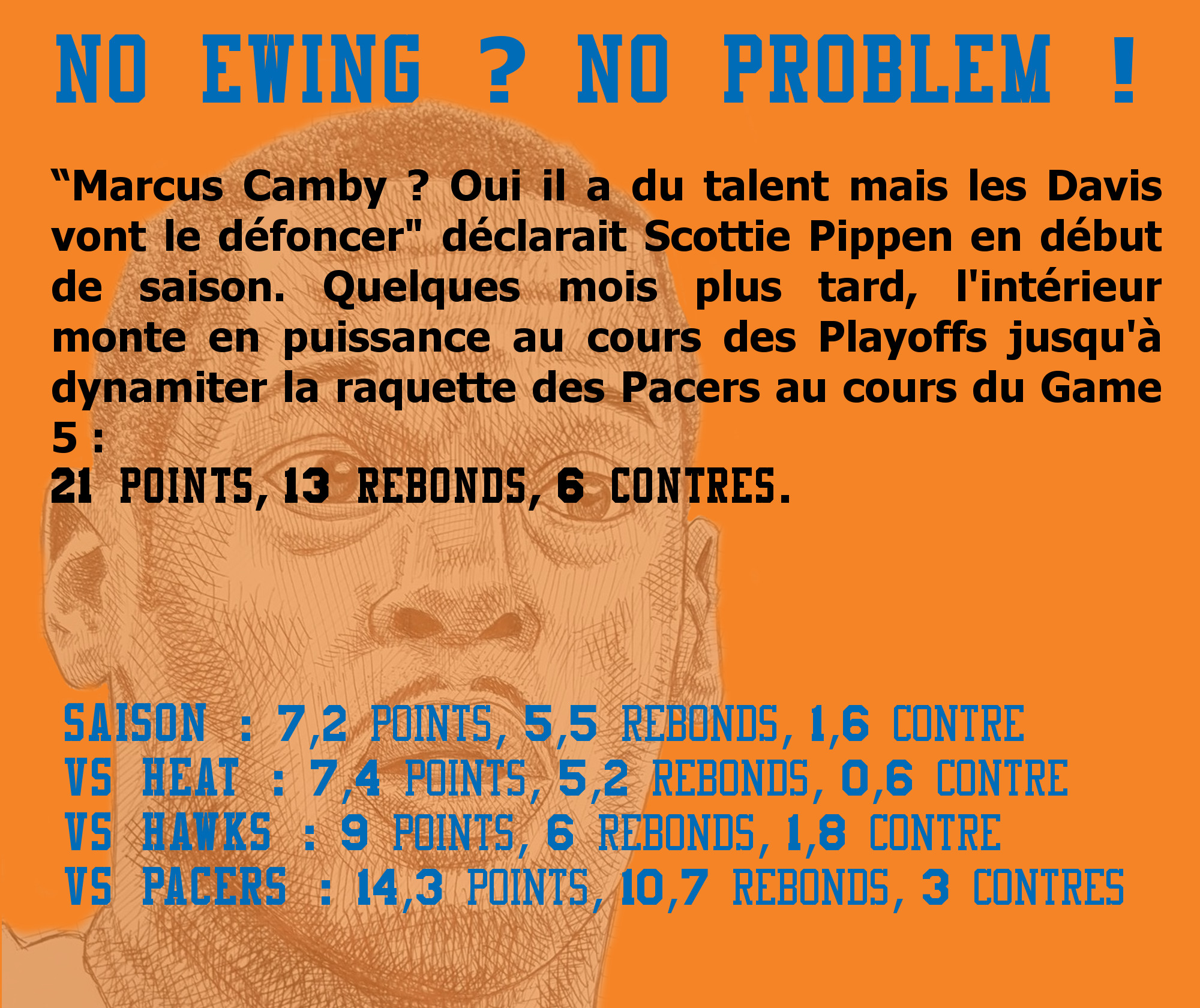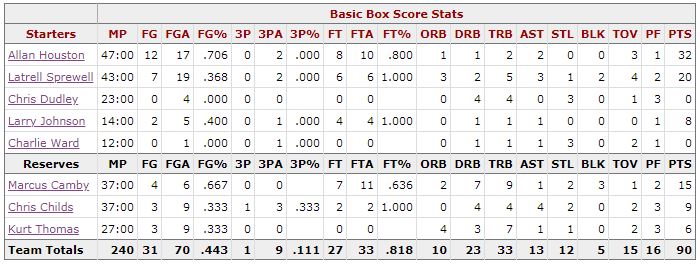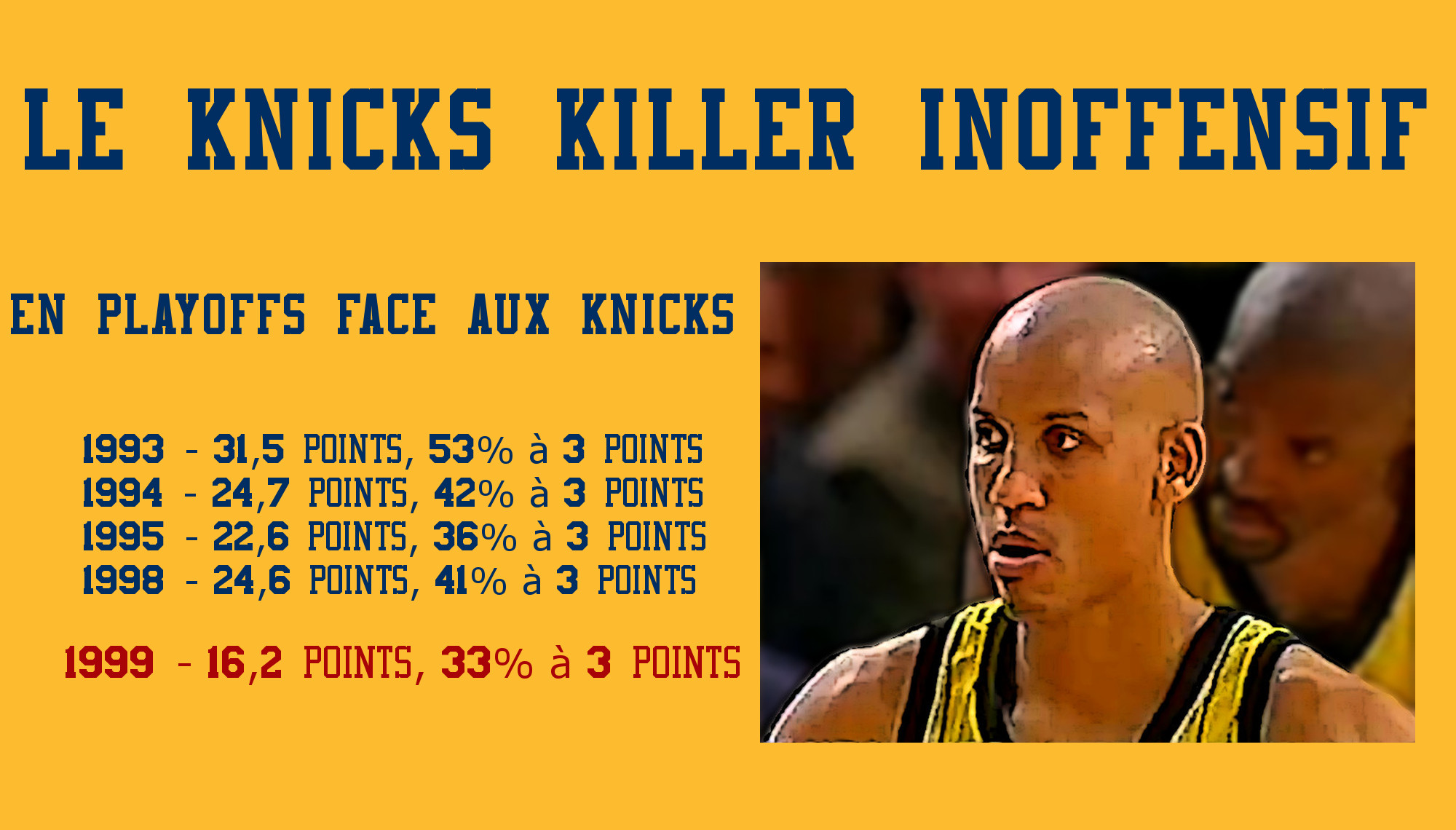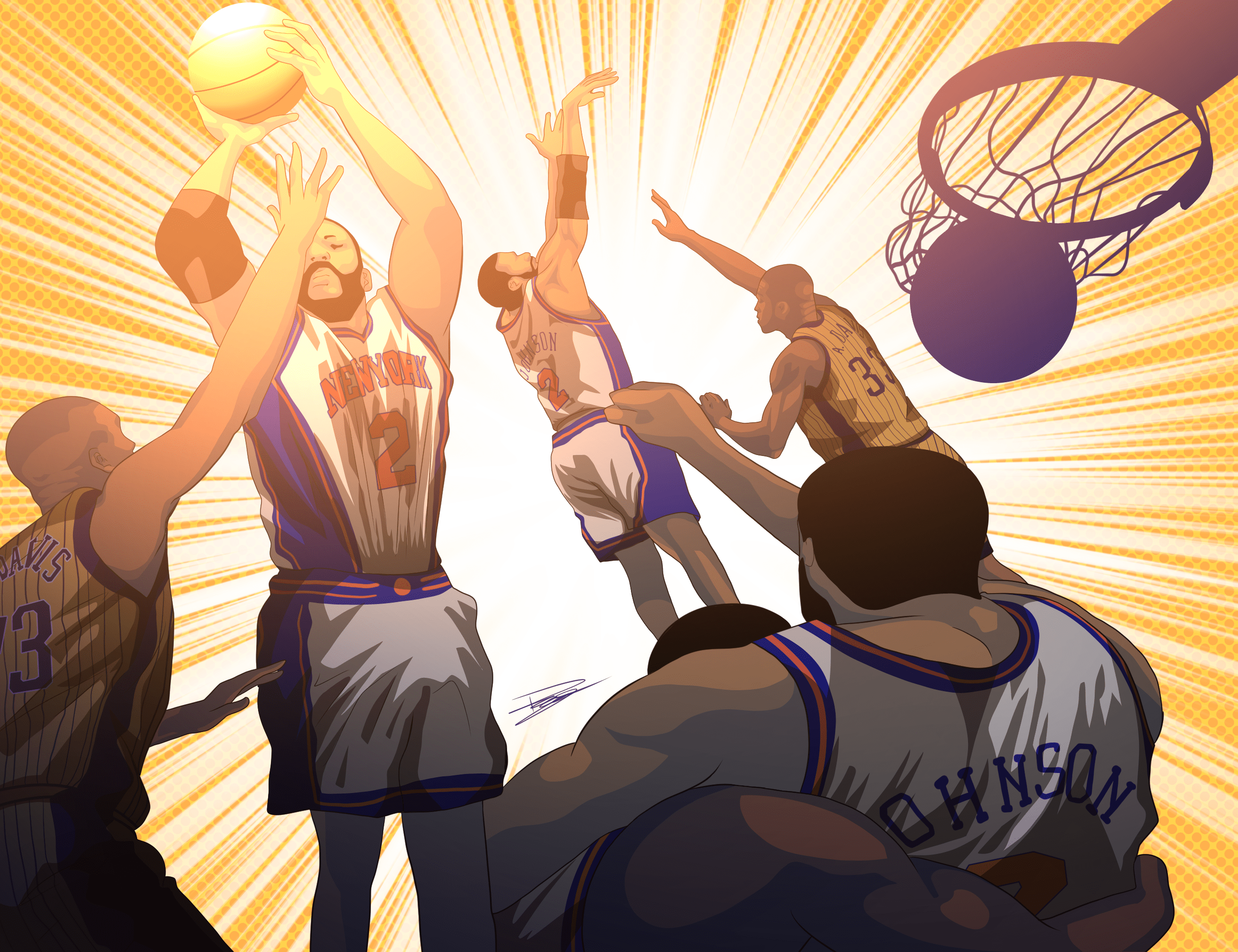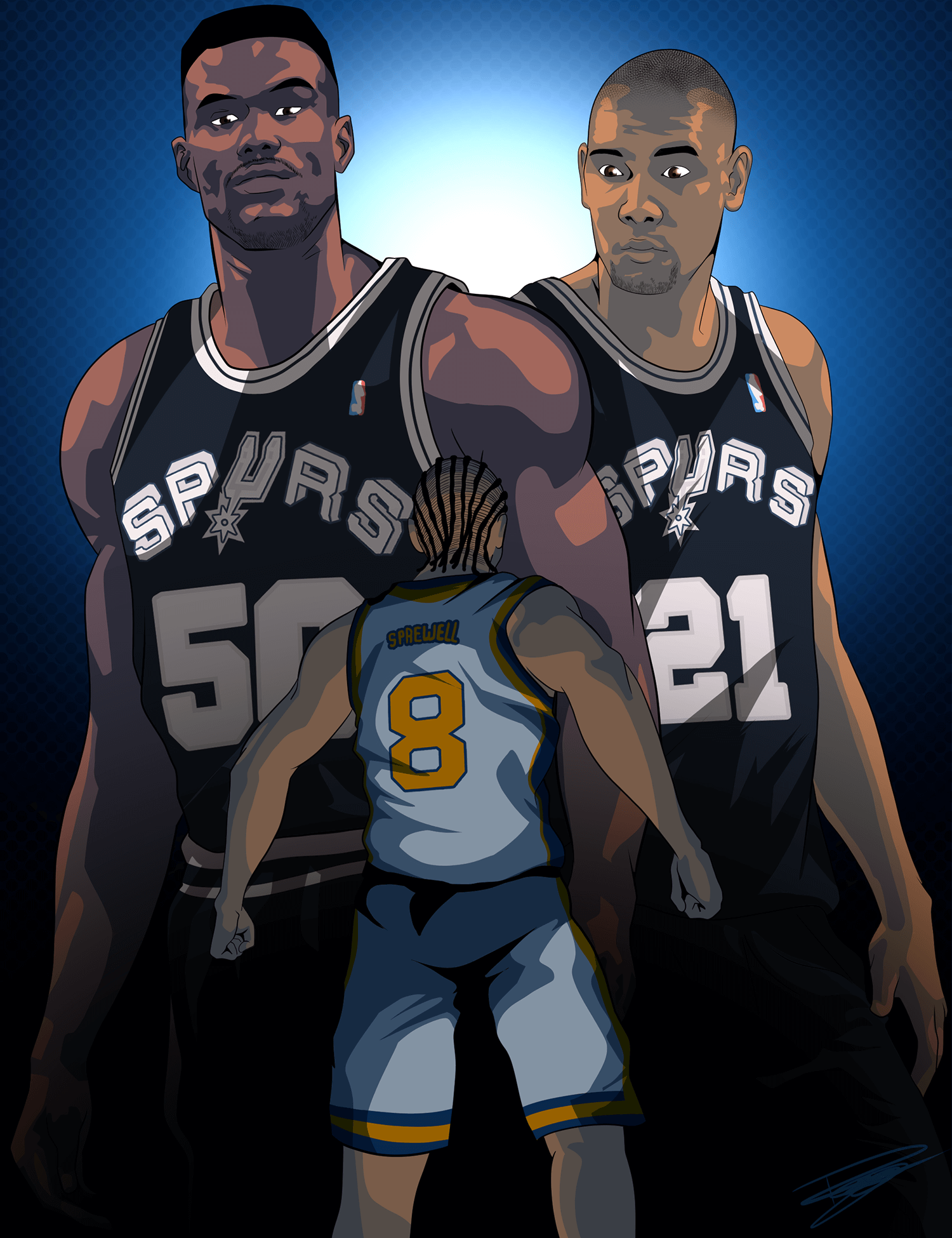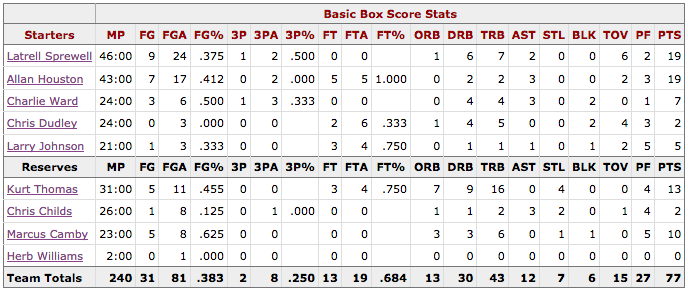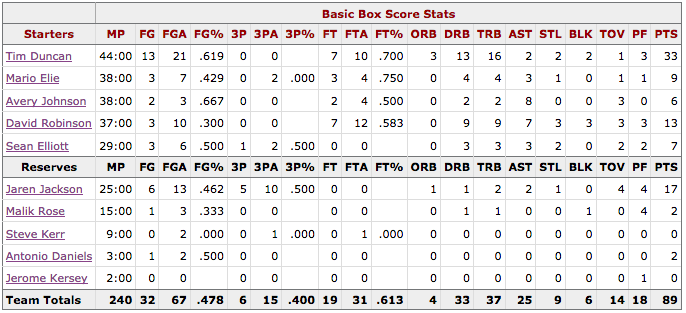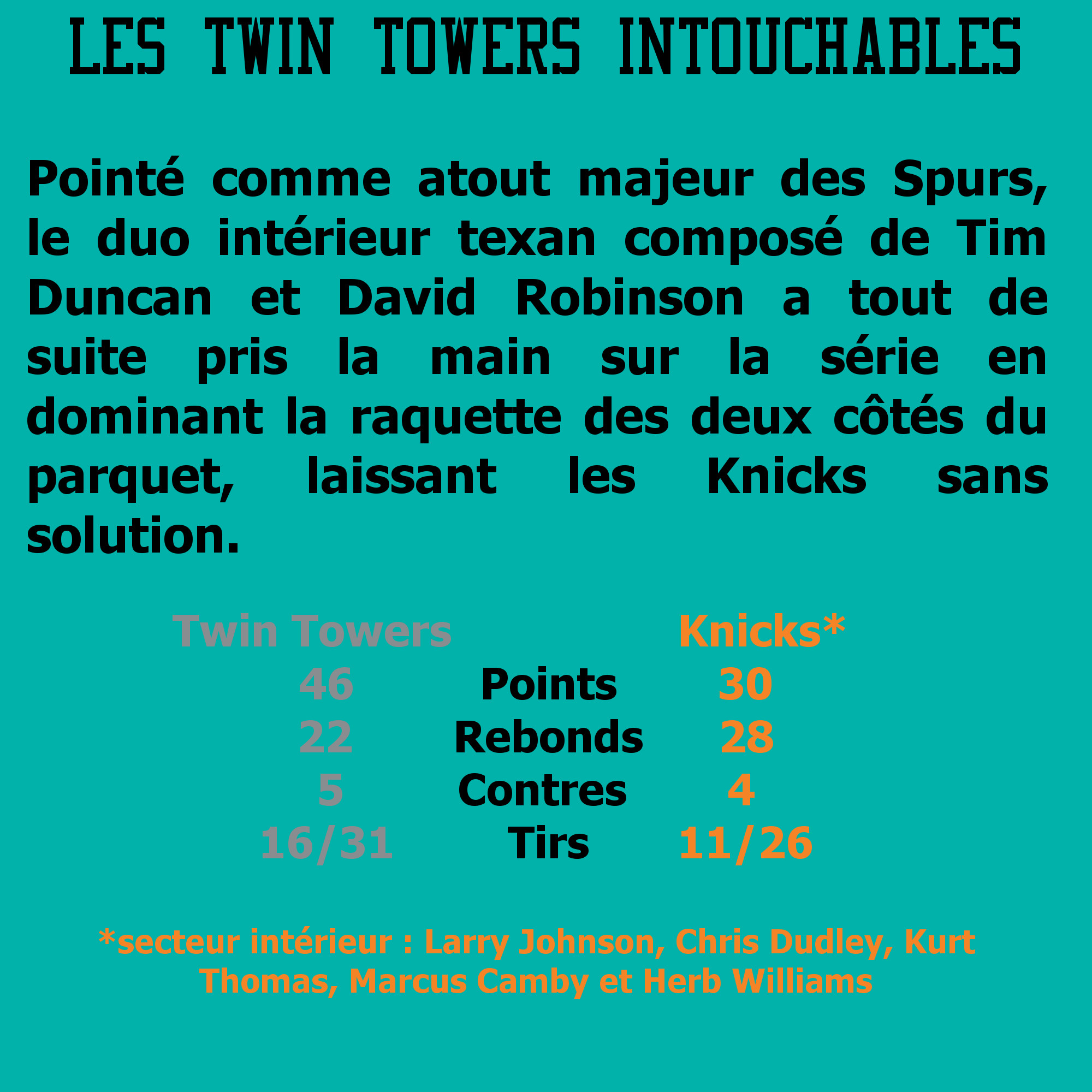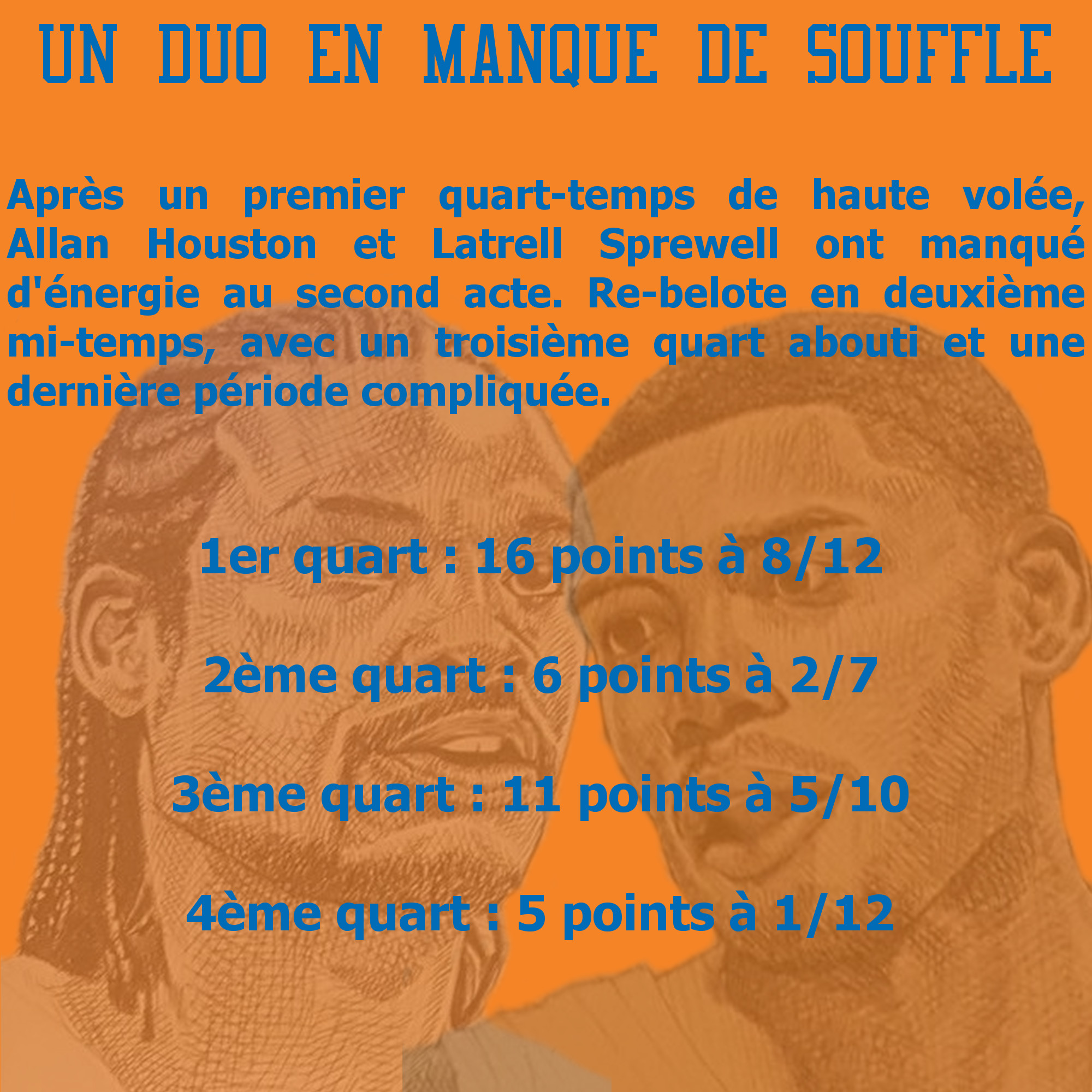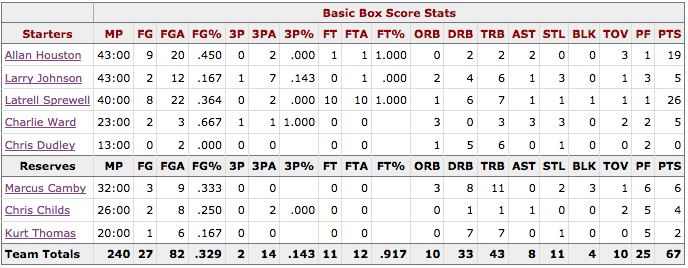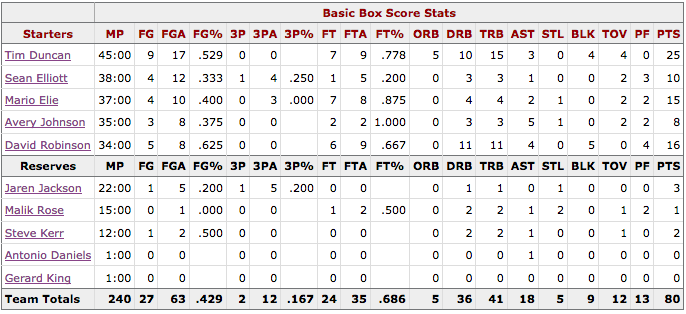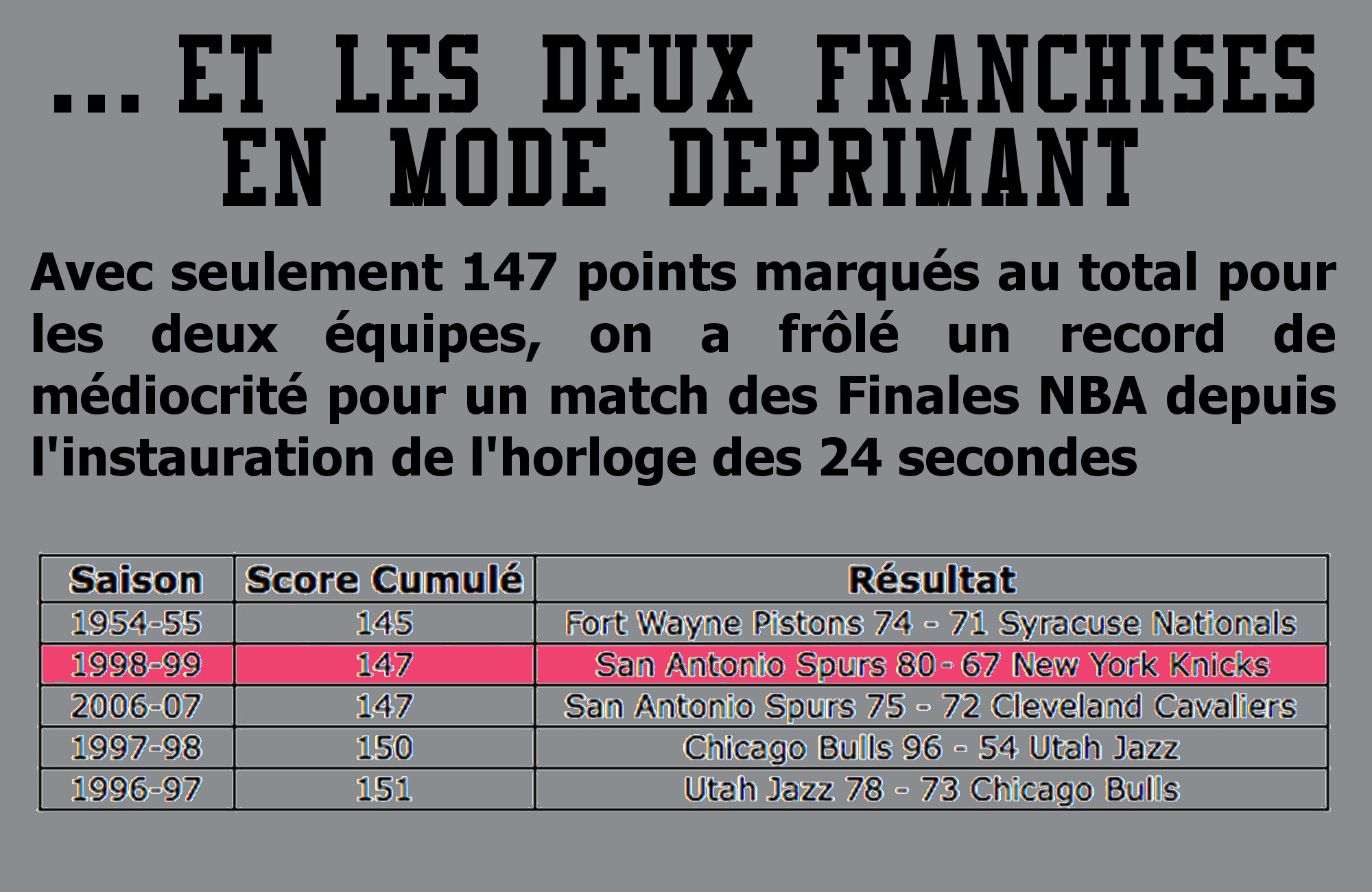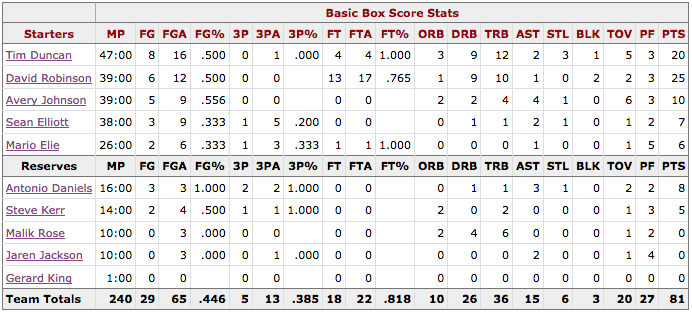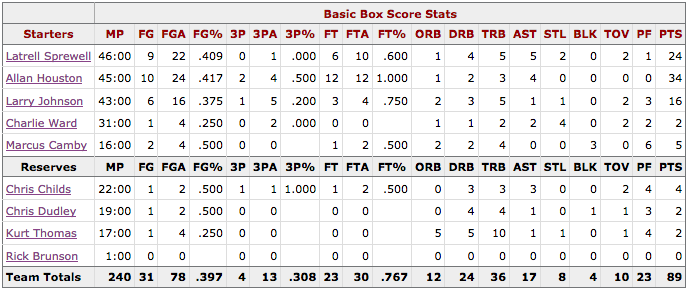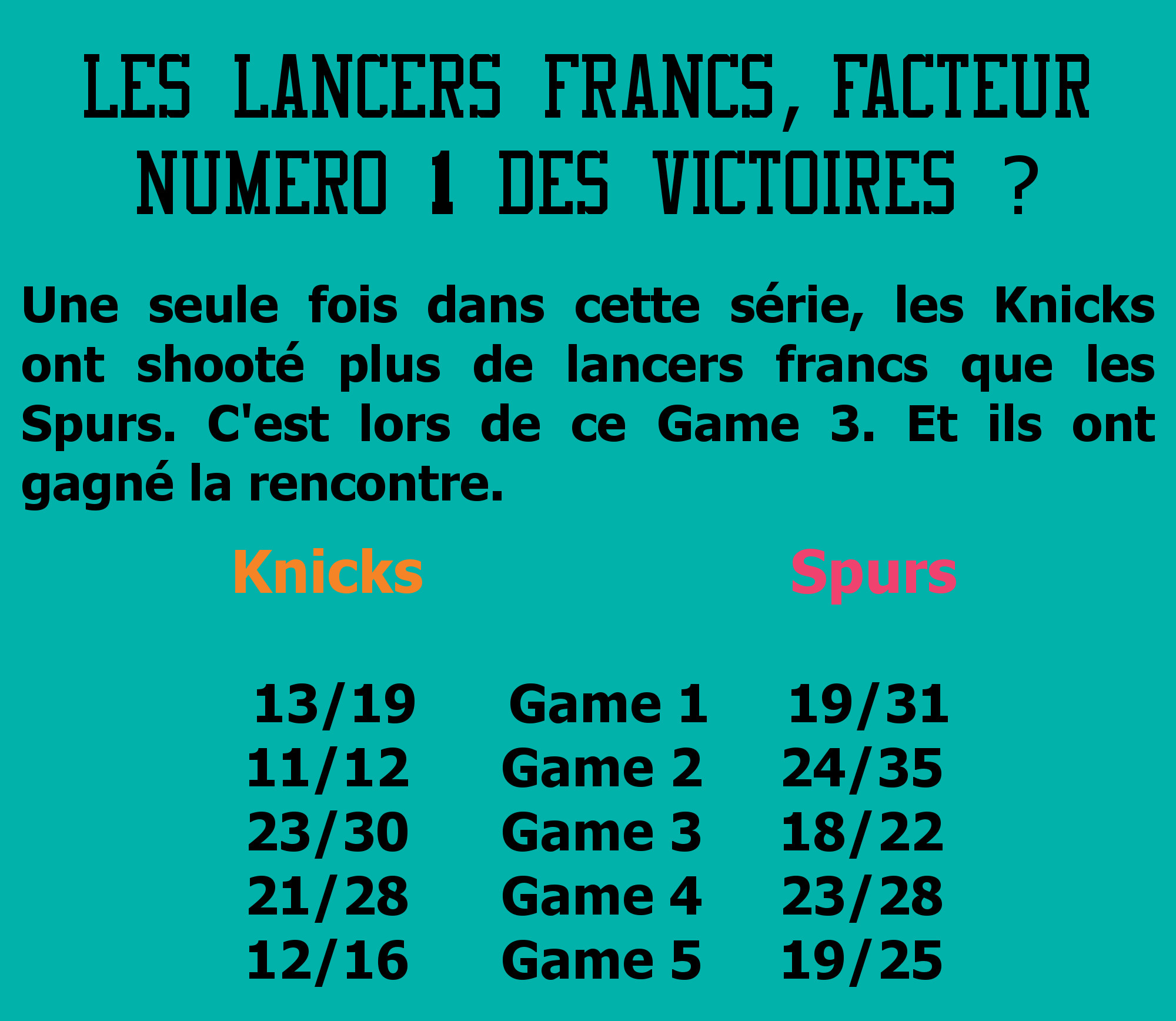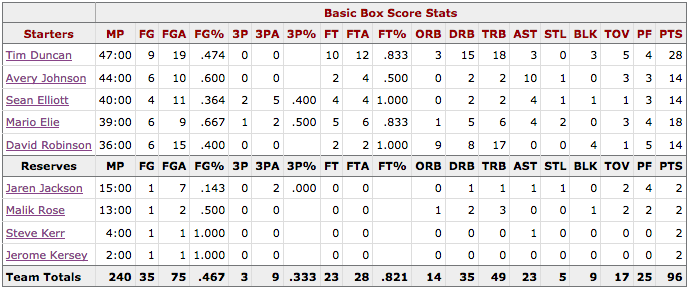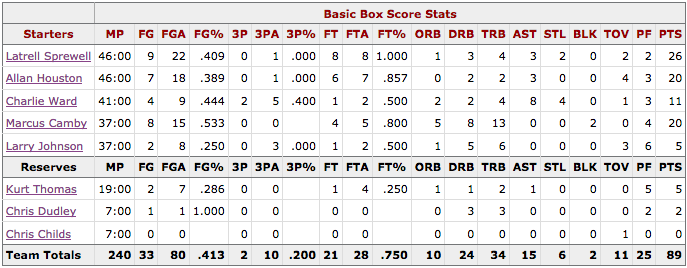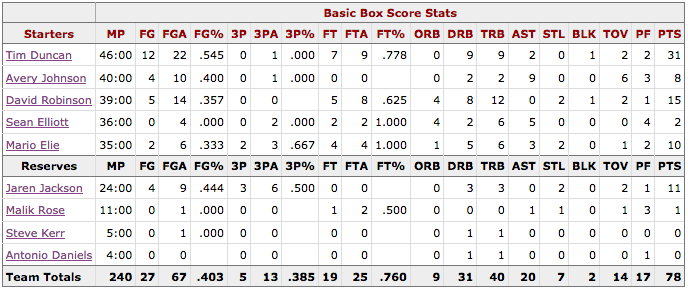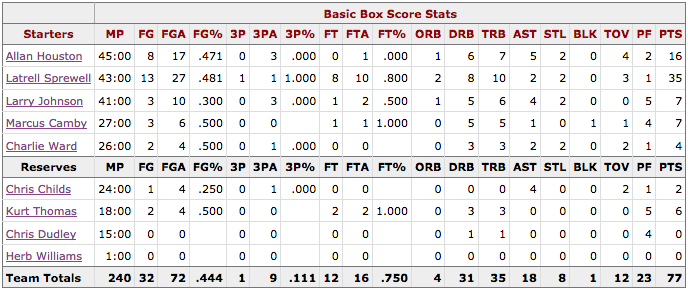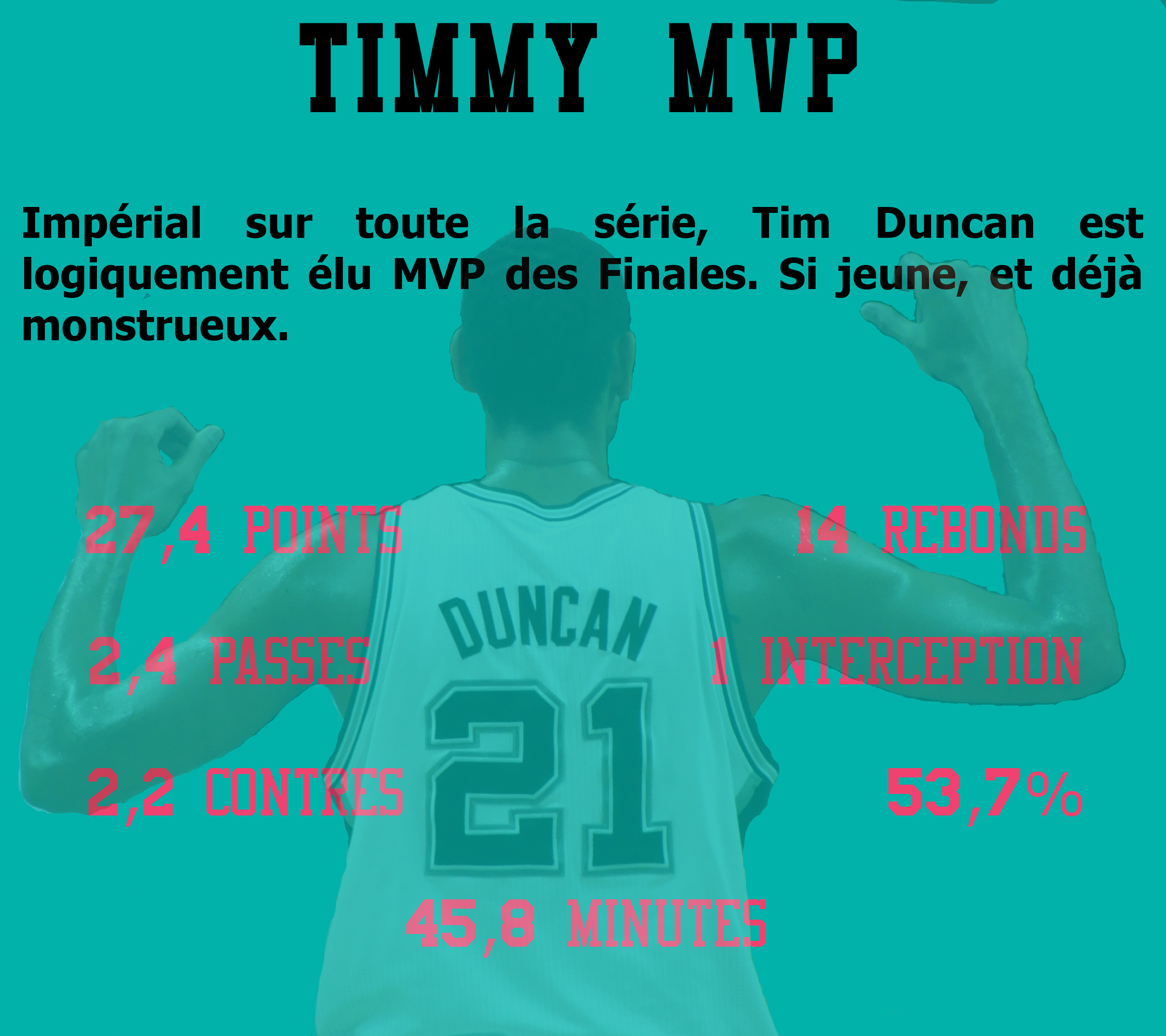Madison Square Garden
La Mecque du basket, comme on l’appelle. Et pourtant, en 1999, le pèlerinage dans la salle de New York n’est pas des plus réjouissants pour les fans des Knicks. Non seulement le lock-out les a privés – comme tous les fans de la Ligue – de nombreux matchs, mais ils doivent aussi composer avec le crépuscule de leurs guerriers, ennemis favoris de Michael Jordan et finalistes en 1994. Preuve de ce changement d’ère qui s’opère à Big Apple et en NBA, les emblématiques John Starks et Charles Oakley ont été envoyés vers d’autres cieux, quelques mois après le trade d’Anthony Mason, alors que MJ ne reviendra plus jamais maltraiter les Knickerbockers dans leur enceinte sous le maillot des Bulls.
Il était une fois, mais pas celui de Gérard, une saison des Knicks. Pas le Summer of Pat, assez conSternant et carbo après de longues négociations, le jambon et quelques gens mauvais aussi car ces échanges entre têtes de lard sont un plat indigeste. Personne ne touche le SMIC donc on s’moque de ces macs qui se dis-putent le chiffre d’affaire de la poule aux œufs d’or.
Malgré cela en 1999, Ewing détient toujours les keys de New York, Jungle de béton où les rêves se construisent. Il n’y a rien que tu ne puisses pas faire, sauf peut-être remporter un titre NBA. Allez, je sais que ca va faire Jay-z de tenir de tels propos, mais cela fait longtemps que le Garden n’est plus le paradis mais plutôt le purgatoire. D’aucuns vous diront que c’est toujours mieux que des purges à Thouars, même si certains soirs c’étaient plus que Deux Sèvres présentes sur le parquet, loin d’être sur le Thouet du monde. Aux balles connes ou a minima récalcitrantes pour rentrer dans un panier cette année-là pour les Knicks, loin d’être les idoles des jeunes, plus j’y pense et moins j’oublie. Ou j’Ebly étant donné le blé qui est aligné pour cette équipe aux résultats de pieds Knicks-lés en saison irrégulière au possible, avec un bilan à latrell jusqu’au dernier moment, au point qu’on pensait les voir sprewell de Playoffs. Les victoires pour les bleus et oranges ne sont pas mécaniques, New York ne se présentant pas sur les sentiers de la gloire. Gotham en peine, en quelque sorte.
Rien ne semble fonctionner. Typiquement quand on mate Houston, on a un problème pour imaginer la cohabitation avec Sprewell, même si Latrell est hardi au moment de sortir du banc. Un rôle dans la second unit qui est également la destinée de Childs, pas toujours en vogue au Madison Square Garden. De tels choix de la part de Van Gundy ennuient Grunfled, et quand Ernie se retrouve avec ces petites contrariétés, il donne du Phil à retordre à son coach. Même si celui qui en coulisse est prêt à vendre Gundy n’est autre que le proprio, puisque Dave a les chocottes. Au final il dira sorry à mister Jackson sans l’embaucher. Plus de Spurs que de mal pour les fans qui comptent bien se Pacers de voir l’ennemi chicagoan sur la route du Madison. Pas besoin de se plaindre ou de Riley, le Jeff du sportif reste Van Gundy après cette épopée ici contée. Spoiler : à la fin la Grosse Pomme… paume.
L'été le plus long
Entre l’élimination au second tour des Playoffs par les Pacers au mois de mai 1998 et la reprise pour l’exercice suivant, la pause n’a pas été de tout repos du côté de New York. Avec le lock-out qui a occupé le temps de Patrick Ewing et les changements au sein de l’effectif pour redevenir un vrai prétendant, les Knicks ont été grandement sollicités.
C’est en 1985 que se pose la pierre qui va servir de base à l’édifice des Knicks sauce nineties. Dans la première loterie de l’histoire, la franchise de Big Apple tire une enveloppe cornée synonyme de gros lot et choisit Pat Ewing en first pick. C’est autour de lui que petit à petit New York va se construire, pas toujours dans la patience, mais au moins avec une véritable idée directrice à partir de l’arrivée de Pat Riley en 1991. S’en suivent de nombreuses saisons régulières abouties avec un bilan de 223-105 pour Big Apple sur ces quatre années, mais jamais concrétisées en Playoffs. Car probablement plus que quiconque, les Knicks ont été les souffre-douleurs de Michael Jordan avec cinq éliminations face aux Bulls entre 1989 et 1996. C’est d’ailleurs lors de la première retraite de His Airness que Pat Riley et les siens atteignent enfin la dernière marche. Malheureusement, s’ils sont débarrassés du numéro 23 qui s’amuse avec une batte de baseball, ils tombent sur un Hakeem Olajuwon tout aussi injouable cette saison-là. Pourtant le Graal était proche, mais un tir de John Starks dévié par le Dream dans les ultimes instants du Game 6 – alors qu’Ewing était seul et bien placé – suivi d’un naufrage du numéro 3 lors de la rencontre décisive ont eu raison des rêves new-yorkais. Un an plus tard, Pat Riley quitte le navire, probablement conscient qu’il a mené ce groupe, son groupe, à son maximum. Ils avaient certainement plus de cœur que de talent, mais c’est grâce à ces efforts constants pour donner le maximum que les fans les ont tant soutenus et que ces Knicks ont marqué les esprits.
Construction des New Look Knicks
On peut reprocher de nombreux défauts aux Knicks des années quatre-vingt-dix qui n’ont jamais su aller au bout de leurs rêves de titre. L’égoïsme de Patrick Ewing. L’entêtement de Charles Oakley. La sélection de shoots de John Starks. Mais aussi d’avoir joué en même temps que Mike.
Quel jour cette génération des Knicks a-t-elle basculé ? Lors du match cauchemar de John Starks au cours du Game 7 des Finales 1994 ? Un an plus tard lorsque Pat Riley a envoyé son fax pour démissionner et se barrer au Heat ? Lorsque le front office a choisi de le remplacer par Don Nelson, sans grand succès ? Tout cela a eu un impact dans le vent du changement qui a soufflé sur la Septième Avenue. Certes il n’a pas agi par bourrasques, mais il portait en lui de nombreuses frustrations qui ont mené à la fin de cette époque centrée sur les muscles et la défense, symbolisée par le trio Patrick Ewing – John Starks – Charles Oakley.
Avant de toucher à ce noyau dur, les Knicks ont cherché à en modifier la dynamique avec des ajustements au sein du roster. C’est d’abord le numéro 3 qui a perdu sa place d’arrière titulaire au profit de Hubert Davis, lorsque Don Nelson était aux commandes. Un nouveau rôle qu’il embrasse définitivement l’année suivante, quand l’effectif connaît sa première grosse mutation. Si la signature d’Allan Houston est celle qui impacte le plus John Starks, elle n’est pas la seule remarquée cet été-là. On note bien sûr l’arrivée en tant qu’agent libre de Chris Childs en provenance des voisins du New Jersey pour rajeunir un poste de meneur où Derek Harper ne convient plus avec ses cannes vieillissantes. Mais le mouvement le plus important en cette année 1996, c’est le trade monté avec les Hornets qui envoie Anthony Mason – autre symbole de la maison – en Caroline du Nord en échange de Larry Johnson. Le poste d’ailier a souvent été considéré comme un maillon faible à Big Apple – coucou Charles Smith – et New York trouve le moyen d’y remédier.
Ces mouvements ne sont pas couronnés de succès. Une nouvelle fois, New York se fait sortir au second tour des Playoffs, une rengaine de 1995 à 1998. C’est d’ailleurs la désillusion de trop face aux Pacers l’année du dernier sacre des Bulls qui va pousser la franchise à enfin toucher à ses vieux grognards. Dans une saison marquée par la grosse blessure au poignet d’Ewing, le 20 décembre 1997 suite à une vilaine chute face aux Bucks, les Knicks se sont tout de même offerts une participation en postseason (septième position à l’Est) pour se payer le scalp du Heat au premier tour, malgré l’absence de leur pivot. Et si le numéro 33 est de retour en demi-finale de Conférence face aux Pacers, ce sont les hommes de Larry Bird qui obtiennent facilement leur qualification. Premier pointé du doigt par le front office, Charles Oakley qui a souffert face aux deux Davis. Peu importe qu’il ait posté au tour précédent un match à l’image de son histoire chez les Knicks pour valider la série. Jouant l’intégralité des 48 minutes, le Vieux Chêne a compilé 18 points et 13 rebonds sur ce Game 5 décisif, tout en intensité et en roublardise. Sa dernière grosse sortie sous ce maillot. En effet, quelques semaines plus tard Oak reçoit le coup de fil qui scelle la fin de son aventure à New York : en compagnie de Sean Marks, il doit faire ses valises pour Toronto pendant que le jeune Marcus Camby prend l’avion dans l’autre direction. Ce 24 juin 1998 met officiellement fin aux tentatives du noyau formé par Patrick Ewing, Charles Oakley et John Starks.
Pas de sentiment peut-on penser, mais une franchise à faire tourner avec une vision claire : les Knicks ont besoin d’être plus athlétiques pour franchir un palier, et ce n’est pas le style old school et lent de Charles Oakley qui va les aider à aller dans cette direction. À 34 piges et dix millions de dollars prévus pour sa dernière année de contrat, sans oublier sa fâcheuse tendance à critiquer le front office – qui n’en fait pas assez au goût d’Oak pour permettre aux Knicks de gagner – le power forward avait une belle tête de joueur sur la sellette quand on regarde avec un peu de recul le tableau new-yorkais. À quelques détails près : son importance dans le vestiaire et sa capacité à soulager Pat Ewing des tâches ingrates sans rechigner. Deux points difficiles à appliquer à son jeune remplaçant qui tarde à exploiter le potentiel aperçu à l’université du Massachusetts. Souvent blessé et forfait – avec des raisons parfois futiles quand on mate la dureté des exigences qui l’attendent à Big Apple – Marcus Camby ne présente pas les mêmes garanties que son prédécesseur. Mais il court, il saute et il contre. Des actions qui ne font pas partie du vocabulaire d’Oakley qui se définit comme « un majordome dans le manoir. Je suis heureux de laver et m’assurer que tout aille bien ». Maintenant, le service est terminé et Charles n’a même pas souhaité entendre les explications de la fin de sa mission par son boss
Vous n’allez rien me raconter. Si je suis échangé, je suis échangé. Je ne suis plus votre produit.
Le changement est alors en marche, mais il sera vite mis en stand-by. En effet, au lieu de se demander quel sera le visage des Knicks pour la saison à venir, la question est devenue… « est-ce que celle-ci va avoir lieu ».
Off the court
Si Ernie Grunfeld et Jeff Van Gundy bossent ensemble depuis dix ans, l’amour fou n’a jamais été au rendez-vous. Tout a débuté quand les deux hommes partageaient le banc de Stu Jackson à partir de 1989 comme assistants. Alors que Grunfeld a été promu l’année suivante dans le front office des Knicks, coach Stu a été prié de prendre ses affaires et quitter les travées du Madison Square Garden. Un licenciement que Jeff Van Gundy impute en partie à son ancien collègue du staff, convaincu que Grunfeld a œuvré pour saborder Stu Jackson. En résumé, quand la saison 1999 commence, la dynamique est la suivante : pour Jeff, Ernie n’est qu’un politicien trop occupé à sauver ses fesses pour être un bon GM. Et pour Ernie, Jeff n’a pas le charisme pour driver les Knicks. Une bonne base de travail.
D’abord General Manager assistant auprès d’Al Bianchi entre la fin des eighties et le début des nineties, Grunfeld a pris sa succession peu de temps après l’arrivée au pouvoir de Dave Checketts, mis en place comme Président par la Paramount en mars 1991. Les deux hommes sont à la base de la construction de cette équipe rugueuse des Knicks tout d’abord drivée par Pat Riley, puis Don Nelson et enfin Jeff Van Gundy suite à l’échec de Nellie. Le Mormon, le politicien et le pin’s, voilà le trio en place pour mener les Knicks au plus haut.
Lock-out
Alors que les fans de la balle orange espèrent avec impatience le retour de la NBA et un souffle nouveau avec l’explosion programmée des Bulls, ils vont vite déchanter. Joueurs et propriétaires ne parvenant pas à un accord salarial, la Ligue ferme ses portes. Un conflit qui va durer de longs mois, laissant chacun dans l’attente et l’incompréhension.
L’ère post-Jordan peut difficilement commencer d’une façon plus pénible. Certes, la nouvelle retraite du numéro 23 chicagoan n’est pas actée lorsque le lock-out démarre le premier juillet 1998, mais la fin des Bulls venant de boucler leur second threepeat ne laisse que peu de doutes. D’ailleurs, lors du gel des activités de la NBA, la star la plus médiatique ne prend pas son bâton de pèlerin pour défendre les joueurs, même s’il se permet quelques sorties dans la presse pour soutenir ses collègues. Non, c’est plutôt Patrick Ewing qui va mettre sa réputation en jeu aux côtés de Billy Hunter, président du syndicat des joueurs, au moment de mener le bras de fer avec les propriétaires des franchises. Le contexte est simple : les proprios considèrent qu’ils perdent de l’argent et activent donc la clause leur permettant de renégocier l’accord salarial signé en 1995 si le blé gagné par les joueurs dépassent 51,8% des revenus liés au basket. Avec 57,1% en 1997-98, la barre est allègrement atteinte selon eux. Si la NBA a déjà connu des négociations tendues, jamais une saison n’a été impactée, seule ligue majeure de sport US dans ce cas. Mais l’exception ne va pas durer car en cet été 1998, les points de désaccord sont bien trop importants et nombreux pour pousser à l’optimisme. De quoi exaspérer les fans qui voient depuis leur fenêtre un conflit entre des millionnaires et des milliardaires, bien loin des préoccupations de ceux qui aiment ce sport. Les joueurs vont d’ailleurs vite se mettre cette opinion publique à dos avec des déclarations maladroites, Ewing tentant d’expliquer sans trembler du menton la justesse de sa cause :
Nous nous battons pour notre survie. Je ne nous vois pas comme différents d’un autre syndicat, à part pour l’échelle des salaires qui est légèrement différente.
Un Pat Ewing avec un rôle central qui va énormément l’exposer. Si les joueurs apprécient qu’il se batte pour eux alors qu’il est celui avec le plus à perdre (avec dix-huit millions de dollars de salaire en 1998-99, le pivot est le mec le mieux payé de la Ligue), son combat ne passe pas auprès des fans et David Stern le raille en privé pour être le pantin de son agent David Falk. L’entêtement du pivot new-yorkais va même l’exclure d’une dernière discussion cruciale.
Le 6 janvier – un jour avant l’ultimatum fixé par le commissionnaire – la saison est sauvée et c’est dans une version raccourcie qu’elle va se dérouler, avec peu de temps pour se préparer. À cet instant, les questions sportives reprennent le dessus et à New York la première soulevée est le niveau du franchise player. Avec le rajeunissement de l’effectif en marche, les Knicks ont besoin de Pat au top de sa forme pour se battre au rebond et moins se concentrer sur le scoring suite au départ d’Oakley. Mais c’est l’inverse qui se profile. Épuisé nerveusement, lesté de dix kilos à force de manger lors de réunions interminables, pas forcément sérieux dans la poursuite de sa rééducation après sa blessure au poignet lors de la saison écoulée : Patrick Ewing a besoin d’une coupure dont il ne bénéficie pas. Une absence de repos et de remise en forme qu’il va payer tout l’exercice à venir. Et lorsqu’on voit que chaque joueur du roster de Big Apple n’a que trop rarement daigné bouger son boule jusqu’au Manhattanville College de Westchester – point de rassemblement non-officiel pour les workouts durant la grève – on comprend mieux la difficulté à créer une alchimie dans le jeu le reste de l’année. L’assiduité n’a pas été bien plus au rendez-vous lorsque Purchase a pu rouvrir ses portes une semaine avant le camp d’entraînement. Les bases sont posées pour les Knicks, mais pas dans le sens escompté.
Off the court
17 janvier 1999. Cela fait treize mois que Latrell Sprewell est considéré comme la lie de la NBA. Et pourtant, il reçoit à Milwaukee Dave Checketts, Ernie Grunfeld, Ed Tapscott – son assistant – et Jeff Van Gundy, qui viennent de se payer le voyage depuis New York. L’état major des Knicks ne s’est pas déplacé pour prendre une bière avec Spree et si la discussion reste informelle, l’entretien d’embauche n’est pas loin même si la consigne de Checketts est claire : pas d’interrogatoire. Pourtant le Mormon est certainement le moins emballé par l’idée de voir le hors-la-loi rejoindre son écurie pendant que Grunfeld souhaite impressionner son boss et la presse avec un gros deal pour re-dynamiser les Knicks. Quant à JVG, s’il mesure le risque de l’acquisition d’un caractère comme celui de Sprewell, il perçoit plus le joueur comme un atout rarement vu à Big Apple que comme un mec sur le point de l’étrangler. Pourtant, aucun d’entre eux n’aurait volé au secours de l’American Nightmare suite à son agression sur PJ Carlesimo quelques mois plus tôt. Quatre éliminations consécutives au second tour des Playoffs et une retraite de Michael Jordan pesant dans la balance, la donne a changé au point que le All-Star est en tête de la liste des courses de la franchise. Au cours de cette réunion autorisée par David Stern himself en cette fin de lock-out et alors que l’arrière est encore sous contrat avec les Warriors, les excès de Spree sont bien entendus abordés. Quelques explications plus tard, il faut trancher. Bilan de l’échange : le lascar mérite une seconde chance comme le pousse Jeff Van Gundy :
Ne nous voilons pas la face. Ce mec est barge. Et c’est ce que j’aime chez lui. Nous ne pouvons pas passer à côté de l’occasion.
De longs mois plus tard, on retrouve donc le roster tel qu’il avait été abandonné durant le lock-out et on recommence les mouvements au plus vite pour être opérationnel à la reprise. Les dirigeants des Knicks n’ont pas prévu de chômer. Après Charles Oakley, c’est au tour de John Starks de quitter le navire, accompagné de Chris Mills et Terry Cummings. Une bombe, le numéro 3 étant un symbole à New York. Et la seconde déflagration, c’est que Starks laisse sa place à Latrell Sprewell. Le bani. La calamité hors des parquets. Celui qui représente le pire du sport US. L’homme que le public n’a toujours pas pardonné malgré sa longue absence pour suspension après avoir étranglé son coach PJ Carlesimo du côté de Golden State. Comment les Knicks peuvent prendre un tel risque, se séparer d’un soldat loyal pour aller chercher un criminel pouvant faire exploser le vestiaire ? Pour plusieurs bonnes raisons. Premièrement, l’opportunité d’épauler Patrick Ewing par un vrai joueur calibre All-Star est une première à Manhattan, et le natif de Kingston mérite bien qu’on le décharge de quelques responsabilités. Les têtes pensantes des Knicks ont bien pesé le pour et le contre : le risque mérite d’être couru. De toute façon, s’ils ne font pas l’effort, Latrell Sprewell ira renforcer les rangs d’un autre contender, les Spurs et le Heat étant clairement sur la ligne de départ dans la course à l’arrière explosif. Enfin, il n’a pas été si dur que ça de lâcher Starks dans le deal. Depuis quelques temps, Jeff Van Gundy remet en cause l’envie du joueur, moins passionné qu’avant et qui passe de plus en plus de temps sur des activités annexes comme le golf. Le fait qu’il prenne ses clubs lors des déplacements en Floride et à Indianapolis au cours des Playoffs de 1998 – ce qui avait fait enrager Larry Johnson – confirme cette tendance. Pour un joueur qui s’est construit sur sa dalle lorsqu’il foule les parquets, pour le meilleur comme pour le pire, faisant son trou de la CBA – après avoir été coupé par les Warriors en 1989 – jusqu’à une phalange d’Hakeem Olajuwon d’un titre NBA, cela fait désordre. Pour autant John Starks reste une valeur sûre de la Ligue et un ami de Pat Ewing, ce qui aurait pu lui conférer un statut d’intouchable. Ce n’est pas le cas et celui qui déclarait qu’il faudrait lui arracher son jersey floqué du numéro 3 avant de le voir partir accepte son sort, exprimant un seul regret :
Quand je n’ai pas été capable de jouer à mon niveau de performance et rapporter un titre pour cette ville qui le mérite tant. C’est la seule chose que je regrette ici.
Ce seul match, c’est ce terrible 2/18 lors du Game 7 des Finales de 1994, dont il a fait des cauchemars des mois durant. C’est donc sans avoir complètement exorcisé ses démons que John Starks quitte Big Apple, laissant le champ libre à Latrell Sprewell et tous les doutes l’entourant. Mais surtout abandonnant Patrick Ewing comme rare survivant de l’ère Pat Riley à New York, accompagné uniquement du vieux Herb Williams et de Charlie Ward. Autant dire que la page est bien tournée au MSG. Et Jeff Van Gundy ne dispose que de deux semaines pour assembler correctement les nouvelles pièces de ce puzzle appelé roster.
Pour compléter l’effectif dont les grandes lignes sont désormais définies, d’autres noms viennent grossir les rangs. Si les signatures de Ben Davis et Rick Brunson en tant qu’agents libres passent relativement inaperçues, on remarque un peu plus celles des vétérans Dennis Scott et David Wingate, même si on ne les imagine pas avoir un rôle ou un impact majeur dans la rotation. L’arrivée dans la foulée de Kurt Thomas intrigue plus. L’ailier fort est un ancien choix de loterie à la Draft 1995 qui sort de deux saisons de galère suite à des pépins physiques et il va devoir venir rajouter une touche de dureté perdue suite au départ d’Oakley. Mais dans quelle condition se trouve-t-il ? Pour couronner le tout, Buck Williams décide qu’il est temps pour lui de mater les matchs en sirotant une bière plutôt que servir de complément sur le banc, le tout à quelques heures du premier match de pré-saison. Certes le vétéran ne se pointe pas comme un incontournable pour les objectifs new-yorkais, mais son départ met encore plus à mal toute notion de continuité sur laquelle Jeff Van Gundy aimerait probablement s’appuyer au moment d’incorporer six nouveaux dans sa rotation.
Pour le management, aussi fidèle le trio Starks-Ewing-Oakley est, tout ce qu’il a laissé comme marque indélébile, souvenirs de Playoffs, litres de sueur, l’amour que les fans leur portent, ce noyau ne forme plus la base qui ramènera un titre à Big Apple. Ewing le All-Star, la pierre angulaire. Charles Oakley, l’homme de main dévoué aux basses tâches, gladiateur des temps modernes. John Starks, le fils de Pat Riley, gâchette et véritable tête brûlée. Ils ont symbolisé les Knicks des années 90 condamnés à rester dans l’ombre de Michael Jordan, losers magnifiques par leur cœur. C’est donc au tour d’une nouvelle génération d’entourer Pat Ewing – avant de prendre son relais – et de relever le défi new-yorkais à la fin du lock-out en créant une alchimie dans un temps record.
New Knicks on the block
Si Patrick Ewing reste le pion central de l’échiquier new-yorkais, l’effectif a bien bougé autour de lui pour lui offrir d’autres pièces maîtresses. Présentation.
Gang of New York
Au moment d’attaquer la saison, l’armée des Knicks a fière allure, avec certainement plus de talent que lors des saisons précédentes. Mais un vécu collectif bien moindre.
Dans le staff des Knicks à partir de 1989, Jeff Van Gundy grimpe les marches de la hiérarchie new-yorkaise, de coach assistant jusqu’à devenir le boss de la squad tactique en mars 1996 suite à l’échec Don Nelson dans la succession de Pat Riley. Arrivé dans l’anonymat pour assister Stu Jackson à Big Apple lorsque ce dernier a pris le relais de Rick Pitino – les trois hommes ayant travaillé ensemble à Providence – il survit au départ du coach ainsi qu’au licenciement de son remplaçant John MacLeod. Pourtant, il s’imaginait déjà quitter le microcosme de la NBA avant d’avoir un entretien avec le nouvel embauché Pat Riley. Deux heures plus tard, le gominé le plus célèbre de la Ligue offre une place de choix dans son staff à Jeff Van Gundy. Et lorsque Pat the Rat fait ses valises pour South Beach, JVG est prêt à suivre son mentor. Mais les Knicks s’y opposent et Don Nelson fait en sorte d’obtenir un contrat en or pour un assistant. Position qui donc ne reste plus très longtemps celle de Van Gundy puisqu’au licenciement de Nellie, c’est Jeff qui pose ses costumes bien moins classes que ceux de Pat Riley sur le banc des Knicks. Regard de cocker triste, début de calvitie le privant de gomina et look d’addict au taf, JVG n’a pas la dégaine glamour ou impec qui fait rêver les communicants du Madison Square Garden. Beaucoup plus les joueurs et les fans qui trouvent rapidement en lui un gros bosseur dévoué au succès des Knicks. Van Gundy poursuit la tradition de l’équipe des années 90 : des saisons régulières très solides, mais l’incapacité de jouer le titre jusqu’au bout, régulièrement à cause de Michael Jordan.
Le chemin se dégage pour Big Apple à la retraite de ce dernier et JVG se voit offrir une escouade de choc pour aller chercher le Larry O’Brien, du moins sur le papier car l’équilibre de l’équipe est clairement remis en cause. Mais entre des résultats chaotiques et une direction qui œuvre en coulisse pour trouver un meilleur chef d’orchestre jouant du triangle, ses jours semblent comptés. C’est d’abord la mise au placard d’Ernie Grunfeld qui consolide la position du coach soutenu par ses joueurs, en particulier Pat Ewing qui n’hésite pas à lier son avenir à celui de JVG. Et Jeff Van Gundy en profite pour s’affirmer encore plus grâce à son run lors des Playoffs, même si son patron Dave Checketts finit par avouer avoir contacté Phil Jackson au cours de la saison.
Aux côtés de Van Gundy, on retrouve Greg Brittenham (qui s’occupe de la condition physique des joueurs), Don Chaney (ancien joueur des Celtics et entraîneur de l’année avec les Rockets en 1991), Brendan Malone (le père de Mike), Jeff Nix ou encore un Tom Thibodeau déjà en mode gourou de la défense.
À trente-six piges, Pat Ewing ne ressemble plus à la force dominante qu’il a pu être dans son prime. The Beast of the East voit son corps qui commence à le lâcher. Certains vont jusqu’à critiquer la légende des Knicks, pointant du doigt le ralentissement du jeu en sa présence quand nombre de ses coéquipiers ont besoin d’enlever le frein à main pour un style plus uptempo. Une preuve de plus d’une certaine forme de désamour entre celui débarqué comme le sauveur à la Draft 1985 – premier choix issu de la première loterie – et le public new-yorkais qui a souvent vu en son pivot un bouc émissaire parfait aux échecs des Knicks. Après une saison 1997-98 avec seulement vingt-six matchs disputés, Pat Ewing va encore squatter l’infirmerie en 1999. Alors certes, on ne parle pas d’un exercice terminé – avant un retour succinct en Playoffs – après moins de deux mois de compétition à cause d’un poignet bousillé, mais ce sont tout de même douze rencontres qui sont manquées cette année, en particulier à cause d’un tendon d’Achille récalcitrant. Que ce soit Mère Nature qui fait son effet avec l’âge grandissant du natif de Kingston ou alors un retour de bâton d’une préparation estivale quasi-nulle suite au lock-out, les absences répétées du pivot ne sont pas sans conséquence et l’irrégularité des Knicks trouve ici une explication non-négligeable. La franchise de Big Apple est même légèrement moins performante avec Ewing (53% contre 58% de victoires, mais l’échantillon est faible). Pourtant, Pat serre les dents et son expérience reste indispensable au vestiaire new-yorkais, tout en maintenant le cap comme top scoreur, rebondeur et contreur sur les parquets, même si son adresse n’a jamais été aussi médiocre (43,5%).
Sauf qu’en Playoffs, son impact va se réduire à mesure que son tendon le fait souffrir, jusqu’à ce qu’il déclare forfait à la fin du Game 2 des Finales de Conférence face aux Pacers. Si les Knicks s’en remettent pour ce tour, son absence n’est qu’un obstacle de plus qui rend la dernière marche contre les Spurs insurmontable. Et oui, on ne se passe pas aussi facilement du « meilleur pivot à avoir joué pour les Knicks » comme le décrit une autre légende du Madison Square Garden, Willis Reed.
Quand l’étrangleur de San Francisco débarque à Manhattan, les questions qui l’entourent sont nombreuses. Suspendu de longs mois suite à son agression sur PJ Carlesimo, on ne l’a plus vu sur un terrain de basket depuis un bail. Caractère explosif comme son jeu, les doutes existent quant à sa capacité à entrer dans le moule collectif, surtout qu’à son poste à New York joue un certain Allan Houston. Bref, état physique, intégration et compatibilité avec les joueurs en place, on peut se demander si les Knicks font une affaire, surtout en lâchant le fidèle et apprécié John Starks dans le deal. Pour autant, jamais Pat Ewing n’a eu un coéquipier du standing de Spree pour le soulager du lourd fardeau qu’est de porter la franchise new-yorkaise. Un mec calibre All-Star – trois fois au cours de ses cinq premières saisons dans la Ligue sous le maillot des Warriors. Un joueur capable d’électriser le Madison Square Garden par son énergie et sa passion. Mais un mec avec une étiquette de loser – une seule série de Playoffs conclue par un sweep – qui s’est déjà embrouillé avec des coéquipiers par le passé et dont le talent repose sur l’instinct, bien loin du basket structuré en place à Big Apple. Le pari est risqué, mais les Knicks sont prêts à le tenter. Et tout au long de la saison, au gré des hauts et des bas rencontrés par les pensionnaires du Madison Square Garden, le mode free style et l’attitude parfois – souvent – je-m’en-foutiste ou décalée de Sprewell permettent aux observateurs d’alimenter le débat du bien-fondé de ce recrutement.
Il s’avère que c’est en dynamiteur des second units adverses que Jeff Van Gundy décide d’utiliser son slasher, avec un groupe qui joue plus uptempo que le cinq de départ. Un rôle que le numéro 8 accepte sans pour autant l’adopter et qu’il quitte finalement lors de la fin du run en Playoffs des Knicks, lorsque JVG change son fusil d’épaule afin de donner un second souffle à sa rotation suite aux nombreuses blessures. Un coaching gagnant quand on voit les performances et l’impact de Spree lors de ces Playoffs, mais insuffisant pour aller chercher le titre. Pourtant, Latrell Sprewell n’a pas ménagé sa peine face aux Spurs.
Aux côtés de Sprewell, le jeune intérieur est la seconde recrue phare des Knicks. Récupéré contre le vieux Charles Oakley, Camby Man va devoir lutter pour obtenir sa place et trouver son rôle. Il faut dire que remplacer le vieil Oak – admiré par les fans et adoubé par Pat Ewing pour son travail de guerrier libérant le pivot de nombres de charges ingrates – n’est pas tâche aisée. Surtout que Jeff Van Gundy semble en accord avec les aficionados pas forcément fans de ce trade, symbole de l’orientation plus jeune et plus athlétique voulue par la franchise.
Si le potentiel du second pick de la Draft 1996 est supérieur à celui du Chêne grincheux, Marcus est encore loin de pouvoir prétendre s’imposer comme titulaire chez un contender, sans compter qu’il squatte régulièrement l’infirmerie lors de ses années canadiennes et le banc pour ses débuts à Big Apple. Certains y voient un message de Jeff Van Gundy à Ernie Grunfeld, peu satisfait du trade et de la perte de Charles Oakley. Chose que le coach niera toujours, évoquant plutôt l’adaptation de son intérieur aux exigences de Big Apple. Au lieu de se plaindre, le joueur pour sa part taffe et essaie de mettre à profit ses qualités de défenseur avec la second unit, ce qui lui permet – au gré des blessures dans le secteur intérieur – de voir son temps de jeu et son impact croître sur les dernières semaines synonymes du run new-yorkais pour accéder aux Playoffs. Dans la constante lutte d’influence dans les couloirs du Madison Square Garden, Marcus Camby reçoit – en plus du soutien de Grunfeld – l’appui d’un toujours écouté et réputé Isiah Thomas, consultant chez NBC et accessoirement le mec qui l’a drafté chez les Raptors.
C’est lors de la postseason qu’il finit par faire son trou, assurant en back-up lors des deux premiers tours – en rivalisant au passage face l’expérimenté Mutombo – avant d’exploser à partir du Game 2 des Finales de Conférence contre les Pacers. Ewing définitivement out, Marcus Camby s’offre le scalp de la raquette des Hoosiers et les louanges de son coach sur sa progression et son état d’esprit au cours de la saison. Avant de prendre la leçon – à l’instar de son équipe – face aux Spurs du duo Duncan-Robinson bien trop fort pour que Camby Man puisse lutter sur la durée.
Débarqué à NY en tant qu’agent libre à la fin de son contrat rookie chez les Pistons, Allan Houston arrive pour donner un second souffle aux Knicks des nineties qui semblent caler après les Finales perdues de 1994 et le départ de Pat Riley un an plus tard. Dans cette optique, obtenir un joueur plus jeune, plus athlétique, plus talentueux mais aussi moins dans le moule physique du groupe en place depuis plusieurs saisons doit permettre à la franchise de Big Apple de changer de style. Sous le tutorat de John Starks devenu sixième homme pour l’occasion, Allan Houston prend ses marques et grandit avec le jersey des Knickerbockers. Le shoot pur, il reste tout de même dans l’ombre de Patrick Ewing avant de s’émanciper progressivement lors de la saison 1999, justement parce que le déclin du pivot s’accélère avec les blessures. Il devient alors la première option des Knicks en Playoffs, même si Sprewell, qui a remplacé Starks, score plus, s’offrant même un game winner de légende sur un floater-runner plein de réussite lors du match décisif contre le Heat. Un joueur transfiguré au moment des Playoffs, confiant et clutch, tellement loin de l’impression dégagée en saison régulière d’un mec parfois hésitant, peu sûr de lui et aux performances inégales.
Au milieu du boxon médiatique new-yorkais, le style calme et la voix posée d’Allan Houston ont un effet apaisant et le propulsent comme relation presse de luxe pour les Knicks à la recherche de leur nouvelle star pour remplacer leur pivot vieillissant. Même si cela signifie mettre sur le devant de la scène un joueur ayant encore à s’affirmer. Mais le front office aura toujours confiance en lui, lui proposant par la suite un contrat fort lucratif (cent millions sur six ans en 2001) que les différents observateurs ne manqueront jamais de lui rappeler, même lorsqu’il atteindra le statut All-Star.
Explosif et puissant à ses débuts aux Hornets, Larry Johnson a grandement contribué à la hype qui entourait les Frelons au début des nineties. Mais l’état de grâce s’est envolé en fin d’année 1993 avec une blessure au dos qui va l’obliger progressivement à se réinventer, entre autres avec des progrès derrière l’arc et un jeu plus complet ainsi qu’une panoplie de mouvements rapides au poste. Une tendance qui s’est confirmée chez les Knicks où Larry Johnson a été échangé à l’été 1996, résultat d’une explosion du noyau de Charlotte amorcée quelques mois plus tôt quand les frictions entre le power forward et Zo Mourning avaient envoyé ce dernier sous le soleil de Floride.
Débarqué à Big Apple en 1996 contre Anthony Mason et un Twix, il a tout de suite séduit Jeff Van Gundy par sa volonté à répondre aux besoins de l’équipe pour le bien du groupe. Avec des stats en baisse dans toutes les catégories ou presque lors de sa première saison à Gotham, Grandmama confirme par contre cette faculté à être un couteau suisse qui se sacrifie pour faire tourner un effectif et dont l’influence dépasse non seulement le cadre des chiffres, mais aussi celui du parquet. Et cela même si certains attendent plus de stats pour un mec au contrat atteignant les quatre-vingt-quatre millions de dollars.
Devenu taulier du vestiaire des Knicks par son attitude et son altruisme mais surtout sa capacité à échanger avec chacun, vétérans comme plus jeunes, LJ joue un rôle prépondérant pour maintenir le cap en 1999 malgré les difficultés rencontrées. Il est d’ailleurs le premier à croire que si les Knicks atteignent les Playoffs, ils auront un coup à jouer tant chacun à la capacité d’élever son niveau. Il joint les actes aux paroles dans l’un des symboles de ce miracle new-yorkais avec son action à 4 points pour remporter le Game 3 des finales de Conférence face aux Pacers.
Malheureusement, la suite est plus compliquée pour lui, entre des soucis au genou et le fait de devoir défendre dans la raquette face aux Spurs, lui qui rend une quinzaine de centimètres en moyenne aux Twin Towers texanes.
Fin janvier, Kurt Thomas lance le recrutement des free agents des Knicks dont il est finalement la seule signature d’impact, le lendemain du trade faisant débarquer Spree à Big Apple. Forcément, avec tout l’argent déjà sorti de la banque pour l’effectif en place, difficile de faire rêver les agents libres. Mais les Knicks font le pari d’un mec qui n’a pas encore fait son trou en NBA mais dont le pedigree NCAA – meilleur scoreur et rebondeur du pays en 1995, troisième joueur à accomplir cet exploit après Xavier McDaniels et Hank Gathers – laissait présager de belles promesses. Comme dans le même temps la raquette des Knicks s’est dépeuplée, offrant moins de profondeur que dans le passé, il faut bien trouver des solutions. S’il n’arrive pas dans la peau d’un titulaire en puissance après deux saisons marquées par les blessures – fracture de fatigue – à Miami puis Dallas, Kurt Thomas va rapidement prendre place aux côtés de Pat Ewing pour jouer des coudes et s’occuper des tâches ingrates dans la peinture qui incombaient jusqu’il y a peu à Charles Oakley. Encore inexpérimenté – il sort juste de son contrat rookie – il se met parfois en difficulté à cause de problèmes de fautes, mais son dévouement et son absence d’état d’âme lorsqu’il s’agit de soulager Patoche en défendant sur le meilleur intérieur adverse ont été très appréciés des fans new-yorkais.
Ce souci de discipline va faire partie des raisons d’un changement tactique de la part de Jeff Van Gundy face aux Pacers. Kurt Thomas sort finalement du cinq de départ pour le protéger de ses excès et permettre à Sprewell de débuter les rencontres après le Game 3 des finales de Conférence.
Vainqueur du trophée Heisman du meilleur joueur de foot US à la fac – comme O.J. Simpson, Cam Newton ou Tim Tebow par exemple – c’est finalement vers le basket que l’un des plus grands athlètes universitaires de l’histoire – il a également été choisi par des franchises de Major League Basketball – se dirige pour sa carrière professionnelle, drafté par les Knicks en fin de premier tour en 1994.
Pas facile de faire sa place dans le groupe des finalistes de l’époque. C’est finalement lorsque Jeff Van Gundy – proche du joueur car responsable du développement des jeunes lors de la saison rookie de Ward – reprend la destinée de l’équipe que le rôle de Charlie va évoluer positivement. Au point de devenir le titulaire à la mène, ce qui à défaut de faire rêver les foules a au moins récompensé ce gros bosseur apprécié des fans de Big Apple car enfant du cru ayant fait son trou. Distributeur et shooteur correct, il n’en reste pas moins limité pour se frotter aux meilleurs meneurs de la Ligue. Mais il a du cœur, un atout fort pour les supporters qui viennent de voir partir leurs chouchous Starks, Oakley et Mason au cours des derniers mois. Une qualité qui a également pesé dans le parcours des Knicks, basé sur cette énergie et cette volonté. Même si au final, la défaite face aux Spurs relance le débat du niveau du poste 1 de la franchise de Gotham tant l’impact de Ward – tout comme de sa doublure Childs – a été faible. Quand on sait qu’ils ont clairement perdu leur matchup face à Avery Johnson lors des Finales, les lacunes des meneurs sont évidentes.
Dans le vestiaire, il dispose d’un rôle particulier. Très croyant, il tient des réunions auxquelles certains de ses coéquipiers participent, comme Allan Houston ou Chris Dudley. Une croyance qui peut lui faire tenir des discours dont les conséquences prennent vite des proportions non-négligeables dans le boxon médiatique de Big Apple et qui ne permettent pas toujours l’apaisement autour de la franchise.
Après avoir à peu près réussi une saison NBA aux Nets – en sophomore, sortant de l’ombre de Kenny Anderson, transféré aux Hornets faute d’accord sur une extension de contrat – Chris Childs se voit offrir les clefs du camion new-yorkais en 1996 avec en bonus vingt-quatre millions de dollars sur six ans. Une drôle d’idée pour remplacer le vieillissant mais certes expérimenté Derek Harper quand on sait que le lascar n’a pas été drafté à sa sortie de la fac en 1989, roulant plutôt sa bosse avec succès en Continental Basketball Association. Un passage au niveau inférieur qui lui permet entre autres de se débarrasser de ses vieux démons, Chris Childs ayant un attrait un peu trop prononcé pour la bouteille qui a retardé son arrivée en NBA et même plus tant sa vie était négativement impactée par son alcoolisme. Au bout d’une saison à Big Apple, le verdict est clair : il n’a pas les épaules d’un titulaire à la mène pour une franchise qui souhaite jouer les premiers rôles dans la Ligue. Il laisse donc sa place à Charlie Ward pour apporter plus d’intensité défensive et un peu d’adresse du parking à la second unit, un rôle qui correspond également mieux à ses qualités avec une rotation qui joue plus vite. Bon, cela implique aussi la poursuite de ses pertes de balle par précipitation… Autant dire que le niveau du poste de meneur chez les Knicks en cette saison 1999 fait rêver, les deux joueurs ayant été pointés du doigt tout l’exercice pour leur manque d’impact et leur faible rendement.
Du fait de son parcours, Childs n’a jamais eu peur des responsabilités en prenant un gros tir ou en répondant à la presse, devenant un client apprécié des médias new-yorkais. Mais son manque de discernement sur un parquet – il est d’ailleurs bien plus un shooteur qu’un playmaker – a le don de faire péter un câble à son coach et aux fans du Madison Square Garden. En s’appuyant de l’autre côté du terrain sur son agressivité, il a tout de même pu faire son trou pour rester important dans la rotation, en particulier quand Charlie Ward souffrait en défense face à Mark Jackson. Malheureusement touché au genou lors des Finales, il ne pèse absolument pas dans cette ultime série.
Chris Childs
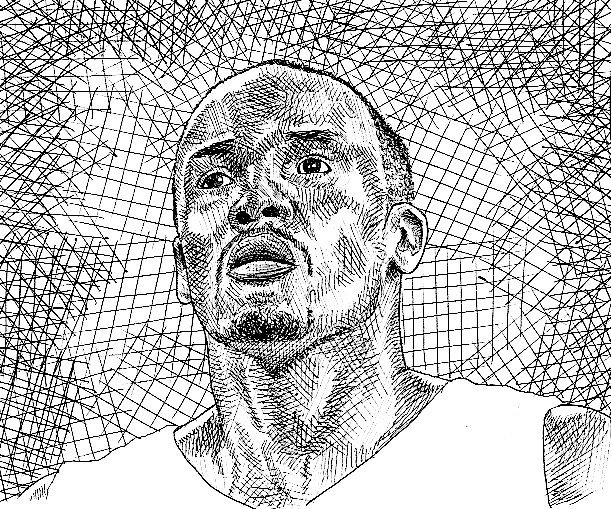
Candidat républicain pour le poste de gouverneur de l’Oregon en 2010, Chris Dudley est passé par les bancs de la fac de Yale, plus connue pour ses diplômes que son équipe de basket (seuls sept joueurs draftés issus de Yale, dont quatre n’ayant jamais foulé les parquets de la NBA). Est-ce que la faible renommée du programme sportif de l’université peut expliquer que ce grand échalas soit le pire mec de l’histoire sur la ligne des lancers francs ? Qu’importe ce tampon peu glorieux sur sa carrière, les Knicks le récupèrent au cours d’un trade à trois avec Blazers et Raptors avant le début de la saison 1997-98, pour prendre six fautes tous les soirs lorsque Pat Ewing souffle sur le banc. Un rôle qui lui va à merveille, lui qui n’hésite pas à cogner durement pour s’assurer que son adversaire ne profite pas d’un and-one. Alors qu’il semble dénoter dans le vestiaire des Knicks par son origine sociale, son éducation ou encore le fait qu’il soit le seul WASP du roster, Chris Dudley s’intègre parfaitement, capable de s’adapter aux différents styles de ses coéquipiers et participant aux offices de Charlie Ward en compagnie d’Allan Houston ou Herb Williams. Diabétique, il contrôle son taux de sucre pendant les matchs pour s’assurer que tout va bien. Une lutte contre la maladie qui a probablement forgé également son caractère pour faire sa place en NBA malgré ses lacunes techniques et athlétiques. Susceptible tout de même d’apporter quelques contres et rebonds pour définir un défenseur honnête lorsqu’il ne se fait pas ridiculiser par Shaq, il hérite du poste de titulaire quand Pat Ewing doit abandonner les siens.
Avant même cette intronisation dans le cinq, il connaît son moment de gloire lors du Game 3 face aux Hawks en proposant la meilleure ligne statistique des pivots de la rencontre. En faisant preuve d’une grosse débauche d’énergie sans être brillant, il contribue à éliminer les Pacers en étant cette fois-ci la solution permettant à un Marcus Camby bondissant de se reposer par instants. Il ne se mêle cependant pas trop longtemps aux titulaires, juste pour finir Indiana et prendre deux mixtapes par Robinson et Duncan lors des Finales, avant que Jeff Van Gundy ne stoppe le carnage en remettant son maçon sur le banc pendant que Camby glisse dans le 5. Pour guère plus de succès.
Ils n’ont certes pas servi à grand chose, mais leur nom est tout de même apparu sur un jersey des Knicks au cours de la saison. Rick Brunson, Ben Davis, Dennis Scott, Herb Williams et David Wingate complètent le roster de Jeff Van Gundy avec des fortunes diverses, mais en étant surtout là pour faire le nombre.
Le lot n’a rien d’alléchant : Dennis Scott encore plus gros qu’avant, David Wingate et Herb Williams bien cramés et pas loin de la maison de retraite, Rick Brunson et Ben Davis pour assurer le quota de no names d’un roster NBA, la rotation derrière les neufs soldats préférés de Jeff Van Gundy n’a pas de quoi filer une demi-molle aux observateurs, bien au contraire. D’ailleurs, à eux cinq, ils ne cumulent que 448 minutes sur la saison, plus 34 en Playoffs (réparties sur Williams et Brunson). La preuve flagrante de l’inefficacité de ce quintet pouvant être symbolisée par le naufrage de Dennis Scott, tellement loin de l’ancien sniper du Magic et dont les seuls buckets enfilés dans la saison le furent au KFC. Plus que son niveau, son attitude et son manque d’investissement polluent le groupe et Jeff Van Gundy finit par lui indiquer la porte. Tout l’inverse d’un Herb Williams, du moins en ce qui concerne l’apport au vestiaire. Aîné de quatre ans de Jeff Van Gundy, le vétéran respecté est une présence tutélaire rassurante pour les plus jeunes comme Kurt Thomas ou Marcus Camby qui ne manquent pas de lui demander conseil.
Last and maybe least
- Rick Brunson
- Ben Davis
- Dennis Scott
- Herb Williams
- David Wingate
From Old York to New York
Entre les Finales de 1994 et celles de 1999, le visage des Knicks a bien évolué. Comme la répartition des tâches dans l’équipe. Coup d’œil sur cette nouvelle génération, ses différences et ses points communs avec ses prédécesseurs, le trait d’union étant assuré par Patrick Ewing.
50 matchs pour une saison irrégulière
Comme on fait son lit on se couche a-t-on coutume de dire. Mais les Knicks n’ont certainement pas pensé à cela quand on voit leur intersaison, car en plus de rajouter un max de monde dans le pieu, ils n’ont surtout pas changé les draps. Et si les noms couchés sur les feuilles de match ont de la gueule, le réveil va rapidement être brutal dans un exercice laborieux, voire cauchemardesque certains soirs. Récit en trois temps d’une saison bien loin d’être régulière.
Un lancement chaotique et des rotations à trouver
Si certaines franchises capitalisent sur une cohésion qui leur permet de lancer parfaitement leur saison, l’entame des Knicks est loin d’être un long fleuve tranquille. Au contraire, elle pose clairement les bases d’un exercice bien plus compliqué que prévu.
Injury Report
Dès la troisième rencontre de l’année, les Knicks doivent se passer de Latrell Sprewell. Pas l’idéal dans une saison raccourcie et au moment où le roster essaie de construire son identité. Gêné au pied depuis quelques jours, il souffre d’une micro fracture au niveau de son talon droit. Pas besoin d’opération, mais une botte de protection à chausser pendant plusieurs semaines, ce qui repousse d’autant son intégration dans le collectif.
Pendant que Spree repose son pied meurtri, les Knicks apprennent à gagner sans lui et à l’aube de son retour, les chiffres sont sans appel : 0-2 lorsqu’il joue, 9-4 en son absence. Échantillon léger, mais qui pousse tout de même à la réflexion sur la meilleure utilisation possible de l’arrière pour conserver la bonne dynamique. La réponse apparaît de plus en plus limpide : bien que recrue phare de l’été, c’est sur le banc que Sprewell doit débuter les rencontres pour reprendre le flambeau de John Starks. Comment l’ancien des Dubs va-t-il encaisser ce nouveau statut, lui qui est un habitué des starting lineups (390 titularisations sur 400 matchs chez les Warriors) ? La première réponse, à défaut d’être complètement enthousiaste, est politiquement correcte et clôt temporairement toute polémique, surtout quand on connaît le franc parler de l’animal :
Je ferai tout ce qu’il faut. En ce moment je veux juste gagner et m’intégrer au mieux. […] Bien sûr que je veux avoir un impact. Ce n’est pas comme si cette équipe jouait mal. Je veux juste être le joueur qui nous fait passer le niveau supérieur.
Pour autant, le débat persistera tout au long de la saison et la question de savoir si Latrell Sprewell apprécie ce rôle ou pourrait quitter le navire à cause de cette situation reviendra régulièrement sur le tapis.
Off the court
Lorsque la trade deadline arrive, les Knicks n’ont toujours pas trouvé leur rythme de croisière, continuent de galérer à la mène et savent désormais qu’ils vont devoir composer avec l’incertitude sur l’état physique de Pat Ewing. La réponse de Grunfeld ? Faire signer une belle prolongation à Marcus Camby (trente millions de dollars sur six ans pouvant monter jusqu’à quarante-huit en fonction de récompenses) et récupérer les droits sur Mirsad Turkcan des Sixers. Pendant cette quasi-inactivité de la part de son front office, Jeff Van Gundy assiste impuissant à un mouvement d’un tout autre standing chez les voisins du New Jersey : dans un trade à trois, les Nets récupèrent un Stephon Marbury qui déclarait un mois plus tôt vouloir tout faire pour retrouver sa ville de New York. Entre dépit et admiration, le coach des Knicks commente à quelques mètres de Grunfeld:
Ce sont des génies.
Un tacle à peine déguisé envers son General Manager et apprécié comme il se doit par l’intéressé.
New York attaque par une première depuis la saison 1991-92 avec deux contre-performances. Point commun entre celles-ci, elles sont floridiennes, la première à Orlando, la seconde à domicile contre Miami. Dès ces rencontres, on sent que la mayonnaise ne prendra pas aussi facilement qu’espéré. Que le style de jeu de l’équipe n’est pas complètement défini. Certes, des qualités athlétiques sont arrivées à Big Apple, mais comment les utiliser avec un Patrick Ewing qui reste la pierre angulaire de l’effectif ? Difficile de cavaler quand le pivot est sur le terrain, il n’est pas armé pour un rythme trop élevé. Mais du coup si on ralentit la gonfle pour jouer en attaque posée, comment permettre à Latrell Sprewell d’être à l’aise ? On pourrait également poser la question pour Marcus Camby, mais l’ancien Dino ne foule quasiment pas le parquet, Jeff Van Gundy ayant besoin de plus de certitudes sur sa capacité à s’intégrer aux Knicks. C’est donc tout le puzzle imaginé les derniers mois qui semble bien plus difficile à assembler dans une franchise qui n’aime pas patienter et construire avec patience.
Pour ne rien arranger à cette mise en route déjà délicate, Spree doit passer par la case infirmerie dès le 9 février, deux jours après la défaite face au Heat au cours de laquelle il n’a guère brillé (5 points à 2/12 et 4 balles perdues). Quand ta principale recrue est sur le flanc dès le début de la saison, même pour quelques semaines, tu peux tirer la gueule. En effet, ce contretemps ne va pas faciliter la progression collective des troupes de JVG qui va devoir jongler toute la saison avec les voyages à l’infirmerie des uns et des autres, les corps souffrant dans cet exercice condensé après la longue coupure du lock-out et une préparation minimale avant d’attaquer l’exercice. Surtout quand celui-ci offre des rencontres encore plus rapprochées qu’à l’accoutumée.
C’est donc le pépin physique de Latrell Sprewell qui sonne la première alerte médicale. De quoi retarder la mise en place de la cohésion du groupe et les rotations. Mais d’un autre côté, Jeff Van Gundy peut restructurer son cinq de départ de façon plus cohérente avec Larry Johnson qui glisse sur l’aile et Kurt Thomas qui devient titulaire en 4, laissant la raquette de la second unit à Chris Dudley et Marcus Camby. On recentre l’attaque sur Pat Ewing et on a quasiment l’impression de faire un saut dans le passé, avec seulement Thomas qui reprend les basses tâches de Charles Oakley dans la peinture. Un calendrier favorable permet ainsi à New York de bien redresser la tête avec neuf succès en douze matchs et de donner l’impression que la saison est lancée avec un style qui se dégage avant de retrouver le Heat et d’envisager le retour de Spree. On ne le sait pas encore, mais la franchise de Big Apple ne réalisera pas de meilleur run que celui qui vient de se conclure, ni de meilleur mois que ce déjà poussif février (8 victoires pour 5 défaites). À l’inverse, le comeback de Sprewell apporte un nouveau casse-tête, à savoir son rôle. Les résultats obtenus et l’alchimie qui commence à se dégager semblent forger la décision de Jeff Van Gundy : il va utiliser l’ancien des Warriors comme détonateur de la second unit. Le débat sur ce choix ne fait que commencer.
Se frotter au Heat et réintégrer Latrell Sprewell donc, coup sur coup. Deux échéances qui vont tourner au vinaigre. Si mars s’est ouvert par un succès sur les Cavs (le neuvième de la série citée plus haut), les Knicks chutent d’un point à Miami – avec deux échecs cruciaux de Pat Ewing, le premier dans le quatrième quart pour arracher la gagne, le second pour égaliser en prolongation – avant d’en faire de même à Milwaukee alors que Sprewell quitte l’infirmerie pour jouer contre les Bucks, dans sa ville de naissance. Sans grand succès personnel, ni collectif. Comme en Floride, Ewing a eu la victoire au bout des doigts. Et comme en Floride, il n’a pas su faire la différence dans les ultimes secondes. Quelques jours plus tard, alors que les Knicks ne possèdent que trois victoires au-dessus de la ligne de flottaison des 50%, c’est bien plus qu’un shoot manqué qui va perturber Big Apple et son pivot. Tandis que les Daims rendent cette fois-ci visite à la franchise de Manhattan, le numéro 33 va poser une copie blanche, en dehors de ses 29 secondes passées sur le parquet. Son tendon d’Achille qui le gêne depuis une grosse semaine le fait désormais trop souffrir pour jouer et il doit renoncer à poursuivre avec les siens. Ce n’est pas seulement la nouvelle défaite d’un point ce soir-là qui va continuer à creuser les cernes de Jeff Van Gundy, mais tous les aléas qui l’ont entourée. Et la première des questions réclamant une réponse : comment jouer et gagner sans Patrick Ewing ?
Off the court
Jeff Van Gundy ne s’en est jamais caché : le départ de Charles Oakley va être rude pour l’effectif, sur le parquet et dans le vestiaire. Le coach s’est montré dur avec son remplaçant, Marcus Camby ne débarquant pas en terrain conquis, devant faire ses preuves pour gratter des minutes. Comme en outre l’ancien d’UMass ne brille pas par son enthousiasme et son éthique de travail à ses débuts, JVG ne se prive pas pour le critiquer publiquement, limiter son temps de jeu, tout en échangeant avec lui sur ses attentes. Une méthode pas toujours au goût de Grunfeld qui voit là une manœuvre du coach pour le décrédibiliser. Quand on connaît l’historique entre les deux hommes, le cas Camby ne peut qu’attiser les tensions. Pour sa part, le joueur serre les dents sans s’épancher dans la presse, taffe et verra ses efforts payer lors des Playoffs.
Injury Report
Le 9 mars 1999 à New York, les Knicks disputent leur dix-huitième rencontre de la saison et présentent un bilan de dix victoires pour sept défaites. « Peuvent mieux faire » a-t-on envie de mettre sur le bulletin scolaire avant d’affronter les Bucks. Une appréciation qu’on imagine changer en « vont devoir s’en contenter » vingt neuf secondes après le début de ce match face aux Daims, le temps qu’il aura fallu à Patrick Ewing pour jeter l’éponge, beaucoup trop ennuyé par des douleurs au tendon d’Achille gauche. Depuis une petite dizaine de jours, il souffre et serre les dents, mais les choses n’ont fait qu’empirer sans repos ni préparation digne de ce nom pour un joueur vieillissant. Verdict : tendinites. Les médecins laissent le dernier mot à Pat, mais la blessure réclame au moins six semaines de repos. Un temps précieux que la franchise et le pivot n’ont pas, ce dernier optant pour un délai raccourci d’une quinzaine de jours. Initialement, car dès le 20 mars, le numéro 33 refoule le parquet du Madison Square Garden. Un risque assumé par Ewing, mais surtout nécessaire aux yeux de Jeff Van Gundy dans cette saison tronquée. Sauf que chaque match est une torture en plus pour la carcasse du pivot qui perd forcément en vitesse de déplacement et en jump avec ce souci non soigné. Si bien que lorsque mi-avril se pointe avec des Knicks toujours en galère, on se demande ce qu’il a encore dans le réservoir pour maintenir l’équipe à flot, lui qui tourne cette année-là à plus de 34 minutes par match. Un casse-tête pour le coach qui doit tout de même se passer encore de son joueur fétiche pour deux rencontres histoire de lui laisser un minimum de jus pour les Playoffs. Pourtant le billet est loin d’être validé alors que les Knicks vont jouer leur survie. Mais quand le corps dit stop, impossible de lutter contre lui et la franchise de Big Apple fera donc une bonne partie du sprint final sans son taulier.
De grosses claques en redressements
Le début de saison n’est pas qu’une erreur de parcours. En effet, les Knicks vont offrir bien pire à leurs fans et confirmer leur incapacité à trouver la moindre régularité.
Game Time
S’il existe des défaites encourageantes ou frustrantes, aucune ne peut être aussi embarrassante que celle subie par les Knicks sur le parquet des Bulls. On ne parle pas de Taureaux dominants époque Jordan, mais de leurs successeurs avec Randy Brown, Dickey Simpkins ou Bill Wennington pour épauler le vieux Ron Harper et Toni Kukoc dans le cinq de départ. Pas le genre d’armada à effrayer la franchise de Big Apple, même privée de Pat Ewing. Pourtant ce sont bien ces bovins qui vont repartir avec la victoire, 76-63. Entre un second quart à 5 points, une première mi-temps à 22 unités et un troisième acte avec 11 pions, le fond est touché pour les Knicks. Seul le garbage time va permettre à New York de dépasser les 61 points, pire marque de l’histoire de la franchise. Et les 19 tirs réussis égalisent un record de médiocrité en NBA. On peut faire le tour des archives de Big Apple, on parle là de la pire prestation de basket des Knicks, avec un niveau d’intensité et de jeu indigent, même pour cette saison raccourcie et riche en performances dignes d’un match de DM du dimanche matin.
Off the court
Après l’infâme défaite concédée face aux Bulls, Jeff Van Gundy décide de lui-même de dégager Dennis Scott de l’effectif. Pas que le bibendum des Knicks soit responsable de la déconvenue, mais son apport limité à 2,9 pions à 30,9% au tir, couplé à son désintérêt total pour les résultats de l’équipe ne sont plus supportables pour le coach qui se demande s’il ne perd pas son vestiaire ou si ses troupes ont conscience des enjeux. Un mouvement parfait pour donner une raison supplémentaire à Ernie Grunfeld de se débarrasser de lui. Le General Manager ne se prive pas d’ailleurs pour demander des explications à JVG, tout en réclamant la tête du coach à Dave Checketts en scred, persuadé que le technicien veut sa peau.
Mais le boss du MSG, bien que déçu du début de saison et du niveau de jeu affiché, n’est pas convaincu que se séparer de Jeff soit la solution. Il souhaite prendre un peu de recul et constate que les blessures n’ont pas permis à l’équipe de progresser dans la continuité. Checketts pense aussi que Van Gundy a encore le soutien de la majorité des joueurs. Enfin, le patron se pose de plus en plus de questions sur la capacité de Grunfeld à agir avec clairvoyance plutôt que dans la colère. Tout de même concerné par la situation, il décide de faire un tour au centre d’entraînement pour échanger avec le coach, ce qui va bien évidemment alimenter les rumeurs d’une éviction à venir de JVG. Entretien qui va valider son point de vue : faire sauter Van Gundy maintenant ne va pas résoudre tous les problèmes. Une victoire sérieuse face aux Hornets plus tard, ce sont les leaders qui montent au créneau pour soutenir leur coach, en particulier les anciens, mais également Latrell Sprewell. Le verdict est clair, le vestiaire croit toujours en Jeff Van Gundy. Ernie Grunfeld a voulu jouer en laissant fuiter des infos pour fragiliser son coach et il a perdu, JVG sortant renforcé de cette crise. La cohabitation semble désormais impossible devant un tel manque de confiance entre les deux hommes.
L’affrontement qui suit face aux Wizards fixe les bases des solutions préconisées par Jeff Van Gundy pour s’adapter à l’absence de son franchise player. Si Chris Dudley prend la place de pivot dans le cinq, l’objectif est désormais de s’appuyer sur les qualités athlétiques de la second unit en responsabilisant encore plus Latrell Sprewell et Marcus Camby, en leur offrant un jeu plus rapide et donc plus conforme à leur style. New York dispose d’une arme en moins, il faut alors proposer plus de variété à une attaque souvent stéréotypée et ralentie par le numéro 33. Si la première sortie est plutôt concluante, la claque qui s’enchaîne face aux médiocres Bulls fait plus que ramener tout le monde sur terre. Une défaite qui plonge les Knicks dans la crise, tendant encore plus les relations en coulisses.
Dos au mur, les New-Yorkais se redressent avec trois succès de rang. Leur marque de fabrique cette saison, cette capacité à toujours sortir la tête hors de l’eau au moment où tous les observateurs pensent qu’ils vont couler définitivement. Le tout avant de poursuivre médiocrement par un 3-5 pour boucler le mois malgré le retour de Patrick Ewing lors des sept dernières rencontres et conclure mars sur un bilan quelconque de 8-8. Dont 5-7 avec Pat, de quoi entretenir encore et toujours les spéculations comme quoi New York s’en sortirait mieux sans son encombrant pivot. La schizophrénie made in Big Apple : on se demande comment faire sans Ewing, mais on le critique lorsqu’il est là. Mais ne nous trompons pas, si les Knicks peuvent paraître plus sexy car plus rapides quand Patoche n’est pas sur le parquet, sa présence n’est en aucun cas responsable des maux new-yorkais comme cette incapacité à aller chercher des victoires à l’extérieur. C’est d’ailleurs ce qu’illustre parfaitement le succès d’un point sur les Pacers pour boucler le mois : si le duo Spree – Houston envoie ses 35 pions, ce sont bien les 37 unités accompagnées de 15 rebonds du grand Pat qui valident la win, preuve que pour battre les meilleurs, il faut le meilleur Knick sur le terrain. Malheureusement, une telle performance de l’équipe reste souvent sans lendemain pour New York, victime d’irrégularité chronique.
Si de nombreuses franchises galèrent en 1999 pour afficher une vraie cohésion et un style de jeu clair à cause du lock-out, celle de Big Apple est l’exemple parfait des conséquences d’une préparation tronquée, chaque période d’embellie étant suivie de grands moments de honte. Après l’humiliation chicagoane en mars, c’est du côté de la Caroline du Nord que les Knicks vont de nouveau toucher le fond ou presque avec une défaite cuisante 106-82 alors que les Frelons sont privés de Derrick Coleman ou encore Anthony Mason, out pour la saison. Plus que le score en lui-même, c’est le manque d’envie et de caractère qui embarrasse les hommes de Jeff Van Gundy, des qualités qui ont pourtant fait la réputation des Knicks les années précédentes. L’attitude lors de cette déconvenue remet bien évidemment la tête du coach sur le billot alors que New York pointe à la dixième place à l’Est, tellement loin des objectifs initiaux d’une équipe dont la fierté est portée disparue. Au milieu d’une ambiance au plus bas entre un Patrick Ewing parlant de la soirée la plus déprimante de sa carrière et un Larry Johnson s’excusant publiquement envers son coach pour la prestation pathétique du groupe, un mec refuse de sombrer dans le marasme, paraissant vivre dans un univers parallèle, déconnecté de la réalité new-yorkaise. À contre-courant, Latrell Sprewell est encore loin d’activer le mode panique malgré le signal d’alarme tiré à Manhattan :
Nous n’avons pas beaucoup de temps, mais nous en avons encore pour faire une série. Je ne jette pas encore l’éponge. […] J’ai joué dans des équipes qui perdaient avant. Je sais ce que cela implique. Beaucoup de gars n’ont pas connu des périodes comme cela, moi si. On ne peut pas penser au titre maintenant. Je pense qu’il faut prendre les matchs les uns après les autres, y aller et se dire qu’on construit dessus. Comme je l’ai dit avant, je ne trouve pas que les meilleures équipes de l’Est soient beaucoup plus fortes que nous, surtout quand on joue bien.
Surréaliste. Sprewell se retrouve à être le phare dans l’obscurité des pensées de Gotham, la lumière qu’il faudrait suivre car il connaît la défaite et qu’il garde de l’espoir. Pas sûr que ce décalage ne rassure qui que ce soit à Big Apple. Car l’état des lieux est guère reluisant sur les premiers jours d’avril. Le vieux Patrick Ewing joue sur une jambe et cela impacte sa mobilité, donc sa défense. Houston et Sprewell ne montrent aucun signe de compatibilité, le premier semblant passif tellement souvent quand le second paraît jouer sa partition en solo trop vite pour le reste de l’équipe. Le poste de meneur est aussi médiocre qu’attendu. Les leaders des saisons passées capables de redresser la barre sont sous d’autres cieux. Et on ne parle même pas de l’ambiance en coulisse. Dans une année condensée, la seule solution à tous ces problèmes – ou du moins à une partie – n’est pas au programme : du temps, du temps et encore du temps pour bosser ensemble, progresser et créer l’alchimie dans un groupe en manque de repères. Les joueurs vont tout de même s’en offrir un peu, ou a minima un léger sursis en ne sombrant pas derrière cet accroc en Caroline du Nord.
Comme suite à la défaite contre les Bulls en mars, les Knicks sauvent la tête de leur coach en enchaînant par trois succès consécutifs, conscients de la situation d’urgence. Mais tout n’est pas parfait, les rechutes succédant toujours aux quelques périodes d’optimisme. Lors de la troisième victoire, Pat Ewing aggrave son souci au tendon et quitte les siens au bout de douze minutes. De nouveau les doutes viennent hanter le Madison Square Garden. C’est sans lui que les Knicks perdent les deux rencontres suivantes, avant de poursuivre sur deux autres revers à son retour. Il reste huit matchs à jouer, New York est neuvième à l’Est à égalité avec Toronto et Charlotte, derrière Cleveland. Les Playoffs ? Toujours jouables, mais pour y faire quoi ? La coupe est pleine, le groupe doit exploser dès la fin de la saison. Le grand ménage est attendu du parquet aux coulisses pour reconstruire sur des bases nouvelles en attaquant l’ère post-Ewing.
Off the court
La défaite à Chicago n’est pas la seule déconvenue de la saison new-yorkaise. Un petit mois plus tard, c’est sur le parquet des Hornets que les Knicks retrouvent leur niveau immonde, ne sauvant même pas la face en terme d’investissement. Et sans surprise, on retrouve Jeff Van Gundy sur la sellette, même si Ernie Grunfeld a lui aussi chaud au postérieur si l’on en croit la presse qui tire à boulets rouges sur les deux hommes. Ce n’est qu’une question de jours pour que l’un des deux saute, et à Vegas la cote penche en faveur du coach. Pourtant, quelques jours avant, Patrick Ewing a lui-même pris les choses en main pour mettre fin à cette situation, appelant Dave Checketts et obtenant du boss l’assurance de ne pas dégager l’entraîneur malgré la pression des médias ou encore les bruits de couloirs insistants au sujet d’une venue de Phil Jackson.
Rien ne va se passer. J’ai parlé à Dave et il m’a garanti que rien ne bougerait. Jeff est le coach pour lequel je veux jouer. Je ne jouerai pas pour Phil Jackson. Phil Jackson peut rembarquer ses fesses à Chicago.
Le proprio va même surenchérir pour calmer le jeu en mettant tout le monde dans le même bateau. Ce n’est pas le match à Charlotte qui va le faire changer d’avis. Il est certes déçu mais il ne voit pas un unique responsable, s’incluant dans les personnes qui pourraient être menacées puisqu’il a approuvé l’effectif mis en place. De la frustration, des résultats bien en-dessous des attentes et une franchise en alerte oui. Des têtes qui sautent, ce n’est pas – encore – d’actualité.
Le sprint de la survie
Dans l’adversité, les Knicks ont trouvé les ressources et le cœur pour lancer et réussir une mission survie. Avec un final bien maîtrisé contrairement au reste de la saison, New York sauve les apparences et la qualification en Playoffs.
Off the court
À huit matchs de la fin de la saison régulière, les Knicks doivent lancer leur sprint et la qualification se jouera sur le parquet. Il est trop tard pour une révolution dans les coulisses qui apporterait une nouvelle dynamique. C’est en tout cas l’avis général ce 20 avril, beaucoup attendant un échec et l’absence de joutes en Playoffs pour voir enfin les têtes tomber. Et quand bien même la franchise gagnerait le droit de se faire détruire au premier tour, cela n’offrirait qu’un sursis à Jeff Van Gundy, tout comme à Ernie Grunfeld. Ce dernier a comme toujours botté en touche les questions des journalistes sur son avenir et celui du coach, préférant se concentrer sur un futur bien plus proche et les rencontres à venir, persuadé que tout mouvement potentiel attendra. Mais quelques heures plus tard, alors que son boss et ami Dave Checketts l’a convié à un dîner, le couperet tombe entre deux plats :
Ernie je suis désolé, mais je dois te laisser partir.
Le désormais ex-GM a beau plaider sa cause, rien n’y change. Dans l’esprit de Checketts, l’éviction de Grunfeld va retirer une bonne part de stress et d’emmerdes à Jeff Van Gundy pour qu’il dispose d’un maximum d’atouts pour mener à bien une mission qui aurait dû être une formalité : envoyer les Knicks en Playoffs. Corollaire : en cas d’échec, Jeff sera aussi tenu responsable et sautera. S’il a survécu, son poste reste en sursis et la rumeur Phil Jackson revient avec insistance, la presse imaginant le Maître Zen quitter son congé sabbatique pour prendre les pleins pouvoirs à Gotham. Une possibilité éludée par Checketts lors de la conférence de presse pour annoncer le changement de mission d’Ernie Grunfeld. À trop vouloir la tête de JVG, c’est finalement la sienne qui a été coupée. Même si le coach déclare que les tensions – exagérées – ont été causées par les défaites et non l’inverse, c’est bien l’incompatibilité entre les deux hommes qui compte au moment du verdict. Comme Van Gundy dispose en sa faveur du soutien de nombreux joueurs de l’effectif et d’une promesse de Checketts faite à Pat Ewing sur l’avenir du coach, Grunfeld – relégué au poste de consultant spécial, joli nom pour une mise au placard – ne faisait plus le poids, peu importe son amitié avec le boss de la maison.
Game Time
Pat Ewing au repos car incapable de tenir la distance en cette fin de saison régulière pour les Knicks, c’est un déplacement périlleux en Floride qui se profile pour les hommes de Jeff Van Gundy, eux qui galèrent loin de leurs bases. La première moitié du match le confirme et l’écart continue même de grossir au retour des vestiaires. Miami ne compte pas faire de cadeau à son rival et tous les titulaires passent presque quarante minutes chacun sur le parquet. Malgré cette adversité, les Knicks finissent par répondre présents. Menés 55 à 35 en début de seconde mi-temps, baladés et complètement hors du coup, les hommes de Jeff Van Gundy semblent se diriger inexorablement vers une nouvelle défaite douloureuse à l’extérieur. Devant la débâcle, l’homme affectueusement surnommé le pin’s par Michael Jordan lâche les chevaux. Exit Dudley et Ward, il boucle la fin de la rencontre en s’appuyant sur une rotation de six gars capables d’apporter plus de rythme et de dynamisme, Chris Childs, Latrell Sprewell et Marcus Camby ajoutant le soutien nécessaire aux titulaires Larry Johnson, Allan Houston et Kurt Thomas. L’ancien du Heat réalise d’ailleurs un taf monstrueux en limitant à deux petits points (contre 27 en milieu du troisième quart) un Mourning qui finit par griller un câble, comme aux plus belles heures où Charles Oakley venait titiller le pivot floridien. Après Zo, c’est avec Mashburn que Kurt fait chauffer la température laissant penser qu’une nouvelle soupe de phalanges entre les deux équipes peut éclater alors que New York compte toujours 15 points de retard à sept minutes de la fin. Quatre minutes plus tard, le Heat n’a ajouté qu’un pion à son escarcelle alors que Spree, Camby, Houston et Thomas ont suffisamment alimenté la marque pour que les Knicks ne pointent plus qu’à quatre longueurs, au moment où l’ailier fort de Big Apple doit abandonner les siens en commettant sa sixième faute. Et ce n’est pas un regard ahuri à Joey Crawford qui va changer la donne. Sur un trois points de Tim Hardaway, on pense que le sursaut des Knicks a été vain, mais un and-one de Camby prouve le contraire. Et c’est finalement Chris Childs qui crucifie le Heat sur deux lancers, profitant ensuite d’un échec de Zo et d’un Mashburn qui s’emmêle les pinceaux sur la dernière possession. Dans cet effort collectif et mental, on remarque forcément Larry Johnson qui joue le taulier avec ses 23 points à 10/13 pour que les Knicks finissent par aller chercher un succès capital dans la course aux Playoffs, mais aussi annonciateur de la suite des événements comme le reconnaîtra plus tard Jeff Van Gundy :
C’était le tournant.
Comme toujours cette saison, les Knicks saisissent un moyen de se relever et une fois de plus de changer leur destin. Pourtant le calendrier n’a rien d’une balade digestive. Deux confrontations avec le Heat, une rencontre face aux Pacers et une contre les Hawks, soit trois franchises qui vont finir dans le Top 4 à l’Est. Une en plus contre les Sixers eux aussi en route pour les Playoffs. Une autre plus abordable face à de faibles Celtics. Mais surtout deux chocs avec les Hornets, leurs adversaires pour aller chercher le spot tant désiré pour la postseason. Quatre rencontres à la maison, quatre à l’extérieur. Avec comme bonus la mise à l’écart surprise – par son timing – d’Ernie Grunfeld pour lancer ce sprint. Un contexte bien pourri, mais qui ne fait pas baisser les bras à Larry Johnson qui croit toujours en son équipe :
Tout ce que nous avons à faire, c’est d’arriver en Playoffs. Une fois-là, j’ai le sentiment que nous pouvons nous rassembler et peut-être élever notre niveau de jeu comme personne.
Est-ce que l’électrochoc de l’éviction du General Manager a eu un impact sur le résultat face aux Hornets ? Une chose est sûre, cette première étape soldée par une victoire 110-105 est validée, même si pour cela les Knicks ont eu besoin de rebonds favorables du ballon sur un runner crucial d’Ewing à 24 secondes de la fin alors que le score était de 104-102 pour New York. Un gros coup de chaud quand on sait que la franchise de Big Apple menait de 14 pions en rentrant aux vestiaires, une avance qui est même montée jusqu’à 18 unités. Mais les Hornets qui jouaient eux aussi leur survie ont su revenir dans le match. Pour rien. Ce retour a imposé un temps de jeu conséquent à Patrick Ewing et une surchauffe pour son talon. Conséquence, nouveau repos forcé pour le pivot tandis qu’un déplacement en Floride chez l’ami Pat Riley se dessine. Et quand en plus on se penche sur la feuille de match face aux Frelons et qu’on voit que le pivot a contribué avec Allan Houston à la moitié des points new-yorkais, il y a de quoi grincer des dents pour la suite.
C’est d’ailleurs une déculottée qui prend forme au milieu du troisième quart-temps de cette rencontre sur le parquet du Heat avec un Zo Mourning dans le rôle du punisseur profitant au mieux de l’absence du membre de sa confrérie des Hoyas. Mais contre toute attente, les Knicks vont renverser la tendance pour aller chercher un succès précieux et pas forcément espéré en terre ennemie, un fait assez rare pour être souligné, New York finissant l’exercice avec seulement huit victoires en vingt-cinq déplacements.
Il faut ensuite capitaliser sur ce succès pour le second rendez-vous de ce sprint face aux Hornets, en Caroline du Nord, toujours sans Patrick Ewing. Quand on se souvient comment a fini la dernière visite à Charlotte, la bonne dynamique des deux dernières rencontres n’est pas suffisante pour fanfaronner et jouer les cadors. C’est pourtant bien l’énergie de la fin de match face au Heat qui habite New York pour débuter la confrontation, pliant le premier quart 30-16. Une entrée en matière essentielle assez bien gérée par la suite pour aller chercher un nouveau succès 91-84, malgré un comeback qui prenait forme pour les Hornets. Prochain arrêt, la Géorgie pour défier les Hawks, une valeur sûre à l’Est qui se dirige vers le quatrième spot de la Conférence. Avec un Pat Ewing toujours en mode DNP – talon en mousse, c’est encore un autre Hoya qui a brillé. Après Zo Mourning, Dikembe Mutombo maltraite la raquette des Knicks avec 18 points – 18 rebonds et permet ainsi aux siens de s’imposer dégueulassement 76-73. Sommet de cette purge ? Les 19 pions cumulées par les deux équipes lors du troisième quart. Mais ce qui reste en travers de la gorge des New-Yorkais, outre cette première défaite au cours de leur sprint final, c’est le coup de sifflet de l’arbitre à 9,5 secondes de la fin du match, avec une faute peu évidente d’Allan Houston sur son homologue Steve Smith. Le tout alors que la balle allait sortir du terrain en faveur des Knicks. Problème, cette faute loin du ballon à cet instant du match coûte un lancer, plus la possession. Dans une confrontation aussi serrée, une telle décision a de quoi faire définitivement pencher la rencontre en faveur des coéquipiers du Mont Mutombo.
Pas le temps de gamberger pour autant, car dès le lendemain ce sont les Sixers qui se présentent au Madison Square Garden où la foule attend la confirmation d’un souffle nouveau au sein du groupe. À défaut d’un visage neuf, c’est le retour d’un ancien auquel ont droit les fans du MSG. Celui de Pat Ewing qui revient donner un coup de pouce après ses trois matchs de repos. Sans grande réussite personnelle puisque le pivot finit avec 6 points, 3 rebonds et 1 contre. Autant dire que l’un des pires matchs en carrière du numéro 33 arrive au mauvais moment. On sent d’ailleurs vite que la rencontre ne va pas être une partie de plaisir pour les habitués de la Mecque du basket qui voient les leurs être menés 23-8 au bout de dix minutes, le tout en ayant manqué leurs onze premiers tirs. Pas de quoi donner des envies de pousser. Pourtant, sous l’impulsion de Latrell Sprewell, la donne change et cette foule qui huait les siens quelques minutes plus tôt va finir par se mettre au diapason du numéro 8, hurlant sa rage de vaincre. Auteur de 30 pions à 11/17 en sortie de banc, aussi bien sur des dunks en transition que du parking (3/3 ce soir-là), il lance la charge pour renverser la situation et permettre aux Knicks de conserver le huitième spot à l’Est avec 1,5 victoire d’avance sur les Hornets. Avec quatre rencontres à jouer pour Charlotte et Toronto, trois pour New York.
Sauf que la première correspond à un déplacement dans l’Indiana conclu par une défaite salée 94-71 rappelant qu’en plus d’aller chercher un spot en Playoffs, il serait sympa que celui-ci n’offre pas un désossage gratuit chez les Pacers dès le premier tour tant les hommes de Larry Bird semblent au-dessus de ceux de Jeff Van Gundy. Éviter donc la septième place synonyme de série contre Indiana en se contentant de la huitième pour se frotter au Heat ? Voilà la demande farfelue de certains fans du Madison Square Garden lors de l’avant-dernier match de la saison. Alors que Patrick Ewing continue de donner le maximum quitte à mettre sa santé en danger en sortant un petit match à 27 points et 19 rebonds pour venir à bout des Celtics, une partie du MSG scande :
Nous voulons le Heat !
La place en Playoffs ainsi assurée, l’enceinte retrouve des exigences. Les quémandeurs vont pouvoir au moins voir la franchise floridienne pour la dernière en saison régulière. L’enjeu est simple, savoir donc si le Heat ou les Pacers seront les adversaires de Big Apple pour entamer les Playoffs. L’équation est guère plus compliquée. À 19h débute le match entre les Sixers et les Pistons. Si Philly s’impose, la fin de la rencontre entamée à 20h entre New York et Miami n’aura aucun intérêt, les Knicks terminant alors huitièmes. Mais si la franchise de Pennsylvanie s’incline, Gotham reprend la main et peut arracher le septième spot et une confrontation contre Pacers pour débuter les Playoffs en cas de succès.
Côté Heat, on sent bien que Pat Riley est plutôt fan de la seconde option. Il se déplace d’ailleurs avec une équipe de touristes, Zo Mourning et Tim Hardaway ne prenant point la peine de suer ce soir-là, le premier restant en tenue de ville pendant que le second bien qu’avec son jersey se contente de squatter le banc. Jeff Van Gundy ne se soucie guère de ces calculs d’apothicaire et repose simplement Pat Ewing histoire de redonner un poil d’énergie à son pivot avant les joutes futures. Face à une aussi faible équipe floridienne, cette absence est loin d’être préjudiciable et NY s’impose 101-88. Une victoire pour rien car Allen Iverson a mené les siens avec 33 pions pour triompher des Pistons et ainsi maintenir les Knicks au huitième spot. Au grand dam d’un Pat Riley fataliste à l’idée de retrouver une fois de plus son ancienne franchise :
Cette série est au-dessus de tout contrôle humain. C’est écrit. C’est ce qui doit se passer. C’est quelque chose que les dieux veulent gérer.
Si les Knicks ont sauvé leur honneur et ont montré lors des dernières rencontres qu’ils valaient peut-être mieux que cette qualification à l’arrache via le dernier strapontin, de nombreuses zones d’ombre persistent. La santé d’Ewing. La faible expérience de Sprewell en Playoffs. Celle inexistante de Camby. L’avenir de Van Gundy. Le visage qui va être proposé par la franchise maintenant qu’on remet les compteurs à zéro ou presque.
New York Knicks - Miami Heat
C’était écrit, le Heat et les Knicks ne pouvaient pas échapper à une nouvelle confrontation. Une ligne de plus dans leur rivalité, au grand dam de Pat Riley qui aurait préféré éviter de se frotter une fois de plus à son ex.
Troisième chapitre
Un combat permanent, chaque possession jouée comme si la vie en dépendait, des litres de sueur, des coups pas toujours en douce mais surtout des séries acharnées qui se terminent sur un match décisif quatre saisons consécutives (1997, 1998, 1999 et 2000). Difficile de faire plus intense pour une rivalité unique, l’une des plus féroces de l’histoire de la Ligue à défaut d’être spectaculaire. Tout ce que détestent David Stern et la NBA avec des attaques stéréotypées, une dose bonne dose de vice, quelques gnons et des scores dégueulasses. L’ancien commissionnaire en a encore des nausées.
Pat Riley, l’homme du showtime à Los Angeles, a changé le visage des Knicks… et son style de jeu pour gagner. Finis le spectacle et les paillettes, c’est sur l’intensité, la défense et les muscles qu’il pose les fondations new-yorkaises à partir de 1991. Cette dureté va faire de la franchise de Big Apple l’une des équipes les plus craintes de la Ligue, tellement difficile à manoeuvrer. Une stratégie presque payante, à un Michael Jordan près. Et lorsque ce dernier va s’amuser avec une batte de baseball, les fans du MSG en sont certains : c’est leur tour. Ils iront d’ailleurs jusqu’aux Finales NBA en 1994, mais les Rockets s’imposent en sept matchs, sur le cauchemar de John Starks. Un an plus tard, Pat Riley fait ses valises pour récupérer les pleins pouvoirs au sein de la jeune franchise du Heat qui a débuté en NBA lors de la saison 1988-89. Un départ ? Non, un abandon de celui qui avait promis un titre à Big Apple que ne digéreront jamais les New-Yorkais, une traîtrise de Pat the Rat donnant naissance à une rivalité entre les deux équipes. À l’instar de ses méthodes aux Knicks, Pat Riley va muscler le jeu du Heat en s’appuyant sur les mêmes principes. De la défense et de la dureté, symbolisées par un Zo Mourning arrivé en novembre 1995 et qui sert de pierre angulaire à la construction de l’effectif. Une importance majeure accordée au rebond avec un secteur intérieur d’une solidité à toute épreuve. Des mecs sortis de nulle part qui ne lâchent rien. Un copier/coller des Knicks d’une certaine façon, même si Tim Hardaway apporte une touche de créativité supplémentaire. Miami grandit, New York grogne toujours, et en 1997 les deux enfants de Pat Riley se retrouvent en Playoffs pour une série qui sent bon le barfight. Les deux armées se font face, muscles gonflés, torses bombés.
Tandis que le grand frère new-yorkais semble contrôler la série (3-1 à cet instant), le momentum bascule. Avec un peu moins de deux minutes à jouer dans le Game 5, le Heat mène de douze pions à la maison. Au lieu de laisser filer le match ou du moins d’éviter de prendre des risques pour la suite, les Knicks donnent à David Stern et son gang des munitions pour se faire descendre. On commence avec une expulsion stupide, classique mais sans grande conséquence de Charles Oakley pour deux techniques suite à un coup de sifflet peu apprécié par l’ailier fort et ayant déclenché un premier échange de câlins entre les deux équipes. Alors qu’on pense que la température va redescendre de quelques degrés sur les lancers francs qui suivent tirés par Tim Hardaway, c’est l’inverse qui va se produire. Première tentative transformée. Les joueurs prennent alors place au rebond pour la seconde avec Charlie Ward aux côtés de P.J. Brown. Et tandis qu’Hardaway conclut également ce lancer, le meneur des Knicks pousse son box-out au maximum sur l’intérieur du Heat, en appuyant si possible au niveau des genoux. Pas du goût de Pierre Jérôme qui va envoyer le moustique au premier rang et lancer une nouvelle mêlée. Le rookie John Wallace tout juste entré en jeu à la place de l’expulsé Oakley participe gaiement. Mais sur le banc d’autres joueurs réagissent à tort. Larry Johnson et John Starks essaient de calmer les débats en séparant les joueurs. Allan Houston prend part au boxon à sa façon, pas très agressive non plus. Pat Ewing fait quelques pas sur le parquet pour voir ce qu’il se passe, sans pour autant rejoindre l’attroupement.
Pas du goût de David Stern qui va profiter de l’occasion pour rappeler les nouvelles règles en vigueur sur le sujet, qui découlent justement des comportements du passé chez les Knicks : tout lascar quittant son banc lors d’un moment d’amitié virile prend un match de suspension. Rod Thorn, le shérif du commissionnaire, dégaine sans retenue. Ward et Brown, instigateurs du pugilat, prennent les suspensions directement : un match pour Charlie, deux pour P.J. et sa prise de catch. Les quatre joueurs des Knicks ayant quitté le banc, même s’ils n’ont pas participé au Royal Rumble, prennent aussi un match. Comme une franchise doit disposer de neuf joueurs en uniforme pour une rencontre de Playoffs, les absences sont réparties sur deux confrontations pour les New-Yorkais : Ward passe en priorité, Ewing et Houston complètent le premier jet, la NBA ayant choisi l’ordre alphabétique comme facteur. Le Heat profite de l’absence des deux meilleurs scoreurs des Knicks pour prendre le Game 6 au Madison Square Garden. Pour le Game 7 décisif, ce sont John Starks et Larry Johnson qui ne peuvent aider les leurs, vivant l’élimination sans pouvoir œuvrer. Pat Ewing n’en démord pas, on lui a volé une ultime bataille face aux Bulls de Michael Jordan. Et nombreux dans les rues de Manhattan sont persuadés que Pat Riley a encouragé P.J. Brown à provoquer l’incident, connaissant très bien le caractère des Knicks qui allaient répondre pendant que les joueurs du Heat sont restés tranquillement à la niche. Pas de quoi calmer l’ambiance entre les deux franchises. Ni le ressenti des fans de Big Apple envers leur ancien coach.
Autant dire qu’un an plus tard au moment de se croiser une nouvelle fois, personne ne s’attend à des échanges de câlins. Pas manqué, la salade de gnons est bien au menu entre Larry Johnson et Alonzo Mourning, anciens coéquipiers aux Hornets mais dont les relations ne sont pas au beau fixe. À la fin d’un match âpre finalement remporté par des Knicks amputés d’un Pat Ewing blessé pour l’intégralité de la série, un duel physique sans la balle entre Mourning et Johnson tourne donc au pugilat. Enfin pugilat… en réalité on reste plus sur de la chamaillerie virile qu’un combat de rue, du air fight en mode je ne sais pas ce qui me retient de t’en coller une que d’un vrai match de boxe, mais l’atmosphère entourant la série n’aide pas à calmer l’ambiance.
Jeff Van Gundy a beau s’accrocher aux jambes du pivot du Heat pour mettre fin aux amabilités, cela n’apaise pas les moralisateurs de la NBA qui demandent gentiment mais fermement à Zo et LJ de mater le Game 5 en costard. L’ailier Chris Mills des Knicks bénéficie lui aussi d’un congé pour avoir déserté le banc lors de l’altercation, mais on est dans le détail tant sa présence importe peu. Cette fois-ci, Gotham profite de l’incident et file au tour suivant. Un partout balle au centre, jusqu’à cette série de 1999.
Coach : Pat Riley
Bilan : 33 – 17
Classement : premier de la Division Atlantique, premier de la Conférence Est
Attaque : 89 points (vingt-troisième), 104,7 points pour 100 possessions (neuvième)
Défense : 84 points (deuxième), 98,9 points pour 100 possessions (huitième)
Principales transactions : Signatures de Terry Porter et Clarence Weatherspoon en tant qu’agents libres avant le début de la saison.
Rotation :
Meneur : Tim Hardaway, Terry Porter, Rex Walters
Arrière : Dan Majerle, Voshon Lenard
Ailier : Jamal Mashburn, Keith Askins, Blue Edwards, Mark Davis
Ailier fort : P.J. Brown, Clarence Weatherspoon, Terry Mills, Mark Strickland
Pivot : Alonzo Mourning, Duane Causwell, Marty Colon
Avec un groupe quasi-inchangé pendant la trêve et les ajouts des expérimentés Clarence Weatherspoon et Terry Porter, le Heat vise clairement le titre pour cette saison écourtée en misant justement sur cette continuité. Le début d’exercice confirme la solidité de Miami et les automatismes avec seulement 5 défaites lors des 23 premiers matchs. Grâce à un bilan final de 33 succès pour 17 revers, le Heat s’adjuge au tie-breaker la première place à l’Est et cela malgré de nombreux matchs manqués par Jamal Mashburn (26, touché au genou) et Voshon Lenard (38, fracture de fatigue à la jambe), pourtant prévus comme titulaires. Si le premier a bien retrouvé sa place et sa productivité, le second a lui rétrogradé dans la rotation au profit de Dan Majerle, restant bien loin de ses stats des deux années précédentes. Mais une fois de plus, la force des hommes de South Beach repose sur le duo Tim Hardaway (17,4 points, 7,3 passes) – Alonzo Mourning (20,1 points, 11 rebonds et 3,9 contres). Le pivot repart d’ailleurs avec le titre de meilleur défenseur de la Ligue et seul Karl Malone le devance pour le trophée de MVP.
8 mai 1999, Miami Arena
On le sait, rien n’est écrit d’avance dans les confrontations entre Heat et Knicks. On l’a vu en saison régulière, New York ayant réussi à s’imposer sur le parquet de Miami sans Patrick Ewing alors que la franchise de Big Apple semblait partie pour prendre une rouste.
Justement, on imagine que ce rappel à l’ordre a vacciné les hommes de Pat Riley. Mais le gominé a raison de craindre cette nouvelle série face à son ex, la première manche illustrant parfaitement le faible écart entre les deux franchises. Les Knicks n’ont en effet pas la gueule d’un huitième spot classique, entre sa dose d’expérience mais surtout sa charge en talent bien loin de celles d’une victime habituelle du premier tour juste contente d’être arrivée en Playoffs. Le début est relativement équilibré, et ce sont surtout les deux anciens Hoyas qui alimentent la marque, cherchés régulièrement par leurs coéquipiers. Rien d’étonnant, l’aîné côté Big Apple est la certitude en postseason par son vécu tandis que le plus jeune à South Beach est sur la lancée de sa saison en mode MVP. Comme en plus Tim Hardaway – même s’il refuse d’aborder le sujet – est diminué par des soucis au genou, le Heat abreuve Mourning. Pour autant le duel n’est pas direct entre les deux pivots, Zo étant serré par Kurt Thomas pendant que P.J. Brown se coltine Pat. Un moyen pour les deux coachs de ménager leurs phares. À leurs côtés, les lieutenants ne répondent pas tous avec le même niveau. On l’a évoqué rapidement, mais Tim Bug n’est pas au sommet de sa forme, et à l’instar de ses collègues extérieurs Jamal Mashburn et Dan Majerle, le mode arrosage automatique est activé avec un bien moche 7/37 en cumulé pour les trois sur la rencontre, dont 2/16 du parking. Un Thunder Dan qui porte bien mal son surnom tant il se traîne, touché au dos mais surtout constamment dépassé par Allan Houston. Alors quand Jeff Van Gundy lance les chevaux avec les mobylettes Childs, Spree et Camby pour la second unit, le Heat ne peut suivre et un premier écart se crée. 23-13 en faveur des visiteurs après douze minutes grâce à un ultime panier de Larry Johnson au buzzer.
Ce +10 va continuer à grossir, le Heat ne tenant pas le rythme des Knicks qui proposent pour cette entrée en matière leur meilleure partition collective depuis le début de l’année. La confiance est-là, la concentration aussi, et les pièces du puzzle imaginé par Dave Checketts, Ernie Grunfeld et Jeff Van Gundy s’emboîtent enfin avec alternance intérieur-extérieur, jeu rapide et attaque placée. Tout n’est pas parfait, mais il y a de la cohérence, de la cohésion. L’inverse de Miami où seul Zo Mourning surnage, auteur de 16 des 31 points du Heat à la mi-temps. New York est déjà loin, avec 17 longueurs d’avance au moment de rejoindre les vestiaires.
Est-ce que Pat Riley a trouvé les mots pour relancer la machine ? On y croit l’espace d’un instant, mais on sent rapidement que les Knicks ont la main sur la rencontre. Lorsqu’il faut un gros shoot pour calmer le Heat, il rentre. Tout l’inverse pour les locaux qui ratent des lay-ups ou tirs faciles au moment d’inverser le momentum. L’écart se maintient, Pat Ewing et son tendon d’Achille prennent un peu de repos. Sans être complètement en rythme, le pivot a joué le role player de luxe avec ses 15 rebonds et 4 contres pour accompagner ses 9 pions. Son apport potentiel était en question avant la série, à l’image de son état physique, mais sa présence reste un bonus non-négligeable pour Jeff Van Gundy, surtout quand Sprewell et Houston font le taf en mettant à mal le backcourt floridien par leur vivacité.
Miami finit par craquer complètement, comme le prouve l’expulsion de P.J. Brown suite à deux techniques, la première pour avoir voulu s’offrir un nouveau combat de catch face à un meneur new-yorkais, la seconde car l’arbitre n’a pas apprécié les mots doux que l’intérieur lui a glissé à l’oreille. Les sifflets descendent des travées de la Miami Arena, en particulier après un airball de Tim Hardaway. Et à l’inverse, elles acclament la sortie de Pat Ewing avec des « Let’s go Knicks. » Riley a l’oeil noir et probablement des idées tout aussi sombres. Les gradins se vident, une mauvaise habitude en Floride, et New York conclut sans trembler.
Les joueurs de Big Apple pensaient pouvoir rivaliser avec le Heat avant le début de la série, cette grosse victoire à l’extérieur pour commencer le confirme et envoie un message fort : la saison régulière est derrière nous et on a les crocs pour vous montrer ce qu’on vaut vraiment.
10 mai 1999, Miami Arena
Forts de leur succès initial, les Knicks ont repris la main. Mais cela n’empêche pas les questions avant le Game 2, en particulier autour de Patrick Ewing.
Maintenant que l’avantage du terrain est récupéré, ne vaut-il pas mieux le laisser au repos pour ménager son tendon d’Achille, histoire qu’il soit au taquet lors des rencontres au Madison Square Garden ? Réponse claire : il reste le man in the middle pour ouvrir le match. Pourtant, on le voit clairement diminué et par deux fois en première mi-temps, Jeff Van Gundy le rappelle sur le banc car trop en difficulté dans ses déplacements défensifs. Big Pat grimace et ne goûte guère ce traitement, mais il n’a d’autre choix que d’accepter. En face, on fait profil bas mais les mines sont déterminées. Pat Riley a forcément revu sa copie et placé ses ouailles devant leurs responsabilités. Résultat, le Heat est bien plus appliqué. Plus sérieux. Sans être géniale, la franchise floridienne joue un basket solide, toujours emmenée par Mourning. Le pivot profite rapidement de deux fautes de Thomas qui poussent Van Gundy à partir sur du small ball. Un système où personne ne semble en mesure de ralentir Zo, bien épaulé dans la raquette par Brown, plus d’humeur à mettre des jump shots que des claques aujourd’hui.
Dans le second quart, c’est au tour de Sprewell et Camby d’être rappelés sur le banc par leur coach après avoir pris trois fautes chacun. Autant dire que les solutions tactiques se réduisent pour JVG au moment de contrecarrer les plans de son ancien mentor. En prime Allan Houston est à l’ouest, bien gêné par un Dan Majerle actif en défense à défaut de retrouver sa jeunesse en attaque malgré deux banderilles importantes du parking. Du coup, tout New York vacille et retombe dans les travers de la saison régulière. Des mauvais choix qui s’enchaînent, une cohérence portée disparue, un jeu collectif médiocre… Il suffit juste au Heat de faire preuve d’application et de motivation pour maintenir son avance et gérer la rencontre.
Pourtant les Knicks resserrent la vis dans le troisième quart et reviennent même à -4. Mais quatre pions consécutifs de Miami pour boucler la période offrent le matelas nécessaire avant les douze dernières minutes. Surtout que sur cet ultime quart, les coéquipiers d’un Tim Hardaway en mode chef d’orchestre pour compenser sa maladresse sanctionnent les rotations défensives un peu lentes des visiteurs.
Le Heat n’avait pas le droit à l’erreur, les joueurs n’ont pas flanché. Dos au mur, les hommes de Pat Riley ont répondu dans leur propre style : sans briller, avec dureté, solidité et agressivité. Mais il faudra quand même aller prendre un match à Big Apple.
12 mai 1999, Madison Square Garden
Dans une série au meilleur des cinq matchs, le Game 3 a souvent un rôle de pivot décisif. Alors quand on le joue à la maison en s’étant offert un succès à l’extérieur pour reprendre l’avantage du terrain, il ne faut pas déconner.
Est-ce cela qui rend nerveux Kurt Thomas auteur de deux fautes rapides comme lors de la seconde rencontre ? Le Heat ne se fait pas prier pour pilonner à l’intérieur en se montrant plus agressif au rebond mais aussi plus adroit, pendant que Pat Ewing tente de lancer les siens. Sauf que dans tous ses déplacements, on souffre avec lui et on se dit qu’il va avoir besoin d’une aide bien plus conséquente pour que les Knicks gardent le cap. Un soutien qui va venir de Latrell Sprewell. Spree rentre en jeu pour suppléer un Larry Johnson qui prend à son tour deux fautes et il enchaîne immédiatement par une interception et une faute provoquée sur la contre-attaque. Un coup de fouet qui lance un 9-0 permettant à New York de prendre l’avantage. Mais l’équilibre reste fragile et la sérénité n’est pas toujours présente après un exercice aussi chaotique, comme en atteste la technique sifflée à Pat Ewing pour sa réaction lors d’une faute qui lui est signifiée au cours d’une bataille au rebond. Miami boucle cette période devant, 25 à 20.
Une avance construite au rebond offensif avec déjà 10 prises. Une moisson et une dynamique qui ne vont pas durer. Tout d’abord parce que New York va se réveiller. Ensuite parce que le Heat n’ira chercher qu’un seul rebond sous le panier new-yorkais sur le reste du match. Et c’est d’ailleurs sur une lutte pour un ballon suite à un tir manqué que les Knicks vont se lâcher. Chris Childs finit par arracher le cuir et subissant une faute, il se retrouve sur la ligne des lancers pour deux ficelles qui font passer la série des locaux à 10-0, avant de devenir 12-0 sur un floateur d’Allan Houston pour conclure la mi-temps. Avec un 25-12 sur ce quart, les hommes de Jeff Van Gundy ont repris la main.
Ils insistent au retour des vestiaires. Charlie Ward à trois points, Pat Ewing sur un turnaround ligne de fond puis deux lancers de Houston font grossir encore plus le run en cours et l’écart en faveur des Knicks . Au milieu de cet éclat, Zo prend sa quatrième faute sur une charge provoquée par Ewing qui a réussi à mouvoir sa carcasse latéralement comme au bon vieux temps. C’est le meilleur de New York qu’on voit là et le deuxième effet Kiss Cool est terrible pour Miami qui prend une claque sur un second quart consécutif, 28-11, conséquence d’un 32-2 passé à cheval sur les deux périodes. La défense est solide, la balle circule en attaque avec des joueurs en mouvement. Quelle est l’équipe qui a fini en tête de sa Conférence ? On est prêts à inverser les rôles en matant le match, surtout quand on voit le Heat arroser du parking : un 0/15 pour débuter, qui va se conclure au final à 4/23, la première ficelle tombant à moins de huit minutes de l’issue de la rencontre. Spoiler : ce n’est pas Tim Hardaway qui l’inscrit puisqu’il propose un propre 0/5 pour sa part. Est-ce sa participation à cette entreprise de BTP qui lui fait péter un câble ? À force de vouloir se clasher avec Chris Childs, il se fait expulser après une faute offensive. Une perte de ses nerfs qui lui vaut une grosse réprimande d’un Zo Mourning ayant quant à lui appris à garder son sang froid. Comme lors du Game 1, les Knicks fessent le Heat, un mec craque à Miami et Pat Ewing ne sollicite pas outre mesure son tendon. Pour ne rien arranger du côté des visiteurs, Dan Majerle déjà handicapé par des douleurs au dos a accentué celles-ci après une chute en souhaitant provoquer un passage en force dans le deuxième quart-temps.
Les dynamiques semblent bien opposées au moment de rentrer dormir et Pat Riley va certainement faire des cauchemars de la second unit des Knicks. Les remplaçants de Van Gundy ont maltraité les siens et fait basculer la rencontre quand New York souffrait au rebond et commettait trop de fautes. 2-1 pour les Knicks, avec la possibilité de plier l’affaire à la maison.
14 mai 1999, Madison Square Garden
Quel visage pour les Knicks alors qu’il faut conclure ? Quelle réaction du Heat dos au mur ? Difficile de dire que le statut de favori a changé, mais il est clair que New York regarde Miami droit dans les yeux et que si crainte il y a, elle est désormais dans le camp floridien.
Pourtant, Jeff Van Gundy ne fanfaronne pas. Il sait que son équipe n’a jamais su confirmer cette saison dans une situation confortable et il s’attend donc au pire, évoquant même cette rencontre comme potentiellement sa dernière sur le banc du Madison Square Garden, son avenir s’écrivant toujours en pointillés. Sur le parquet, les cinq de départ restent inchangés pour cette quatrième manche. Ce qui évolue par contre, c’est le rendement de Zo Mourning, bien invisible par rapport à ses prestations précédentes. Tim Hardaway semble toujours en difficulté avec son shoot, mais ses quelques réussites ponctuées de cris de soulagement lui permettent d’exorciser sa frustration. Le match est accroché et aucune franchise ne prend le large, Miami bouclant le premier quart en tête, 25-24.
Une fois de plus, la régularité fait défaut aux Knicks, la fluidité affichée lors du Game 3 pointe aux abonnés absents. L’adresse étant aussi en berne, on a du mal à reconnaître l’équipe séduisante aperçue deux jours plus tôt. Un 14-4 pour New-York nous laisse croire que les hommes de Big Apple mettent enfin leur tête à l’endroit mais cette embellie du second quart ne va pas être éternelle.
La rencontre reste indécise, personne ne semblant en mesure de faire le break, si bien que les locaux attaquent le dernier acte avec un faible matelas de quatre unités. Suffisant ? Que nenni, ils explosent complètement sur les douze minutes suivantes en ne scorant que dix pions, quand Miami va en mettre presque le triple (29). On voit le pire des Knicks, ces moments horribles où personne ne met un pied devant l’autre, où toute notion collective disparaît et où l’on cherche une once de talent dans le roster. On s’empêtre dans la défense resserrée du Heat, on prend des tirs compliqués à la fin des vingt-quatre secondes et Miami donne du rythme de l’autre côté du parquet. New York est dépassé. Les mauvaises décisions s’enchaînent et Jeff Van Gundy ne sait plus quoi faire pour relancer la machine. Même son banc prend l’eau, dominé comme jamais dans la série par celui du Heat. Le vieux Terry Porter se régale, Clarence Weatherspoon profite des soucis de fautes de P.J. Brown pour montrer qu’il a un rôle à jouer, Voshon Lenard retrouve son efficacité le temps d’une soirée.
À deux minutes de la fin, le coach de Big Apple jette l’éponge. Le Madison Square Garden est silencieux. Tout le monde a compris : c’est en Floride qu’il faudra aller chercher la qualification, les Knicks viennent de laisser passer une chance énorme.
16 mai 1999, Miami Arena
Le bilan des Knicks lors d’une rencontre décisive d’une série au meilleur des cinq matchs ? 4-0. Voilà à quoi New York se raccroche en débarquant à la Miami Arena ce 16 mai.
En effet, le contexte ne pousse pas à l’optimisme après la déculottée du Game 4. Surtout qu’en face, c’est une foule hostile qui se dresse du côté de South Beach. Le 10-3 passé par le Heat pour entamer la rencontre confirme que personne n’est là pour se marrer chez les Floridiens. Même Tim Hardaway semble concerné, dans le prolongement de sa fin de Game 4 aboutie. Les Knicks eux envoient des parpaings, un tir réussi sur six pour se mettre en jambes. Miami confirme jusqu’à 14-6. Allan Houston est hors du coup, maladroit et bloqué par le vieux Majerle qui provoque des pertes de balle. 21-8, seul Pat Ewing paraît en mesure de scorer. Le vieux baobab donne ce qu’il peut pour que son équipe garde la tête hors de l’eau. Et il fait bien car en maintenant les siens en vie, il permet aux Knicks de finalement lancer la machine, comme le symbolise le 13-0 qu’ils envoient dans la foulée. Le premier quart laisse les deux franchises dos-à-dos, 23 partout.
Une dynamique qui se poursuit dans la période suivante, Pat Riley devant demander un temps mort après un contre de Camby sur Weatherspoon conclu de l’autre côté du parquet par un lob de Childs pour le jeune big man. L’attaque du Heat patine et les Knicks ont sorti les crocs, bien plus rigoureux en défense. Dans ces instants décisifs, plus personne ne remet en cause le leadership d’Ewing qui tire l’équipe vers le haut, tenant la dragée haute à Zo Mourning, montrant l’exemple même si on sent qu’il est gêné dans ses déplacements. Le match est plaisant, non pas en mode basket champagne, mais on ressent l’intensité même derrière son poste. Dans ces conditions-là, l’engagement est total, la lucidité pas toujours présente et les problèmes de faute s’accumulent. Mourning, Childs et Ward doivent aller calmer leur enthousiasme sur le banc avant la pause alors que Tim Hardaway permet au Heat de rejoindre le vestiaire avec quatre unités d’avance grâce à un shoot au buzzer, 41-37 suite à un 6-0 de Miami.
Au retour de la pause, on cherche encore sur le parquet le petit Allan Houston bloqué à 1/7 au tir. À l’inverse, le Heat bénéficie enfin de l’apport de Jamal Mashburn, porté disparu depuis le début des Playoffs avant d’aller s’asseoir à son tour, prenant sa quatrième faute au milieu du troisième quart. En face, Pat grimace, le tendon tire mais il faut tenir alors que Miami maintient sa légère avance. Il doit finalement aller souffler et se faire examiner, semblant touché aussi au bas du dos. La carcasse grince mais ses coéquipiers vont prendre le relais.
Grâce à un 11-4 pour finir le quart, les Knicks recollent. Les deux franchises sont dos à dos 60 partout au moment d’attaquer l’ultime période. On en est donc là. Après quatre rencontres et trois quarts temps, Miami et New York n’ont toujours pas réussi à se départager. La différence doit se faire sur douze minutes, l’intensité monte encore d’un cran, chaque balle qui traîne, chaque rebond donnent lieu à une lutte acharnée. Et chaque panier du Heat déchaîne la foule. Un public qui peut s’enjailler sur le 9-2 proposé par les hommes de Pat Riley pour entamer ce quatrième quart. Un écart conséquent dans une rencontre aussi défensive. Sauf que quelques instants plus tard, le réveil d’Allan Houston permet de combler ce retard via un 7-0 auquel il participe gaiement avec deux jump shots dont il a la maîtrise.
À une minute et trente secondes du dénouement, Pat se retrouve à défendre sur Zo pour la seconde fois consécutive. Alors qu’on imagine le pivot du Heat prendre facilement de vitesse son vieil adversaire, l’aîné résiste. Avec toutes ses tripes, il fait le déplacement nécessaire pour provoquer la perte de balle de Miami qui dépasse l’horloge des 24. New York reste un point derrière et rien n’est joué. Malheureusement pour Ewing, il est moins clutch de l’autre côté du parquet, échouant sur son jump shot. Charlie Ward fait faute sur Porter qui avait hérité du ballon. Le vétéran valide les deux lancers, 77-74 pour les hommes de Pat Riley, moins d’une minute à jouer. Dans la foulée, Sprewell tente sa chance. Échec mais rebond d’Ewing qui subit la faute et convertit les lancers. +1 Miami. Les Knicks posent les barbelés et Tim Hardaway va s’empaler sur le piège tendu par Latrell Sprewell. Time Out, dernière possession ou presque, l’écart étant de moins d’une seconde avec l’horloge du match. New York galère et s’en sort par miracle en récupérant la balle poussée en touche par Porter qui serre Sprewell de près. On vient de dire miracle ? Ce n’est rien à côté de ce qui va suivre. Quatre secondes cinq. Remise en jeu de Ward pour Houston qui s’avance, lance son runner. Le rebond sympathique du ballon fait le reste. Si le Heat dispose de huit dixièmes de seconde pour réaliser un exploit, il n’en est rien.
La prouesse des Knicks est validée. Pour la seconde fois de l’histoire, la tête de série numéro un se fait éliminer au premier tour par le huitième spot.
Game Time
C’est l’histoire d’un shoot qui change l’Histoire. Un shoot dont l’impact est bien plus grand qu’une qualification à la fin d’un match décisif du premier tour des Playoffs. Bien sûr, le game winner d’Allan Houston permet avant tout d’éliminer le Heat lors de ce Game 5, d’avancer à l’étape suivante. Mais il a aussi impacté quelques destinées.
Celle de ce groupe dont tout le monde souhaitait l’explosion quelques semaines plus tôt, pour reconstruire sur de nouvelles bases. Celle de Jeff Van Gundy, qui va rester quelques années supplémentaires à New York quand une défaite l’aurait probablement fait disparaître de la planète NBA. Celle du trade de Marcus Camby, qui n’aurait été qu’un échec alors qu’il va être l’un des moteurs des Knicks sur ces Playoffs. Celle de Latrell Sprewell, qui va s’offrir sa rédemption dans les semaines à venir pour laisser de côté – en partie – sa fraction sombre. Celle d’Allan Houston lui-même, qui embrasse enfin ce rôle de leader, quittant son image de gars trop lisse, ou du moins qui semble pour cette soirée justifier les espoirs placés en lui lors de la free agency 1996.
Pourtant on aurait pu attendre un autre joueur pour prendre ce tir décisif. Habituellement, c’est plutôt dans les mains du vieux Pat Ewing que la gonfle atterrit lorsque le match est sur la corde raide. Cela a été le cas à de nombreuses reprises lors de la saison régulière écoulée, avec plus ou moins de succès. À cet instant du match, Pat est à 9/19 alors que l’arrière présente un moins glorieux 4/12. Sans temps mort avec une remise en jeu dans le camp du Heat à quatre secondes et demi de la fin, mené 77-76, Jeff Van Gundy réclame un « Triangle down ». Un schéma qui doit permettre à un joueur de sortir en possession de la balle après un écran. Pat Ewing joue l’ostéopathe, Charlie Ward remet la balle en jeu dans les mains d’Allan Houston, parti de sous le panier et ayant profité de l’écran de son pivot pour prendre un peu d’avance sur Dan Majerle. À la limite de la ligne des 3-points, il pose un dribble entre Thunder Dan et Tim Hardaway pour s’avancer, s’élève dans sa course et lance son floater. La balle rebondit sur l’avant du cercle, caresse le panneau et retombe. La ficelle tremble. Allan Houston sprinte de l’autre côté du parquet, bombe le torse et donne un coup de poing. Ça y est il est un Knick, avec la dose d’arrogance qui caractérise cette équipe. Comment ne pas l’adopter alors qu’il vient d’éliminer l’ennemi floridien ?
New York knicks - Atlanta Hawks
Après un premier tour acharné face au Heat, les Knicks ont pris de l’assurance. Et ce ne sont pas les Hawks, équipe solide mais sans grand génie, qui va leur faire peur. Résultat : un bon coup de balai.
Une série sans relief ?
Quand on a vibré devant les Knicks terrassant leurs rivaux floridiens à la dernière seconde, on a du mal à s’emballer pour ce second tour contre les Hawks. Est-ce que cela va aussi peser dans les têtes new-yorkaises, tant on a admiré l’irrégularité des hommes de Jeff Van Gundy cette saison ?
Si la qualification a levé des doutes sur le niveau des Knicks, confirmant qu’au complet et concernée l’équipe avait fière allure, toutes les interrogations autour de la franchise de Big Apple ne sont pas levées. Car même si un obstacle majeur a été franchi, cela n’est pas dû à la fin de l’irrégularité des prestations puisque les grosses performances collectives ont encore été suivies par des matchs bien moins aboutis. On se demande même si Patrick Ewing et les siens seront aussi motivés que face au Heat au moment d’affronter un adversaire moins prestigieux et contre lequel l’animosité n’est pas aussi forte. En parlant du pivot justement, on ne sait pas si son tendon va continuer de tenir ni quel niveau sera le sien. Une question importante car c’est encore un ancien pensionnaire de Georgetown qui se présente à lui après Alonzo Mourning : son ami de longue date Dikembe Mutombo. Attention, cette connivence dans la vie ne se traduit pas sur les parquets où les deux intérieurs se comportent comme de féroces compétiteurs. Les Hoyas détiennent-ils les clefs de la série ? Peut-être, mais un autre duel attire le regard, plus loin du cercle. À l’instar des Knicks avec Allan Houston, les Hawks disposent d’un excellent arrière shooteur pour alimenter la marque en la personne de Steve Smith. Si le shooting guard d’Atlanta en a chié à ses débuts à cause de soucis aux genoux, il a fini par s’affirmer comme une valeur sûre de la Ligue au point d’obtenir son statut étoilé en 1998. Pour compléter le « Big Three » des Faucons, on trouve Mookie Blaylock à la mène, un joueur souvent sous-estimé mais certainement l’un des meilleurs défenseurs extérieurs en NBA et qui n’est pas un peintre non plus en attaque.
C’est à peu près tout ce que la franchise de Géorgie possède en rayon pour se frotter aux Knicks. En effet, amputée d’Allan Henderson et LaPhonso Ellis, leur rotation bât de l’aile et les solutions ne sont pas infinies, même pour un grand coach comme Lenny Wilkens. Et à la vue de l’axe 1-5 composé de Blaylock et Mutombo, peu de doute sur la stratégie habituelle du technicien d’Atlanta pour gagner des rencontres : imposer un rythme lent et poser les barbelés en défense. Les confrontations entre les deux franchises en saison régulière confirment clairement cette tendance et l’on se prépare déjà au pire en terme d’indigence offensive dans cette série. À un détail près, les hommes de Jeff Van Gundy étant en mode révolutionnaires du côté de Big Apple puisqu’ils cavalent bien plus depuis quelques semaines, et surtout comme on ne se souvient plus avoir vu une équipe courir au Madison Square Garden en Playoffs depuis des lustres.
Alors, se dirige-t-on simplement vers une confrontation défensive et sans vraiment de piment ? Rassurez-vous, avec les Knicks on trouve toujours de quoi relever un peu la sauce. Si le cocktail n’est pas aussi explosif que face au Heat, on ne peut s’empêcher de se rappeler les propos d’un Chris Childs berchu après avoir rencontré le coude de Dikembe Mutombo durant la saison régulière :
Vous verrez la prochaine fois qu’on les jouera. Je vais appeler Don King. Je vais lui rendre ça. Je ne serai peut-être pas capable de l’atteindre lui ou sa bouche, mais je vais lui rendre ça.
Un coup sale et vicieux en préparation de la part du meneur ? On imagine qu’il serait bien capable de se contenter d’un nouvel upset en faveur de New York pour poursuivre le parcours en Playoffs, mais cette réflexion nous donne au moins une raison d’attendre un peu de relief dans cette demi-finale de Conférence Est entre les Hawks et les Knicks.
Coach : Lenny Wilkens
Bilan : 31 – 19
Classement : deuxième de la Division Centrale, quatrième de la Conférence Est
Attaque : 86,3 points (vingt-huitième), 100,5 points pour 100 possessions (dix-neuvième)
Défense : 83,4 points (premier), 97,1 points pour 100 possessions (deuxième)
Principales transactions : Signatures de Grant Long, LaPhonso Ellis, Anthony Johnson et Mark West en tant qu’agents libres avant le début de la saison. Départ de Christian Laettner (trade).
Rotation :
Meneur : Mookie Blaylock, Anthony Johnson
Arrière : Steve Smith, Ed Gray, Jeff Shepard
Ailier : Alan Henderson, Tyrone Corbin, Roshown McLeod
Ailier fort : LaPhonso Ellis, Grant Long, Chris Crawford
Pivot : Dikembe Mutombo, Mark West
Depuis 1992-93, les Hawks sont des habitués des Playoffs où ils ne font jamais de merveilles. Cela se confirme d’autant plus avec des saisons régulières abouties mais toujours pas de grand pas en avant lors des joutes printanières sous les ordres du coach Hall of Famer Lenny Wilkens, arrivé à l’été 1993, et la signature en tant qu’agent libre de Dikembe Mutombo en 1996. Deux noms qui donnent le ton du style de jeu de la franchise de Géorgie où la défense est clairement une priorité par rapport à l’attaque, ce qui se valide lors de cette saison raccourcie. Il faut dire qu’en plus du Congolais dans la raquette, c’est Mookie Blaylock qui complète l’axe 1-5 le plus solide de la Ligue lorsqu’il s’agit de pourrir la vie des attaques adverses. Steve Smith apporte la touche smooth pour scorer alors qu’Alan Henderson et LaPhonso Ellis complètent un cinq de départ très homogène. Du moins en théorie car ces deux derniers vont suivre la plus grande partie de l’année depuis le banc, voyant leur exercice se terminer de façon précoce. Vision trouble de l’œil gauche pour Alan, hernie pour LaPhonso. Soit deux titulaires qui vont vite faire défaut et obliger Wilkens à bricoler et intégrer le jeune Chris Crawford ou les vieux Grant Long et Tyrone Corbin dans son cinq et dépeupler ainsi son banc. Suffisant en saison régulière, assez pour passer – lors du match décisif – le premier tour des Playoffs contre les Pistons. Mais clairement pas au niveau pour nourrir de vraies ambitions dans une année marquée par le partage des matchs à domicile entre le Georgia Dome et le Alexander Memorial Coliseum en attendant la fin de la construction de la Philips Arena (devenue depuis la State Farm Arena).
18 mai 1999, Georgia Dome
Si les Hawks attaquent la série à domicile au Georgia Dome, force est de constater que l’ambiance est plutôt en faveur des Knicks. Il faut dire que vu les tarifs des billets au Madison Square Garden, il revient moins cher pour les fans de se payer le déplacement, l’hôtel et les places à Atlanta qu’à Big Apple.
Est-ce cet accueil chaleureux qui permet à Allan Houston de continuer sur la lancée de son shoot décisif face au Heat ? En tout cas l’arrière est chaud, du moins jusqu’à sa seconde faute prise dans le premier quart-temps. Cela n’entrave pas la marche en avant new-yorkaise, poursuivie avec l’entrée de Sprewell. Le ballon circule bien, les joueurs sont en mouvement et les tirs font ficelle pour les Knicks pendant que Atlanta galère pour scorer. Ce qui n’a rien d’étonnant quand on se souvient à quel point les Hawks ont souffert face aux hommes de Jeff Van Gundy lorsqu’il s’agissait de mettre des paniers dans les confrontations précédentes. En particulier les joueurs extérieurs, Steve Smith ayant par exemple tourné à 26% contre New York lors des trois rencontres de saison régulière. Patrick Ewing rejoint Houston sur le banc également en foul trouble et le jeu offensif des Knicks commence à patiner sans son point d’ancrage, l’alternance intérieur-extérieur ayant quitté le parquet avec lui. Spree continue d’alimenter la marque, trop rapide pour les Faucons en contre-attaque, trouvant aussi des décalages par sa vivacité lorsque le jeu est posé. Atlanta s’accroche mais New York garde la main, 27-21 après douze minutes.
Steve Smith est toujours au sein de son entreprise de travaux publics comme en saison régulière face aux Knicks, bien défendu entre autres par Larry Johnson. Disons que comme ses coéquipiers Tyrone Corbin et Grant Long présentent une menace quasi-nulle, Jeff Van Gundy n’hésite pas à envoyer son ailier plus physique en mission sur l’arrière. Mais les Hawks trouvent une solution inattendue en la personne de Chris Crawford. Le sophomore qui n’a jamais dépassé les dix-huit unités en carrière envoie 20 pions (sur ses 26 du match) en première mi-temps. Revenu en un temps record d’une luxation acromio-claviculaire subie lors du Game 2 face aux Pistons, il est souvent laissé seul par Sprewell qui ne fait pas l’effort de le suivre sur les contre-attaques. Après une bonne dizaine de minutes sur le banc à mater ses coéquipiers courir comme des lapins, Patrick Ewing retrouve le parquet. Il voit juste de plus près pendant quelques instants que la supposée incompatibilité entre Houston et Sprewell est envolée tant les deux arrières font mal aux Hawks. Quant à lui, une troisième faute le renvoie poser son séant à côté de son coach. Quelques secondes plus tard, les Hawks prennent l’avantage suite à une orgie du parking entre Mookie Blaylock et Chris Crawford alors que les Faucons peinaient à neuf longueurs peu de temps avant. Cette dynamique illustre bien les soucis de New York sur ces quelques minutes. L’absence de mouvement en attaque chez les Knicks est flagrante et cause bien du souci à JVG alors que tout roulait un peu plus tôt. Du coup, ce sont les locaux qui virent en tête au moment de souffler, 48-50.
Patrick Ewing ne semble pas avoir pété un coup durant cette pause. Il prend sa quatrième faute et laisse éclater sa frustration en parlant du pays à l’arbitre, histoire de choper en plus une petite technique avant de se rasseoir. Est-ce cela qui continue de dérégler les Knicks ? Atlanta n’en demande pas tant et capitalise en débutant bien mieux ce troisième quart. Autre mauvaise nouvelle pour la franchise de Big Apple, Steve Smith a l’air de trouver son rythme, bien loin de son job de maçon du début de match. Jeff Van Gundy met fin à l’hémorragie avec un temps-mort. Peu importe les mots, ils sont efficaces car ses hommes enchaînent par un 8-0 qui leur permet d’égaliser. Ils continuent sur cette bonne lancée avec Allan Houston en chaleur tandis que Sprewell se refroidit sur la banc, matant les siens durant les neuf premières minutes de cette période. De quoi le frustrer ? On ne le saura jamais, mais à l’instar de Marcus Camby qui voit Chris Dudley rester sur le parquet malgré quatre fautes, Spree ronge son frein et affiche une mine renfermée. Si les joueurs ne laissent pas non plus trop paraître leur agacement, cette situation va pouvoir alimenter les chroniques de Gotham les jours qui suivent. Le troisième quart-temps se termine en tout cas sur un avantage de 80-73 en faveur des Knicks, un total de points qui ressemble plus au score habituel d’une fin de match entre les deux franchises.
Le père Dudley prend finalement sa cinquième faute rapidement dans l’ultime période. Pas de quoi faire plaisir à Camby puisque c’est Pat Ewing qui revient pour provoquer une faute offensive et se prendre sa cinquième personnelle – de façon sévère – quelques minutes plus tard. C’est donc Marcus… ah ben non, Chris Dudley qui prend le relais. Si Allan Houston se repose, Latrell Sprewell est revenu avec les crocs et assure le scoring pour permettre de creuser l’écart. Les deux lascars réalisent d’ailleurs la meilleure performance offensive en Playoffs de leur carrière, avec 34 pions pour Houston et 31 pour Spree. Soit 65 à eux deux, total le plus élevé pour un duo des Knicks en postseason depuis onze ans. Les Hawks pensent revenir dans les dernières minutes mais les Knicks finissent le job avec un ultime coup de main de Pat Ewing, victoire 100-92.
Comme face au Heat, New York récupère l’avantage du terrain dès la première rencontre en atteignant en prime la barre des 100 pions pour seulement la septième fois de l’année.
20 mai 1999, Georgia Dome
Pour ce Game 2, Lenny Wilkens doit réagir afin de ne pas se mettre dans une situation délicate.
Le coach des Hawks adapte donc sa rotation en intégrant Chris Crawford à son cinq de départ à la place d’un Tyrone Corbin inexistant lors de la première rencontre. On imagine qu’il souhaite apporter plus de scoring mais aussi pousser Larry Johnson à s’occuper du sophomore pour libérer Steve Smith, contrairement au match précédent. Dans la colonne changement toujours, on s’attend à voir le rythme évoluer également. Si les Faucons veulent s’imposer, ils ne peuvent pas laisser les Knicks prendre de la vitesse, alors on espère que vous avez bien profité du score de la première rencontre, on passe en mode Nineties Eastern Conference avec un ralentissement du jeu, des barbelés posés et un bon vieux match à moins de 150 pions en cumulé.
Afin de valider cette prémonition, New York attaque par un sublime 0/7 et quatre fautes pendant que Mookie Blaylock inscrit les six premiers points des siens. Le rythme est bien celui de Wilkens, pas d’excès de vitesse. Jeff Van Gundy essaie de bouger tout cela en faisant rentrer Latrell Sprewell à la place de Kurt Thomas et ainsi courir avec une line-up small ball. On arrête tout suspense, c’est un échec car finalement les Knicks continuent leur lancer de parpaings avec un seul tir réussi sur leurs quinze premières tentatives. Allan Houston en panne d’adresse – doublé constamment par les Faucons – participe gaiement au tas de briques pendant que Patrick Ewing tente de maintenir les siens à flot avec l’aide dynamique de Spree. Sauf que comme lors de la première rencontre, Patoche a les oreilles qui sifflent. Ah non, on me glisse en régie que ce sont bien les arbitres qui le sanctionnent et il doit céder sa place à Chris Dudley. Petite consolation, Dikembe Mutombo aussi prend deux fautes, relayé par Mark West. Cela n’empêche pas Atlanta de virer en tête, 20-17 à la fin du premier quart.
Par la suite, l’absence du Mont Mutombo offre plus de place pour pénétrer et Latrell Sprewell en profite, les vieilles cannes et le déambulateur de Tyrone Corbin ne lui permettant pas de suivre l’ancien des Dubs. Marcus Camby, très peu utilisé lors de la première rencontre, participe aussi à cette montée dans les tours du moteur new-yorkais. S’il ne score pas autant que Spree, son activité au rebond et en défense booste son équipe. Dans cette dynamique instaurée par les deux joueurs du banc, les Knicks dictent maintenant le tempo. Pas suffisant pour reprendre la main au tableau d’affichage, mais l’écart se réduit légèrement pour arriver à la mi-temps avec seulement deux unités de retard, 38-36.
En revenant des vestiaires, le retour des cinq majeurs nous replonge dans un rythme de papys et la collection de saucissons peut recommencer de plus belle. La défense prend le pas sur l’attaque, on va souvent au bout de l’horloge des vingt-quatre secondes en la concluant même par des airballs. Donnez-nous vite des anti-vomitifs, on agonise. Si les fans de spectacle ou de basket léché sont au bord de la dépression, les Knicks s’en cognent car ils sont toujours dans la course pour aller chercher une nouvelle victoire à l’extérieur qui les mettrait dans une position idéale. Alors que les Hawks passent un léger run, Jeff Van Gundy réplique rapidement en demandant à Sprewell et Childs de rentrer sur le terrain pour redonner du tempo en cette fin de quart. Bon coaching, New York boucle par un 6-0, portant le score sur cette période dégueulasse à 16 partout. Douze minutes à jouer, deux petits points à rattraper, on a connu pire après avoir déjà volé l’avantage du terrain.
Toujours dans cette optique de vivacité pour faire exploser les Faucons, le coach de Big Apple renvoie aussi Marcus Camby au front. L’occasion pour lui de poser un dunk malsain sur la gueule de Dikembe Mutombo, seule réjouissance artistique de la rencontre. Mais quelle réjouissance ! Alors qu’il reste un peu plus de sept minutes à jouer et que New York mène de quatre pions, l’intérieur des Knicks reçoit une passe de Chris Childs à proximité de la ligne des lancers. Il pose un dribble dans sa course et s’élève. Le Congolais monte au duel mais Camby a décollé tellement haut pour agresser violemment le cercle que le poster est tamponné sur le front de Dikembe.

Cette supériorité athlétique démontrée sur cette action illustre parfaitement l’ascendant que New York prend, les Hawks ne parvenant plus à freiner leurs hôtes en général, Latrell Sprewell et Marcus Camby en particulier. Les gars de Big Apple ont désormais la main sur le match, faisant grossir leur avance jusqu’à onze unités, un écart conséquent dans une confrontation aussi défensive. Un matelas qui est d’ailleurs suffisamment confortable pour gérer tranquillement et repartir à Gotham en menant deux victoires à zéro derrière les 31 pions de Spree, dont 15 sur la ligne des lancers francs.
Un cinquième succès en sept rencontres à l’extérieur lors des Playoffs, alors que New York présentait un bilan de huit matchs remportés pour dix-sept défaites loin du Madison Square Garden en saison régulière. Le changement de visage est total.
23 mai 1999, Madison Square Garden
Difficile d’être optimiste pour Lenny Wilkens au moment d’aborder cette troisième manche. Non seulement les Hawks n’ont pas semblé en mesure de vraiment inquiéter les Knicks lors des deux premières rencontres, quasiment incapables de rentrer un panier, mais en plus les stats ne jouent pas en leur faveur : seules sept franchises ont remonté un 0-2 dans l’histoire.
Encore moins réjouissant, ce chiffre descend à deux lorsque les défaites initiales étaient à domicile. Du coup que peuvent-ils espérer en débarquant au Madison Square Garden ? Au minimum gratter un match et peut-être glisser un peu de doute dans les têtes new-yorkaises, mais il va falloir frapper rapidement car à 3-0, tout espoir de renverser la série serait mort. Et pour cela, il faut que le Big Three des Faucons se réveille. En effet, les trois lascars – Mookie Blaylock, Steve Smith et Dikembe Mutombo – cumulent un sublime 28/87 au tir depuis le début de la confrontation, symbole du manque d’adresse globale de l’équipe qui part sur un record all-time de nullité dans ce secteur sur une série. À l’inverse, pour Jeff Van Gundy la mission est simple sur le papier : maintenir ses troupes focus pour que personne ne se relâche. Une formalité en théorie, mais on sait bien que chez les Knicks cette saison, la mise en pratique ne s’est pas toujours bien déroulée.
Kurt Thomas est le premier à scorer pour les locaux avec 5 points rapides – ses seuls du match – en profitant de son avantage de puissance sur Chris Crawford. Ce dernier est d’ailleurs ciblé par l’attaque des Knicks car bien moins fringant que ses coéquipiers en défense. Comme en plus il est transparent en attaque, le changement opéré par Wilkens quelques jours plus tôt perd tout son sens. Malheureusement pour le coach, il ne possède pas de solution de repli puisque Tyrone Corbin n’est guère plus brillant. Steve Smith retrouve pour sa part son adresse – provisoirement – et alimente la marque pour les Hawks. Le premier quart-temps est tout de même un peu plus enlevé que lors du Game 2 puisque New York boucle ces douze minutes initiales en menant 25 à 22.
Si Steve Smith égalise, Marcus Camby revient hanter les nuits de Dikembe Mutombo avec un nouveau dunk rageur. Atlanta semble enfin dans le bon rythme, du moins quand celui-ci ne s’accélère pas trop car dès que les Knicks peuvent jouer la contre-attaque, les Faucons perdent des plumes et prennent des éclats. Smitty atteint les 15 unités pour maintenir le cap après seulement trois minutes dans cette période et les 17 à la mi-temps. Il est – une fois n’est pas coutume – épaulé par Grant Long qui a repris la place de son fantôme des deux premiers matchs. Cependant, l’arrière des Hawks n’est pas le seul à avoir retrouvé des couleurs, l’adresse étant aussi de nouveau au rendez-vous pour son vis-à-vis Allan Houston, si bien que les Knicks gardent le cap et font doubler leur avantage, 52-46 à la pause.
Au retour des vestiaires, Smith n’a pas la même réussite sur sa première tentative et son échec est annonciateur de minutes bien plus compliquées pour lui puisqu’il ne trouvera plus le chemin du panier d’ici la fin de la rencontre. Difficile de nourrir de grosses ambitions ou même d’espérer s’accrocher pour les Hawks dans ces conditions. New York reprend son pilonnage de Chris Crawford tout en posant les barbelés de l’autre côté du terrain. Le quart-temps est bien moins productif, se concluant sur le score de 14-11 pour les pensionnaires du MSG qui mènent désormais de neuf points.
Un écart qui continue de gonfler pour atteindre 17 pions à huit minutes du terme, puis 18 sur un lancer franc de Chris Dudley qui s’impose ce soir comme le meilleur pivot sur le parquet, profitant grandement d’un temps de jeu conséquent sur cette dernière période du fait de l’avance confortable des Knicks. Il reçoit même sa standing ovation lorsqu’il regagne le banc après avoir pris sa sixième faute de la rencontre. Les no names bouclent la partie, rideau trois minutes avant le buzzer. Grâce à un effort collectif sérieux, New York a fait le taf et le sweep est en préparation.
Il va falloir conclure tout en se coupant des turbulences en coulisse liées à la rumeur Phil Jackson. Car en effet, l’actualité entre le Zen Master et le Président des Knicks a bien plus occupé les fans et les médias que le match durant la soirée.
24 mai 1999, Madison Square Garden
Dans cette saison condensée, les Knicks et les Hawks gagnent le droit de jouer le Game 4 en back-to-back. Probablement une chance d’en finir plus vite tant on a du mal à imaginer Atlanta renverser la tendance.
Illustration très simple de l’écart actuel entre les deux franchises, New York mène tranquillement 3-0 alors que Patrick Ewing ne pèse absolument pas avec 8 points et 6,7 rebonds sur les trois premières rencontres. En même temps, les Faucons eux se demandent comment mettre un ballon dans un panier, ce qui reste pourtant le principe de base du basket. Alors direction sweep malgré la nouvelle distraction liée aux aveux de Checketts concernant Phil Jackson ou sursaut d’orgueil des Piafs ?
L’entame est bien moche des deux côtés. Pour preuve, le public n’a qu’un seul panier dans le jeu à se mettre sous la dent sur les dix premières tentatives du match. À défaut de mater les filets vibrer, on voit bien Pat Ewing grimacer et ne pas se mêler à la lutte en attaque par moment, mais il reste présent et efficace lorsqu’il s’agit d’envoyer un jumper. C’est avant tout Allan Houston qui alimente la marque pour les Knicks pendant que son vis-à-vis Steve Smith essaie de lui rendre la pareille. Sauf que l’arrière d’Atlanta réactive le mode BTP au fil de la rencontre qu’il va boucler sur un 5/20, portant ainsi son total sur la série à 20/74, soit 27% de réussite. Moche, très moche. Le premier quart est bouclé sur le score de 25-18, un écart non négligeable en faveur de New York.
Comme lors des rencontres précédentes, les accélérations de la second unit new-yorkaise cassent les reins des Oisillons qui explosent dès que Spree ou Camby, pourtant moins à leur avantage ce soir-là, appuient sur le champignon. Atlanta tente de durcir la défense mais cela n’impressionne pas les locaux et ne change pas le cours du match, surtout avec Mutombo sur le banc pour cause de problème de fautes. On baille doucement devant la rencontre gérée au petit trot, simplement réveillé par un dunk signature de Latrell Sprewell après une interception ou l’énervement du pivot des Hawks qui se retrouve au sol après une faute de Childs. Une vengeance personnelle du meneur pour sa dent perdue lors de la saison régulière sur un coup de coude du Congolais ? Même pas, le ralenti montre juste une chute malheureuse et sans conséquence. La mi-temps n’est pas atteinte mais l’issue de la rencontre semble déjà inéluctable : Atlanta n’a pas la qualité nécessaire pour rattraper son retard et sauver son honneur. Il ne reste plus qu’à attendre pour ramasser les plumes des Faucons. Et encore, les Knicks n’ont pas capitalisé outre mesure sur la médiocrité de leurs adversaires, assurant tranquillement l’essentiel pour aller pisser un coup en menant 48-37.
Après cette pause, on repart sur les mêmes bases, Atlanta incapable de mettre un tir, New York faisant le minimum, sans se forcer. Ce qui est largement suffisant tant les Hawks sont inoffensifs. La faillite est totale pour les hommes d’un Lenny Wilkens qui semble sans solution, impuissant sur son banc. À croire qu’il s’ennuie autant que nous et qu’il attend que ça se termine, probablement en se demandant ce qu’aurait pu être sa saison si Alan Henderson et LaPhonso Ellis n’avaient pas squatté l’infirmerie toute l’année ou presque. Dans la fadeur de ce troisième quart-temps, on note tout de même les premiers lancers francs tentés par Pat Ewing sur la série, preuve de la nouvelle diversité de l’attaque des Knicks, mais surtout du retrait du pivot dans le jeu new-yorkais. D’une part à cause de l’émergence des recrues Latrell Sprewell et Marcus Camby, enfin à l’aise dans leurs rôles – sans oublier un Allan Houston prenant du galon – mais aussi à cause de son tendon d’Achille qui lui donne maintenant une démarche si bancale. Plus que douze minutes à s’emmerder, 66-51 pour les Knicks.
On ne va rien voir de bien plus intéressant sur le parquet durant la dernière période. Le spectacle est plutôt en tribune, d’où descendent des « We want Reggie », le Madison Square Garden espérant certainement plus d’intensité pour la suite, convaincu que le coup de balai est acté. C’est d’ailleurs le chant suivant qui résonne, à base de « sweep » alors que l’avantage est de 24 unités et que les Hawks viennent de passer plus de dix minutes sans scorer dans le jeu. Après ce moment chambrage, c’est l’instant émotion qui arrive. En réponse à l’affaire Checketts-Jackson, le public s’exprime à la gloire de Jeff Van Gundy, envoyant un message fort à la direction. « Jeff Van Gundy ! Jeff Van Gundy ! », le MSG se lève, Kim Van Gundy – la femme de Jeff – est en pleurs et Pat Ewing lui adresse un signe de réconfort. Le coach feint-il de ne pas entendre ? Il ne laisse rien paraître, disant plus tard qu’il était dans le match et n’a pas prêté attention au brouhaha. Pas grave, ses joueurs reprennent le chant dans les vestiaires pour qu’il puisse profiter de ce moment qui est aussi – surtout – le sien, lui qui a tenu bon malgré les rumeurs et manœuvres, jusqu’à permettre à ses ouailles de rentrer dans les livres avec cette qualification. Car oui, New York remporte cette rencontre 79-66.
Pour la première fois depuis cinq ans, les Knicks atteignent les finales de Conférence. Et pour la première fois de l’histoire, un huitième spot arrive à ce niveau de la compétition.
Off the court
Toute la saison, le nom de Phil Jackson est revenu avec insistance du côté de Big Apple, chaque crise sportive apportant dans son sillage les rumeurs sur le Zen Master, jusqu’à ce que les potins deviennent plus concrets.
Ancien joueur des Knicks, le gourou de Bulls six fois titrés en huit ans s’est offert un peu de repos lorsque la franchise de l’Illinois a été démantelée suite à sa dernière bague. Pour le front office new-yorkais, l’alignement des planètes semble parfait pour enfin retrouver un coach de la trempe de Pat Riley, se débarrasser de Jeff Van Gundy et son charisme d’inspecteur des impôts qui ne sied pas au standing du Madison Square Garden. Les médias ont clairement creusé pour enterrer JVG et Ernie Grunfeld – parfois à juste titre – se léchant les babines de voir débarquer le Zen Master, ennemi juré de Van Gundy, sur le banc de Gotham. Entre « Big Chief Triangle » – surnom donné par le coach des Knicks à Jackson – et « Gumby » – la réponse du berger à la bergère – il n’y a jamais eu d’amour fou. Ni même de respect. Forcément, entendre constamment le nom de l’ancien gourou des Bulls revenir dans les discussions n’a pas dû plaire des masses à Jeff.
Alors que le ciel semble enfin se dégager au-dessus de New York au milieu de la confrontation face aux Hawks, la bombe Phil Jackson finit par exploser au Madison Square Garden pour faire de cette rumeur l’attraction numéro un lors de la fin de la série. Le New York Times et le Daily News sont formels, les bruits de couloirs faisant le lien entre les Knicks et le Zen Master ne sont pas totalement infondés. Loin de là même. Avant le licenciement de Grunfeld, Checketts a bien vu Phil Jackson et son agent. Une discussion de deux heures qui n’a jamais abouti à une offre d’emploi. Sauf qu’au moment où l’histoire sort, le boss des Knicks ne trouve rien de mieux à faire que laisser les siens gérer seuls cette crise. Et oui, le Game 3 de la confrontation face aux Faucons – le lendemain de la fuite – se déroule un dimanche, jour loin du boulot pour le Mormon. C’est via un communiqué lu par le porte-parole Barry Watkins que Checketts dément l’information… avant d’être obligé de lâcher le morceau au cours du match, sollicité – ou harcelé c’est au choix – par un journaliste de NBC. Oui, il a bien échangé avec Phil Jackson, mais seulement par l’intermédiaire d’une tierce personne. Un Phil Jackson intéressé selon les dires de Checketts qui comptait le revoir une fois l’exercice fini. Des aveux tardifs mal perçus au sein des fans. Pas seulement parce que le président du Garden s’est renseigné sur l’ancien ennemi, mais surtout parce qu’il a menti. À Van Gundy. À Ewing. À la Knicks nation. Les excuses et la nouvelle version apportée le lundi – oui, il a bien discuté en direct avec Phil Jackson – n’y changeront rien. Au contraire, c’est Jeff Van Gundy qui sort grandi de cette nouvelle crise. Le bosseur acharné qui doit trimer pour faire avancer son équipe pendant qu’on lui savonne la planche en haut lieu. Et le Madison Square Garden ne s’y trompe pas en hurlant le nom du coach à quelques instants du sweep face aux Hawks.
Comme avant la fin de l’épopée new-yorkaise de 1999, le Zen Master signe finalement son contrat de baby sitter pour Kobe et Shaq aux Lakers, JVG peut être soulagé. Quant au retour de Phil Jackson à New York de longues années plus tard dans un autre registre, nous préférons le passer sous silence par respect pour le basket à Big Apple.
New York Knicks - Indiana Pacers
La balade de santé face aux Hawks étant terminée, New York doit se frotter à un morceau bien plus coriace. Les Pacers ne sont pas arrivés jusque-là par hasard et ils ambitionnent clairement d’aller chercher le titre cette année, objectif annoncé dans l’Indiana. C’est donc une bonne petite série entre amis qui se prépare.
Coucou Reggie
Lorsque l’on évoque la rivalité entre les Pacers et les Knicks, on se demande si le clash ne concerne pas uniquement Reggie Miller et la franchise de Big Apple. Bien entendu il existe un véritable antagonisme entre les fans, les villes et les états : les bouseux d’un côté, le centre du monde de l’autre pour caricaturer. Mais si les confrontations entre les deux équipes ont pris une telle ampleur, cela est dû aux prestations et au caractère de l’arrière des Hoosiers qui a sorti quelques performances de premier choix ayant marqué les esprits ainsi que la légende des Playoffs.
C’est en 1994, alors que Michael Jordan est à la retraite, que le frère de Cheryl tient à rappeler aux fans du Madison Square Garden qu’il existe encore un shooting guard talentueux capable de mettre à mal leurs ambitions à l’Est. Si au bout du compte les Knicks se qualifient en sept manches et gagnent le droit d’affronter les Rockets lors des Finales NBA, les 25 pions de Reggie lors du quatrième quart-temps du Game 5 sont encore dans les mémoires de tous les habitués de la Mecque du basket. En particulier pour Spike Lee, cible du trashtalking du numéro 31 en réponse aux gesticulations du réalisateur. À mesure que l’arrière enfile les paniers comme des perles, il toise l’ami Spike. Jusqu’à mimer un étranglement pour signifier au célèbre fan que son équipe choke en beauté, le tout avant de faire semblant de porter une grosse paire de baloches, symbole que les plus volumineuses ce soir-là sont dans son short tandis que les Pacers s’imposent derrière les 39 unités de leur franchise player.
Mais les mots de Spike Lee n’ont pas été le seul moteur de Reggie Miller. Le contentieux de Mighty Mouth avec les Knicks remonte à un an plus tôt, lorsque John Starks a refusé de serrer la main de son adversaire avant d’entamer le Game 3 du premier tour des Playoffs. Reggie Miller raconte :
Au début du match, je tends ma main et John Starks refuse de la serrer. Je me suis senti en mission, je vais mettre ce mec dans l’embarras.
Une rencontre remportée par les Pacers dans le sillage d’un Miller qui est rentré dans la tête de son adversaire direct :
John, regarde ta ligne de stats… Tu te fous de moi ? Tu es censé être un titulaire au poste de shooting guard dans cette ligue…
Starks dégoupille malgré les avertissements de Pat Ewing. Il colle un coup de tête à Reggie qui nous offre juste ce qu’il faut de commedia dell’arte pour que le numéro 3 des Knicks aille prendre sa douche avant tout le monde, remercié par les arbitres. Si New York se qualifie dès la manche suivante, le rendez-vous est pris pour les confrontations à venir.
1993, 1994 puis 1995 pour le threepeat entre Miller et les Knicks, les Pacers retrouvant New York lors des demi-finales de Conférence un an après son coup de chaud du quatrième quart. Cette fois-ci, c’est dès le premier match de la série que Reggie va monter en température. Alors qu’il reste moins de dix-neuf secondes sur l’horloge dans ce Game 1 au Madison Square Garden, les Knicks se dirigent vers la victoire en menant 105-99. Sur une première remise en jeu au milieu de terrain, le pote de Spike Lee hérite de la balle et dégaine du parking. Ficelle, moins trois, seize secondes à jouer. New York a la balle et toujours la main sur le match, même si le confort est moindre. On se dit qu’on attaque la litanie des fautes rapides et des lancers francs qui ne changeront pas grand chose à l’histoire. Erreur, comme celle commise par Anthony Mason pour relancer le jeu. Alors que Byron Scott et Reggie Miller font le pressing, Greg Anthony se vautre. Aidé par les Pacers ? Peu importe. Par peur de dépasser le temps imparti, Mason libère la balle, directement dans les mains de Reggie qui n’en attendait pas temps. L’arrière recule, dégaine, seconde ficelle du parking, égalisation. 6 pions en moins de six secondes, du genre rentable et efficace. Le MSG n’y croit pas, le coup sur la tête est rude. Il reste treize secondes et aucun temps mort pour New York, on ne sait plus quoi penser même si on imagine les Pacers défendre comme des chiens pour tenir cette prolongation inespérée quelques instants plus tôt. Sauf que les p’tits gars de l’Indiana sentent que ça peut flancher en face, et ils se disent qu’une dernière possession en leur faveur pour avoir leur destin dans leurs mains serait du genre sympa. Hack-a-Knick, et ça tombe sur John Starks. Double fail. Rebond offensif d’Ewing, jump shot, nouvel échec. La balle arrive dans les paluches de Reggie Miller qui subit à son tour une faute. Il mate Spike Lee, contemple fourbement la foule du Madison Square Garden puis rentre ses deux lancers. Il reste sept secondes cinq à jouer, juste assez pour voir Greg Anthony encore galérer pour mettre un pied devant l’autre et valider ce choke des Knicks face à Miller and co. qui se qualifient au bout du compte en sept manches, scellant l’aventure de Pat Riley à New York.
Après deux ans sans se rencontrer lors des phases finales, c’est en 1998 que Knicks et Pacers se retrouvent. Mais contrairement aux saisons précédentes, ce sont les lascars de l’Indiana qui partent avec l’étiquette de favoris et l’avantage du terrain. Il faut dire que l’exercice a été bien plus compliqué pour les Knickerbockers qui ont dû composer plusieurs mois sans Patrick Ewing, blessé au poignet. Un Patoche qui retrouve d’ailleurs les parquets à l’occasion du Game 2 de la série. Insuffisant pour faire mieux que gratter le troisième match et se faire sortir en cinq manches. Une élimination qui donne le sentiment que les Knicks sont en bout de course et qu’il est temps d’apporter du sang neuf dans le roster. C’est donc un groupe tout nouveau ou du moins grandement remanié qui se présente lors des finales de Conférence Est en 1999 pour tenter de renverser des Pacers ambitieux et sûrs de leur force.
Coach : Larry Bird
Bilan : 33 – 17
Classement : premier de la Division Centrale, deuxième de la Conférence Est
Attaque : 94,7 points (sixième), 108,7 points pour 100 possessions (premier)
Défense : 90,9 points (treizième), 104,4 points pour 100 possessions (vingt-quatrième)
Principales transactions : Signatures de Sam Perkins en tant qu’agent libre avant le début de la saison.
Rotation :
Meneur : Mark Jackson, Travis Best
Arrière : Reggie Miller, Jalen Rose, Fred Hoiberg
Ailier : Chris Mullin, Derrick McKey, Mark Pope
Ailier fort : Dale Davis, Sam Perkins, Al Harrington, Austin Croshere
Pivot : Rik Smits, Antonio Davis
Alors que de nombreux joueurs se tournent les pouces, enfilent les burgers ou sirotent des bières durant le lock-out, les Pacers ne chôment pas. En dehors des structures de la franchise puisque la grève interdit les contacts entre organisation et salariés, Reggie Miller et les siens se sont donnés rendez-vous au gymnase pour attaquer leur pré-saison sans même savoir si l’exercice aura lieu. Leur credo : être les premiers à débuter la saison et les derniers à la finir. Autant dire que les soucis de manque de complémentarité ou de forme ne sont pas le quotidien des Hoosiers lorsque David Stern permet de lâcher les chevaux. En même temps on peut aisément comprendre que les Pacers aient les crocs : finalistes de Conférence la saison précédente, ils ont vu leur rêve de détrôner les Bulls s’évanouir uniquement lors du Game 7 face à Michael Jordan et les Taureaux. Avec cette rotation complète et expérimentée, la franchise d’Indianapolis va logiquement faire partie des favoris et finir au sommet à l’Est, deuxième au tie-breaker derrière le Heat. Deux premiers tours de Playoffs expédiés sans perdre une seule rencontre confirment cette sensation avant d’aller se frotter aux Knicks.
30 mai 1999, Market Square Arena
Si la confrontation face au Heat n’a pas été l’apologie du basket champagne, il ne faut pas s’attendre à un duel plus sexy entre les Knicks et les Pacers, mais plutôt à de nouvelles batailles âpres et plus rythmées par des fautes que par des highlights qui pourraient remplir un Top 10.
Les deux franchises débutent avec les rotations classiques, New York pouvant toujours s’appuyer sur Patrick Ewing dans la raquette malgré ses soucis au tendon tandis qu’aucun pépin physique n’est à déplorer dans les troupes de Larry Bird. Kurt Thomas va continuer de défendre sur le pivot adverse pour soulager Patoche et ce n’est pas une partie de plaisir qui s’annonce vu l’écart de taille avec Rik Smits. Mais on va vite voir que le Hollandais n’est pas en grande forme, taquinant plus la faute que le shoot durant cette rencontre. Pas ce qu’il y a de mieux pour aider ses coéquipiers. Dans une partie plutôt cadenassée, il faut attendre l’entrée de Latrell Sprewell pour voir un peu de folie : il perd sa première balle, dynamite la défense des Pacers par une pénétration en solo après une interception, offre une passe décisive à Allan Houston à 3-points – après avoir attiré la défense dans la raquette pour le stopper – puis commet un autre turnover sur attaque posée. Oui, c’est bien en mode freelance que Latrell est le plus à l’aise. Il enchaîne d’ailleurs avec une contre-attaque et les Knicks surfent sur un 10-0 depuis son entrée. En face, les joueurs d’Indianapolis sont maladroits et bien loin de leurs standards offensifs de la saison régulière. Mais cela ne dure pas, car si New York vire en tête à la fin du premier acte 25-21, les locaux vont s’offrir une série à leur tour – 10-0 également – en profitant d’une période de disette pour les joueurs de Big Apple à cheval entre les deux premiers quarts. Larry Johnson mène alors la charge pour les siens et la Grosse Pomme retrouve l’avantage acquis sur les douze minutes initiales au moment d’aller souffler aux vestiaires.
Une pause qui fait du bien aux Hoosiers, bien plus en rythme pour ouvrir la seconde moitié du match, comme en témoignent les paniers de Rik Smits et Chris Mullin qui ouvrent enfin leurs compteurs. Mais au lieu de continuer sur sa lancée, le Batave préfère se chauffer avec Kurt Thomas pour échanger une faute technique avec l’intérieur new-yorkais. Suite à un nouveau run des Pacers, Jeff Van Gundy revient à ce qui avait fonctionné quelques minutes plus tôt : on libère Spree pour retrouver du scoring en transition et c’est un 17-8 qui s’en suit pour creuser l’écart par rapport à la mi temps, 70-63.
Rien n’est fait et on attend tranquillement que Reggie Miller sorte de sa boîte pour plier l’affaire face à sa victime favorite. Et pour attendre, on attend en effet, Larry Bird le laissant au chaud sur le banc au début de l’ultime période, histoire de le préserver pour le money time. Les Knicks forcent au maximum Indiana à jouer en isolation, ce qui ne sied guère aux qualités des locaux. Les Pacers se rapprochent tout de même mais à chaque fois, New York score le panier qui empêche le contact de se faire, même si Rik Smits – transparent jusque-là – permet à Indiana d’égaliser à moins de cinq minutes de la fin. On ne dira pas que les Knicks gèrent, mais ils assurent et l’avantage construit sur les trois premières périodes semble pouvoir suffire malgré tout. C’est ce qu’on croit jusqu’au moment où ce diable de Reggie Miller envoie une ogive pour prendre 2 points d’avance. Les Hoosiers creusent ensuite jusqu’à 5 unités de large, le plus gros écart en leur faveur. Mais dans une bataille qui se joue désormais en grande partie sur la ligne des lancers francs et qui voit Smits écoper de sa sixième faute personnelle, les Knicks tirent leur épingle du jeu, reprennent la main et surtout trois points d’avance.
Sur l’ultime possession, on imagine déjà Reggie Miller – qui a déjà connu un échec pour ramener son équipe à hauteur des Knicks à quinze secondes de la fin – crucifier New York du parking pour arracher la prolongation, mais il ne touche même pas la balle, bien serré par Allan Houston. C’est Mark Jackson qui hérite de la gonfle et envoie une saucisse – gêné par Chris Childs – qui valide le succès des visiteurs. Pour la troisième fois depuis le début des Playoffs, les Knicks récupèrent l’avantage dès le Game 1.
1er juin 1999, Market Square Arena
Au moment de débuter le Game 2, une statistique n’a pas de quoi enchanter les fans des Pacers : leur franchise a perdu ses dix dernières séries de Playoffs où elle était menée 1-0.
Pour inverser cette tendance, on ne peut que leur conseiller de remporter la rencontre qui arrive avant d’aller au Madison Square Garden, même si la Mecque du basket reste l’un des terrains de jeu préférés de Reggie Miller. Le numéro 31 ouvre d’ailleurs le bal, suivi par Mark Jackson qui enfonce Charlie Ward au poste et harangue la foule. Très déçu après son Game 1 de piètre qualité niveau adresse, le meneur compte bien se reprendre. Kurt Thomas préfère pour sa part prendre une technique pour avoir repoussé sans ménagement – mais aussi sans raison – Dale Davis sur un lancer franc. De quoi énerver Jeff Van Gundy qui voudrait que ses ouailles jouent au basket plutôt qu’aux cons. Mais visiblement son intérieur n’est pas sur la même longueur d’onde. Chaud comme une baraque à frites, il engraine encore son vis-à-vis sur une faute subie et des lancers francs obtenus, à tel point que Pat Ewing vient lui passer une soufflante pour le calmer histoire d’éviter qu’il se fasse sortir après deux minutes de jeu. Une pression qui retombe temporairement car dans un festival de coups de sifflet des arbitres, Charlie Ward, Kurt Thomas, Patrick Ewing, Rik Smits et Dale Davis rejoignent chacun à leur tour le banc pour deux fautes dans ce premier quart-temps. Au milieu de cette symphonie, difficile de donner du rythme à la rencontre. Childs qui est venu suppléer Ward se trouve à son tour en foul trouble. Les Knicks discutent plus avec les arbitres qu’avec la gonfle et JVG prend le pari d’une ligne arrière sans meneur avec Sprewell et Houston aux manettes à tour de rôle. L’expérience, sans être désastreuse, n’est pas concluante et ne permet pas à New York de revenir. Indiana vire en tête 28-22 après douze minutes.
On repart toujours sans meneur ni Pat Ewing pour les Knicks pendant que Larry Bird envoie sa second unit. L’avantage des Pacers grossit alors jusqu’à dix points pendant que Reggie Miller souffle encore sur le banc. L’attaque new-yorkaise patine avec de nombreuses pertes de balle alors que la circulation est plus fluide pour les locaux. Mais ce n’est pas le seul souci pour les hommes de Big Apple qui doivent composer avec leurs nombreuses fautes ainsi qu’un Patrick Ewing souffrant. Il sort d’ailleurs sous les sifflets de la Market Square Arena, en réclamant encore plus de huées de la part du public, provocation symbole de sa frustration tandis que New York compte onze unités de retard au moment de retourner aux vestiaires. Un écart qui aurait pu être bien plus conséquent sans l’apport d’un Larry Johnson qui a tenu la baraque en profitant au maximum de son avantage physique sur Chris Mullin à l’aile.
Les coups de sifflet continuent de rythmer la seconde moitié du match et les arbitres semblent en bien meilleure forme qu’un Pat Ewing qui ne parait même pas en mesure de sauter d’un trottoir tellement il traîne la patte. Cependant les Knicks reviennent dans la partie grâce au déchet sur la ligne des lancers francs de la part de leurs hôtes – coucou monsieur Davis – pour finir le quart-temps à moins trois points.
L’ultime période s’ouvre sur un tir du parking de la part de Chris Childs pour égaliser et annoncer un dernier acte chaud bouillant. Sauf qu’une fois encore, on va plus entendre le doux bruit du sifflet que celui de la balle traversant le filet, Rik Smits et Chris Dudley gagnant même le droit de regarder leurs coéquipiers finir la rencontre sans eux après avoir reçu chacun leur sixième faute. Mine de rien, cela pèse pour les Knicks car l’activité du pivot était en partie responsable du regain de forme leur ayant permis de prendre enfin la tête. Ce n’est pas Pat Ewing qui va aller au charbon de la même façon avec son tendon d’Achille en mousse et Indiana retrouve le lead avec quatre unités d’avance à un peu plus de deux minutes de la fin. Une position favorable mais pas confortable vu qu’au même instant lors du Game 1, les hommes de Larry Bird menaient de cinq points avant de laisser filer la victoire. Et le bis repetita est d’actualité quand Pat Ewing rentre un gros jumper, son premier tir réussi de la seconde mi-temps. Antonio Davis échoue ensuite en tête de raquette et Camby égalise en reprenant une pénétration contrée de Chris Childs. Jalen Rose se voit siffler une faute offensive qui donne à New York l’opportunité de prendre les devants à une minute du terme. Pat Ewing ne laisse pas passer sa chance lorsqu’il se retrouve sur la ligne des lancers francs. Ficelle, ficelle, deux points d’avance pour New York. Sur l’action suivante, Camby arrive du côté faible pour défendre sur Antonio Davis. Contact. Alors que les Knicks réclament l’annulation du panier et la faute offensive, c’est leur intérieur qui est sanctionné par Dick Bavetta. Le and-one n’est pas converti, 86 partout. New York grille son dernier temps mort pour les trente secondes qui restent à jouer. Dans le vent car Allan Houston vient s’empêtrer dans la défense des Pacers. Mark Jackson remonte la gonfle avant de la confier à Reggie Miller en isolation face à Chris Childs. Le tir est pris, manqué, mais les refs ont signalé une faute du meneur – sa sixième qui lui offre un retour sur le banc. Sans surprise, le meilleur shooteur de la saison au lancer franc ne se fait pas prier pour convertir ses deux tentatives.
Sur la remise en jeu, Charlie Ward redevient le quarterback de ses années NCAA et trouve Pat Ewing au niveau de l’elbow. Jump shot un poil trop long, Indiana s’impose et reste en vie avant de bouger à Big Apple.
Injury Report
Après la prestation au Game 1 de Pat Ewing, 40 minutes sur le parquet, 16 points dont six des neuf derniers des Knicks et 10 rebonds, les Pacers remettent en cause la sévérité de la blessure du pivot. Pour eux, le numéro 33 bluffe et joue sur le ressort émotionnel pour booster ses coéquipiers. On imagine donc que lorsqu’il regagne les vestiaires pour se refaire strapper pendant l’échauffement du Game 2, les Hoosiers sont prêts à lui décerner une palme d’or. Pourtant, c’est bien une déchirure qu’il ressent avant le match. Et soit Pat Ewing tient vraiment à faire carrière dans le cinéma, soit ses difficultés à se mouvoir lors de cette rencontre illustrent parfaitement la réalité : il joue sur une jambe. Cette seconde option va malheureusement être validée le lendemain du match par le physio des Knicks :
Pat, tu as une déchirure partielle du tendon juste au-dessus de la cheville.
Saison terminée, malgré tous les efforts du pivot pour convaincre le staff médical du contraire. Il a bien serré les dents jusque-là, il compte bien poursuivre alors qu’il a face à lui sa probable dernière chance d’aller chercher un titre. Mais Pat Ewing finit par entendre raison devant le risque de voir sa carrière se finir si son tendon vient à rompre complètement. À l’annonce de la nouvelle à ses coéquipiers, le cœur gros, il fait tout de même bonne figure avec un message clair :
Get me my ring.
5 juin 1999, Madison Square Garden
Un partout, les Knicks arrivent à la maison avec l’avantage du terrain récupéré lors du Game 1, mais sans Pat Ewing. Comment vont-ils digérer la fin de saison de leur pivot et quelles solutions Jeff Van Gundy va-t-il mettre en place ?
La chance du coach, si l’on peut dire, c’est que la situation s’est déjà présentée lors de la saison régulière et qu’il possède une base de réflexion. C’est donc sans surprise que Chris Dudley prend place dans le cinq, comme lors des absences précédentes de Pat. On sait également que Camby va gratter du temps de jeu et que le Madison Square Garden est bouillant, prêt à compenser l’absence d’Ewing à sa façon. L’historique intérieur, lui, a fait passer un message concis et clair à ses coéquipiers lorsqu’il a dû leur annoncer sa blessure : à eux d’aller lui chercher sa bague.
L’accent est mis sur la défense en début de rencontre – sans blague – et on sent de la nervosité des deux côtés, avec de nombreuses fautes offensives et du déchet. On se rend compte aussi qu’avec Chris Dudley à la place de Patoche, les Knicks manquent d’un point de fixation dans la raquette. Mais le besogneux fait le taf avec 4 points et 5 rebonds, une grosse implication en défense, le tout ovationné à sa sortie par le MSG. La solution passe alors par plus de rythme et la version small ball de la franchise de Big Apple, qui est envoyée sur le parquet dès que Rik Smits se trouve en foul trouble. Exit Kurt Thomas qui se coltinait le Hollandais pour faire rentrer Spree. Sauf que le mode uptempo ne prend pas immédiatement et le numéro 8 peine à apporter sa touche dynamique. Au buzzer, Larry Johnson égalise du parking, 17-17.
Le jeu reste brouillon des deux côtés au début du second quart-temps. LJ maintient les Knicks dans le match en faisant sa place dans la peinture. Childs, Sprewell et Camby donnent une nouvelle impulsion et la bench mob fait une légère différence. C’est d’ailleurs le Camby Man qui symbolise l’ascendant pris par les locaux, NY surfant sur un 20-10 au cours de ses sept premières minutes passées sur la parquet, avec 7 pions et 4 rebonds pour le numéro 23. Rik Smits se met ensuite en action et permet aux siens de recoller, aucun intérieur de Big Apple ne réussissant à le gêner, même l’ancêtre Herb Williams étant envoyé au casse-pipe. Les Pacers reprennent l’avantage et rentrent au vestiaire avec 5 points d’avance derrière les 15 unités de leur pivot batave qui a grandement œuvré dans le 22-10 des Pacers pour boucler cette période.
Conscient des difficultés de ses ouailles et de l’impact de Marcus Camby, Jeff Van Gundy décide de maintenir sa confiance à son jeune intérieur dès le début du troisième quart à la place de Dudley. L’ancien de Yale refait tout de même un passage rapide sur le parquet pour jouer des coudes, prendre un rebond et sa quatrième faute, le temps de laisser souffler un peu les tauliers. Malheureusement, Larry Johnson aussi se fait attraper par la patrouille sur un écran illégal et il doit également aller faire un tour sur le banc, Kurt Thomas prenant le relais. Cette sortie se fait sentir et Indiana semble pouvoir prendre la main sur le match mais Allan Houston maintient le cap pour les Knicks en allant chercher des fautes ou en rentrant des jumpers. New York étant dans la pénalité, les Pacers capitalisent pour leur part depuis la ligne des lancers francs. Dans cette fin de quart surtout rythmée par les coups de sifflet, une rengaine dans cette série, les deux équipes vont prendre quelques instants de repos en étant dos à dos, 69 partout.
De retour sur le parquet, Larry Johnson ne s’est pas refroidi et ouvre les hostilités d’un jump shot avant d’ajouter un 3-points… avec la planche. On aperçoit malgré tout les limites du small ball des Knicks avec notamment un Latrell Sprewell dominé par Derrick McKey au poste. À la faveur d’un 10-0, les Pacers prennent six longueurs d’avance à huit minutes du terme et poussent Jeff Van Gundy à réclamer un temps-mort. Sans surprise vu sa présence dans cette rencontre, c’est Larry Johnson qui met fin à la disette new-yorkaise, sous le cercle. Sauf qu’avec la maladresse de ses coéquipiers – Sprewell en tête – cela n’empêche pas Indiana de poursuivre sa marche en avant. En resserrant la vis en défense, les Knicks finissent par enrayer la bonne dynamique des visiteurs en se montrant plus agressifs, ne laissant aucun tir ouvert sur plusieurs possessions consécutives. À 11,9 secondes de la fin du match, Mark Jackson pense avoir climatisé le Madison Square Garden en rentrant ses deux lancers francs, synonymes d’avance de trois points. Il fanfaronne même en chambrant en mode Wesley Snipes dans « Les Blancs ne savent pas sauter ». Mais Larry Johnson avec la complicité de l’arbitre va remettre le thermostat à la température max.
Héritant du cuir à quarante-cinq degrés sur la gauche, LJ envoie un tir désespéré du parking au moment où le ref siffle une faute d’Antonio Davis. Bad call, ficelle, explosion du Garden. Après être redescendu sur terre, Larry Johnson convertit également le lancer franc pour donner la victoire aux Knicks. Car derrière, malgré cinq secondes sept pour arracher la gagne, les Pacers vont échouer.
Comme lors du Game 1, c’est Mark Jackson qui récupère la gonfle et ne parvient à convertir le shoot décisif. New York mène 2-1, avec encore une rencontre à la maison qui se dessine.
À l’issue de la rencontre, difficile de ne pas se remémorer les propos de Jeff Van Gundy entre les Game 2 et 3 au sujet de l’arbitrage :
Il faut se plaindre pour gagner. Chicago l’a fait à la perfection et en bénéficiait au match suivant. Indiana a pleuré pour avoir ses 40 coups de sifflet au Game 2. (Contre 28 pour NY)
Une façon pour lui de se plaindre aussi pour que l’arbitrage maison soit de la partie à Manhattan. Qui a provoqué le coup de pouce des refs sur l’action de Larry Johnson ?
7 juin 1999, Madison Square Garden
Malgré la dynamique positive et l’avantage 2-1, les Knicks connaissent une petite révolution. En effet, pour préserver les intérieurs des fautes, Jeff Van Gundy décide d’intégrer Latrell Sprewell au cinq de départ à la place de Kurt Thomas, décalant ainsi Larry Johnson poste quatre.
Un LJ qui doit aussi être soulagé de sa charge au scoring par l’apport offensif de Spree tandis que Marcus Camby assurera seul le rôle d’energizer en sortie de banc. Côté Pacers on attend que les mecs jouent enfin tous la même partition et à leur niveau. Les regards se tournent forcément vers Reggie Miller puisque le Knick killer n’a rien d’un tueur depuis le début de la série avec seulement 15,7 points à 42,4%. En gros tous les joueurs de Larry Bird doivent se sortir les doigts pour ne pas retourner à Indianapolis au bord de l’élimination. Niveau rotation, Travis Best blessé laisse la direction de la second unit à un Jalen Rose qui portera la balle alors que Fred Hoiberg gagne des minutes pour être aussi productif que lors de sa période de coach des Bulls plusieurs années plus tard. Larry Legend a insisté, il faut jouer dur. Un concept pas très bien maîtrisé par Rik Smits car le Batave prend deux fautes en trente secondes. On continue sur un concours de sifflet entre les arbitres et d’autres joueurs prennent le même chemin que le Hollandais et pas des moindres puisque Miller et Sprewell sont dans le lot. C’est malin pour Spree de retrouver le banc aussi rapidement après avoir attendu des mois d’être dans le cinq. Surtout qu’il commençait à peine à prendre son cours particulier auprès de son ancien coéquipier Chris Mullin. Le membre de la Dream Team a la main chaude, contrairement aux Knicks qui évitent juste le naufrage grâce à quelques lancers francs. Comme les coéquipiers de Mully ne sont pas spécialement inspirés non plus, la première pause est sonnée sur un dernier panier de Jalen Rose qui pose le score à 23-20 pour les Pacers.
Indiana insiste dans la raquette pour des paniers faciles – les hommes de Larry Legend ne prennent pas un tir du parking en première mi-temps – alors que côté Knicks, on se demande qui va alimenter la marque. Larry Johnson n’est pas aussi tranchant qu’au Game 3, probablement fatigué émotionnellement. Marcus Camby est bien mieux surveillé. Il faut que Allan Houston et Latrell Sprewell élèvent leur niveau mais le premier s’échine à défendre sur Miller, et le second est dans un mauvais soir, continuant à prendre une leçon d’efficacité offensive par Mullin. Une sorte de second effet Kiss Cool désagréable pour Jeff Van Gundy et son choix de titulariser le numéro 8. Surtout que dans le même temps, Kurt Thomas prend toujours autant de fautes – trois en huit minutes – même en sortie de banc alors que ce rôle devait le préserver. L’indigence offensive des Knicks au cours de cette première mi-temps se résume en quelques chiffres : sur le second quart, New York comptabilise cinq paniers et sept balles perdues, des stats qui s’équilibrent à douze unités dans chaque catégorie sur les vingt-quatre minutes écoulées. Sans Patrick Ewing, la franchise de Big Apple a besoin de courir pour scorer. Et pour courir il faut des stops et des rebonds. Des éléments absents pour le moment. C’est donc avec 13 pions de retard que les Knicks regagnent les vestiaires, le tout sans que Reggie Miller ou Rik Smits n’ait inscrit le moindre panier. Autant dire qu’un renversement de situation n’est pas d’actualité.
En effet, même si les New-Yorkais semblent plus concernés en défense au retour de la pause pour réduire un peu l’écart en provoquant des pertes de balle, cela ne dure pas. Smits et Miller ouvrent leur compteur et Mullin fait grossir le sien, profitant des paris défensifs d’un Sprewell qui se jette et mord dans chaque feinte. Heureusement pour les Knicks, l’énergie de Camby, un apport – enfin – de Houston et du mieux en défense leur permettent de se rapprocher à neuf points des Pacers avant le dernier quart-temps. Présent des deux côtés du parquet avec des interceptions, des rebonds et des finitions au cercle, l’intérieur chauffe le Madison Square Garden et entretient l’espoir. Les Pacers semblent douter, eux qui galèrent pour conclure les matchs dans cette série. Par son activité, Camby crée des opportunités de fastbreak et cela redonne un rythme qui convient plus aux Knicks. Mais à chaque fois que les locaux se rapprochent, les ouailles de Larry Bird mettent un gros panier pour garder un matelas confortable. Le public, pourtant bouillant avant le match, quitte tranquillement les travées de l’arène alors que quelques minutes restent à jouer. Pour la première fois de la série, le match ne se joue pas sur les ultimes possessions.
On ne change pas une équipe qui gagne. Un principe que JVG n’a pas suivi, considérant – à juste titre – que la victoire au Game 3 tenait du miracle et qu’il fallait revoir sa copie pour permettre à la franchise de Big Apple de poursuivre sa marche en avant. Mais son pari n’a pas porté ses fruits. Au contraire, avec un Latrell Sprewell des mauvais soirs, il est revenu en pleine poire du coach. Le banc des Pacers a surclassé celui des Knicks dans le sillage d’un Jalen Rose meilleur scoreur du match.
Spree est sorti pour six fautes et s’est fait balader par Chris Mullin et surtout… Indiana reprend l’avantage du terrain et de cette façon la main sur cette finale de Conférence.
9 juin 1999, Market Square Arena
Comme au premier tour, les Knicks n’ont pas su capitaliser sur l’avantage du terrain récupéré tôt dans la série, incapables d’enchaîner deux victoires. Tout est donc à refaire, il faut gratter au moins un match à la Market Square Arena.
Pas impossible, mais l’enceinte des Pacers n’est pas réputée comme une salle très accueillante, malgré le succès glané lors du Game 1. Jeff Van Gundy persiste avec Latrell Sprewell dans le cinq, bien que la première sortie avec cette rotation ne se soit pas avérée concluante au match précédent. Mais bon, avec les coups de sifflet qui s’accumulent dès les premières minutes comme souvent dans cette série, les changements de joueurs sont loin d’être figés dans le marbre et les line-ups bougent vite. En tout cas plus que des Knicks, qui rament et encaissent un 9-0 dans les dents. Rapidement dans la pénalité, les représentants de Big Apple voient les Pacers prendre le large. Les locaux profitent de nombreux lancers francs et d’une défense laxiste pendant que les Knicks se précipitent en attaque. Seul fait notable pour New York alors que Indiana envoie un deuxième run à hauteur de 19-4 cette fois-ci ? La seconde faute d’Allan Houston, bien provoquée par le jeu d’acteur toujours digne des Oscars de Reggie Miller. Un quart-temps perdu 28-14 et à vite oublier pour NY.
Les Knicks activent enfin le mode agressif et provoquent à leur tour des fautes et des pertes de balle de leurs adversaires pour débuter le second acte. Les Pacers se retrouvent d’ailleurs dans la pénalité en moins de deux minutes et New York enquille sur la ligne. En l’absence de l’intégralité du cinq majeur des Hoosiers, les joueurs de Big Apple grappillent et se rapprochent doucement au score. Au point de rendre la monnaie de leur pièce aux locaux, 28-14 sur cette période, soit 42 partout à la mi-temps.
Pour la seconde moitié du match, Allan Houston et Latrell Sprewell allument les premières mèches pendant que les Pacers abusent de l’isolation en attaque, bien loin de ce qui a fait leur force en saison régulière. Mais dès qu’ils retrouvent leurs fondamentaux collectifs, les paniers suivent et ils reprennent la main sur le match à la faveur d’un 15-5, même si les Knicks s’accrochent… et s’agacent devant les nombreux coups de sifflet cadeau à Reggie Miller, au point que Pat Ewing himself vient en toucher deux mots aux arbitres lors d’un temps-mort. Devant les difficultés des siens, Van Gundy se décide enfin à remettre Marcus Camby sur le parquet pour la première fois de la seconde mi-temps après une dizaine de minutes. Étonnant d’avoir autant patienté et aussi longtemps vu son impact sur ses dix-neuf minutes jouées jusque-là. Si ce retour contribue à relancer les Knicks, il ne suffit pas à combler l’écart avant le début du dernier acte, Indiana conservant quatre unités d’avance, 67-63.
Comme lors du second quart temps, Larry Bird s’appuie sur sa second unit. Et comme lors de cette période, les Knicks en profitent, Indiana souffrant pour scorer, si bien que New York repasse devant à sept minutes de la fin. Larry Legend renvoie donc ses tauliers sur le terrain pour stopper l’hémorragie. À cet instant, c’est un 17-10 qui calme Indiana depuis le retour du Camby Man sur le parquet. Les changements vont-ils relancer les locaux ? Le fait que Reggie Miller joue enfin à son niveau sur cette rencontre laisse entrevoir la possibilité pour les pensionnaires de la Market Square Arena d’arracher ce succès si important. Mais la faillite de Rik Smits, les lancers abandonnés en cours de route et le faible apport du banc sont rédhibitoires. Des lacunes qui font mal, comme les deux gros tirs du parking consécutifs de Larry Johnson, libéré à chaque fois par les pénétrations du backcourt que les Hoosiers peinent à ralentir. Même la sortie pour six fautes de Chris Childs ne change rien lors de la bataille aux lancers francs de la dernière minute.
Les mines sont déconfites sur le banc des Pacers, la série a encore changé de main.
11 juin 1999, Madison Square Garden
La partie de ping-pong va-t-elle se poursuivre ou les Knicks vont-ils réussir à enchaîner deux victoires consécutives dans la série ? Une chose est sûre, c’est que cette équipe sur laquelle personne ne misait un kopeck est à un match des Finales NBA. Sans Pat Ewing, blessé depuis la fin du Game 2 de cette confrontation face aux Pacers.
Mais quel visage les New-Yorkais vont-ils proposer ? À la maison, ils ont les cartes en main, mais ils ont déjà failli quelques semaines plus tôt lors du Game 4 face au Heat. Côté Pacers, on ne fait pas les fiers. Si le premier bon match de Reggie Miller au Game 5 laisse croire qu’un sursaut d’orgueil est encore possible, les hommes de Larry Bird n’ont pas montré la cohérence qui avait fait d’eux un groupe redoutable en saison régulière. Pour ne rien arranger, les stats peuvent mettre un gros coup à la tête des Hoosiers : lorsqu’une équipe a perdu le cinquième match d’une série lorsque le score était de 2-2, elle s’est faite sortir dix fois sur onze. La seule exception étant les Knicks en 1994 qui ont finalement botté les fesses des… Pacers. Il y a donc une revanche dans l’air, même si cela n’est probablement pas la priorité d’Indiana ce 11 juin à Manhattan.
Les visiteurs prennent les devants grâce à leurs intérieurs et un repli défensif qui empêche les contre-attaques new-yorkaises. Les pensionnaires du Madison Square Garden quant à eux semblent nerveux et débutent par un 0/4 au tir et deux balles perdues. Après quasiment sept minutes de jeu, ils cumulent un seul panier et quatre pauvres pions. Jeff Van Gundy lance d’abord Kurt Thomas, plus apte à scorer que Chris Dudley même s’il n’a rien d’une machine à points. Cela n’inverse pas la tendance et c’est au tour de Chris Childs et Marcus Camby de tenter d’apporter des solutions à une équipe qui creuse jusqu’à 7% d’adresse à 1/14 avant qu’Allan Houston et Kurt Thomas justement ne trouvent enfin la cible. Le point positif, c’est que malgré cette indigence offensive, les Knicks n’ont pas pris un éclat énorme et terminent le quart-temps à trois longueurs, 17-14. Il faut dire qu’après un bon début, ce n’est pas une leçon en attaque que nous montrent les Pacers non plus.
Une fois de plus, l’entrée de Camby est déterminante, New York passant un 22-9 lorsqu’il est sur le parquet. Ses stats sont quasi-nulles, mais son énergie impacte toute l’équipe des deux côtés du terrain. Indiana se rebelle un peu, la défense des Knicks étant moins agressive, mais la franchise de Big Apple est toujours devant. Jeff Van Gundy demande quand même un temps-mort pour ne pas que le momentum bascule alors que le public est bouillant derrière ses hommes. Mais un tournant indépendant de sa volonté va venir perturber ses plans. En chutant, Travis Best – de retour de blessure – fait strike sur la jambe de Larry Johnson qui se tient le genou, marqué par la douleur. Son coéquipier restant au sol, même Pat Ewing vient aux nouvelles. C’est porté par les remplaçants que LJ quitte les siens, sans pouvoir prendre appui sur sa jambe. Leur leader vocal out, comment les Knicks vont-ils réagir ? Tout d’abord en renvoyant Sprewell sur le parquet. Puis en resserrant les troupes au point de passer un 13-9 suite à cette blessure pour finir devant à la mi-temps, 41-35.
Une pause qui nous apprend que Grandmama est en direction de l’hosto pour passer une IRM et que l’optimisme n’est pas forcément de mise pour le revoir cette saison. C’est Kurt Thomas qui prend son relais dans le cinq pour attaquer le troisième quart-temps. Sans grand succès, son association avec un Chris Dudley hors du coup n’apporte pas grand chose et les Pacers reprennent le lead. Suite à l’un des rares paniers de Reggie Miller, Van Gundy relance Marcus Camby et Chris Childs à la place de Chris Dudley et Charlie Ward. Les rotations arrivent plus vite qu’à l’accoutumée avec les circonstances médicales entourant les Knicks. Elles sont surtout plus serrées et on peut s’attendre à voir ce cinq-là jouer de grosses minutes sur cette seconde moitié du match. Sur le banc, Ewing est en mode tourneur de serviette de luxe pour encourager un Allan Houston qui prend feu et fait vivre un cauchemar à Reggie Miller, incapable de le freiner en plus d’être catastrophique en attaque. Avant d’entrer dans le dernier acte, les deux franchises sont au coude à coude, 59 partout.
Si Chris Dudley revient à la place de Kurt Thomas pour qu’il souffle un peu, Larry Bird s’appuie en grande partie sur sa second unit emmenée par Jalen Rose pour tenter de rester dans la rencontre tout en reposant ceux qui sont considérés comme les top players. Un label qui paraît usurpé au final puisque par exemple Reggie Miller cumule un famélique 32 points au total sur ses trois rencontres au Madison Square Garden dont seulement huit pour cette soirée d’élimination, tandis que Rik Smits sort pour six fautes. En face, Allan Houston et Latrell Sprewell prennent le match à leur compte quand les Pacers ne s’appuient que sur Jalen Rose, personne d’autre ne semblant pouvoir scorer avec une once de régularité. Spree plie l’affaire sur une contre-attaque rageuse – alors que Jeff Van Gundy lui hurle de conserver la balle et de faire tourner l’horloge – puis sur la ligne des lancers francs.
Avec Allan Houston ils combinent 52 des 90 pions de l’équipe. Mais plus que tout, ils ont permis aux Knicks d’être le premier huitième spot de l’histoire à atteindre les Finales NBA. La célébration peut débuter, cet exploit face à tant d’adversité le mérite bien. Sprewell tape dans toutes les mains qu’il croise, Pat Ewing exulte, le Madison Square Garden est en fête.
Injury Report
À l’instar de Patrick Ewing – même s’il n’a pas été aussi handicapé – Larry Johnson a traîné une bonne partie de la saison une blessure. Et comme son pivot, il a serré les dents le plus possible, ne manquant qu’une seule rencontre malgré les douleurs à son genou gauche. Une résilience qui n’est pas récompensée lors de ce Game 6 face aux Pacers puisque l’ailier va voir l’articulation de son autre jambe le lâcher. Sur une action quelconque dans un match aussi engagé que cette confrontation entre Knicks et Pacers, les contacts sont nombreux. Sur l’un d’entre eux, Travis Best ne parvient pas à rester debout et il embarque avec lui le genou droit de Larry Johnson. LJ s’écroule à son tour en se tenant la jambe
Mon genou ! Mon genou !
Stupeur dans les travées du Madison Square Garden. Ce panier maudit de la Septième Avenue, témoin des désillusions new-yorkaises, fait encore une victime. Charles Smith contré à de multiples reprises par les Bulls, le finger roll manqué par Pat Ewing face aux Pacers et aujourd’hui la blessure l’ancien Frelon. Larry ne se relève pas et de longues minutes s’écoulent, durant lesquelles les physios s’affairent aux côtés du joueur. Inquiet, Pat Ewing vient aux nouvelles. Quand Grandmama finit par se relever, il est soutenu par Herb Williams et Chris Dudley, incapable de prendre appui sur sa patte droite. Il rejoint ainsi les vestiaires en grimaçant de douleurs. Quelques instants plus tard, c’est dans une chaise roulante – par précaution – que le taulier des Knicks est mené dans une ambulance pour des examens supplémentaires, devant abandonner les siens comme Patrick Ewing avant lui. Si certains ont évoqué des interventions divines lors des tirs victorieux de Houston contre le Heat et LJ lors du Game 3, ils verront peut-être là un dur retour à l’équilibre du karma.
Game Time
C’est comme s’il s’était échauffé pour réaliser cet exploit. En fin de premier quart-temps, au buzzer, Larry Johnson a envoyé une première ogive du parking, pas loin d’être désespérée. Une égalisation saluée par un Madison Square Garden qui ne demande qu’à exploser. Une répétition avant le moment de grâce. Pour être sûr d’être dans le bon rythme, LJ remet ça en fin de possession à un peu moins de onze minutes de la fin du match. Encore sur la sirène, avec la planche ce coup-ci. Ça compte quand même pour trois points, on ne va pas faire la fine bouche. Dix minutes et quelques poignées de secondes plus tard, New York se retrouve mené de trois unités. Lors du temps mort, Jeff Van Gundy réclame le même système que face au Heat pour libérer Allan Houston. Ce dernier doit envoyer une flèche longue distance s’il est libéré ou filer au cercle pour scorer rapidement à deux points. Sauf que Derrick McKey a la télé chez lui et il a vu le plan des Knicks à Miami. Il musèle parfaitement Houston et Charlie Ward se trouve contraint de lâcher la balle en direction de Larry Johnson. La gonfle est déviée par Jalen Rose, mais Grandmama parvient à la contrôler. Face à Antonio Davis sur le côté gauche de la ligne des trois points, il sent le banc des Pacers dans son dos, mais surtout qu’il dispose d’un avantage de vivacité sur son adversaire. Deux dribbles. Une feinte de tir. Une « caresse » de Davis sur la hanche. La balle qui traverse le filet. Et un coup de sifflet de Jess Kersey. Dans le vacarme d’une explosion indescriptible, Marv Albert lance une ses nombreuses phrases historiques :
Yes ! And the foul !
Le Madison Square Garden n’est plus une enceinte, mais un cratère en ébullition. Aucun séant n’est resté posé sur son siège, toute la salle a décollé comme un seul homme. Impossible de garder son calme dans ces conditions et Larry Johnson court déjà au milieu du terrain. Chris Childs le rattrape : redescend mon coco, il te reste un lancer pour finir le travail. LJ acquiesce, reprend son souffle et se dirige vers la ligne. La routine est respectée, le and-one converti. Le MSG a connu des émotions, mais celle-ci vient de se placer pas loin du sommet.
New York Knicks - San Antonio Spurs
Si les Knicks ont déjà marqué l’histoire de la NBA en atteignant les Finales, ils n’ont certainement pas envie d’en rester là. Mais face à eux, c’est un challenge encore plus grand que ceux rencontrés cette saison qui se présente : venir à bout des Spurs de Tim Duncan et David Robinson.
La taille face au cœur
D’un côté, la tête de série de l’Ouest qui s’est baladée en Playoffs. De l’autre, le huitième spot à l’Est qui a dû sortir ses tripes pour accéder à cette dernière marche. Deux franchises, deux équipes, deux parcours bien différents. Et un combat qui s’annonce déséquilibré.
Avant le début de la saison, Spurs comme Knicks s’avançaient tels des contenders. Si on zappe donc les quelques mois entre la fin du lock-out et l’entame de ces Finales NBA, personne n’aurait de quoi être choqué de retrouver San Antonio et New York à ce stade de la compétition, tant les effectifs possédaient des arguments sérieux à faire valoir sur le papier en février. Pourtant, le chemin a été bien plus tordu que prévu. Pour les Knicks bien entendu, comme nous avons pu le voir en détail, mais aussi pour des Texans qui ont mis un mois à trouver la bonne carburation derrière leur raquette monstrueuse. Mais les hommes de Gregg Popovich sont désormais lancés à pleine vitesse pour aller chercher le premier titre de l’histoire des Spurs et on imagine mal les joueurs de Big Apple venir contrarier cette marche en avant, même s’ils ont déjà déjoué les pronostics à de nombreuses reprises pour s’offrir le droit de rêver. Le Heat et les Pacers ont été dévorés en mâchant longuement, les Hawks engloutis en une bouchée, un renversement de situation total par rapport à la saison régulière, et il faudra avoir encore une sacrée dalle pour aller mordre les Éperons qui sont une proie bien plus coriace. Indigeste même ? C’est ce que doit penser Jeff Van Gundy lorsqu’il réfléchit au casse-tête qu’est de freiner les Twin Towers sans Patrick Ewing et avec un Larry Johnson diminué. Pour autant les New-Yorkais ont prouvé qu’ils avaient un cœur immense et une énergie leur permettant de repousser leurs limites, avec ce qu’il faut de coup de pouce du destin au moment de faire basculer les rencontres. Même en étant optimiste, cela fait peu pour contrer la belle mécanique texane tant cette équipe a paru intouchable sur les Playoffs, explosant la concurrence à l’Ouest. Imaginons juste trente secondes que Kevin Garnett, Arvydas Sabonis et Rasheed Wallace puis Shaquille O’Neal n’ont rien su faire contre Tim Duncan et David Robinson. Même avec toute l’affection que les fans du Madison Square Garden peuvent avoir pour Chris Dudley et Kurt Thomas, accompagnés par la révélation de la postseason Marcus Camby ou encore Larry Johnson, aucun n’a la carrure des premiers intérieurs auxquels les Spurs se sont frottés. Face au talent et à la taille de cette raquette, c’est avec leurs tripes et le moteur de leur traction arrière que les Knicks vont chercher à répondre à ce nouveau défi, où chacun devra être à son maximum. Car pour accompagner les Twin Towers, San Antonio s’appuie désormais sur des role players qui maîtrisent leur sujet et qui profitent au mieux des décalages créés par leurs monstres intérieurs. David contre Goliath ? C’est clairement le sentiment qui se dégage avant cette série tant les Spurs paraissent plus grands, plus forts et plus complets que les Knicks.
Coach : Gregg Popovich
Bilan : 37 – 13
Classement : premier de la Midwest Division, premier de la Conférence Ouest
Attaque : 92,8 points (treizième), 104 points pour 100 possessions (onzième)
Défense : 84,7 points (troisième), 95 points pour 100 possessions (premier)
Principales transactions : Signatures de Jerome Kersey et Mario Elie en tant qu’agents libres, échanges pour Antonio Daniels et Steve Kerr avant le début de la saison.
Rotation :
Meneur : Avery Johnson, Steve Kerr, Antonio Daniels
Arrière : Mario Elie, Jaren Jackson, Brandon Williams, Andrew Gaze
Ailier : Sean Elliott, Jerome Kersey, Gerard King
Ailier fort : Tim Duncan, Malik Rose
Pivot : David Robinson, Will Perdue
Demi-finalistes de Conférence en 1998, les Spurs de David Robinson basculent dans l’ère Tim Duncan, le sophomore ayant pris le pouvoir sur le parquet alors que l’Amiral a accepté sans rechigner de prendre un peu de recul pour laisser son jeune coéquipier être cette nouvelle pierre angulaire. Les Twin Towers sont donc les têtes d’affiche de cet effectif où l’on retrouve d’autres noms connus. On pense à Mario Elie et Steve Kerr qui ont déjà quelques bagues à leurs doigts ou encore l’expérimenté Jerome Kersey. Mais aussi à Sean Elliott et Avery Johnson qui accompagnent Robinson depuis plusieurs années dans le Texas. Cet assemblage oscillant entre expérience, talent et joueurs issus d’horizons improbables a du mal à lancer sa saison, au point de voir Gregg Popovich sur la sellette. Celui qui n’est pas encore la légende du coaching que l’on vénère aujourd’hui ne trouve pas la bonne formule sur le premier mois de la compétition. Manque de vie, d’émotion, de passion. Mario Elie va lui donner un coup de main en partageant ce souci avec ses coéquipiers. Un risque dans cette franchise qui n’aime pas faire de bruit, mais un échange qui soude le groupe et permet à chacun de trouver son rôle. Ce déclic alors que les Spurs présentent un bilan de 6-8 va propulser San Antonio au sommet de la Ligue puisque les Texans vont enchainer sur 31 victoires pour seulement 5 défaites et arriver en pleine confiance en Playoffs. À tel point qu’ils explosent la Conférence Ouest en ne perdant qu’une seule rencontre jusqu’aux Finales, le second match face aux Wolves au premier tour.
16 juin 1999, Alamodome
Au moment du coup d’envoi de ces Finales donné par la légende George Gervin, New York rêve sûrement de faire le même coup que lors des trois tours précédents : voler le premier match à l’extérieur pour lancer parfaitement leur série et installer le doute dans la tête des Texans.
Sauf qu’en face, cette inquiétude n’est pas présente. Forts de dix victoires consécutives dans ces Playoffs, les Spurs s’appuient immédiatement sur Tim Duncan qui prend et rentre un jump shot avec la planche, un geste déjà classique pour le sophomore. La balle passe systématiquement entre ses mains ou celles de David Robinson en attaque. En ciblant de préférence l’intérieur défendu par un Larry Johnson, en difficulté physiquement face aux Twin Towers et toujours diminué suite à sa blessure au genou contractée face aux Pacers. LJ prend d’ailleurs rapidement deux fautes et est remplacé par Kurt Thomas. Les Knicks veulent accélérer le rythme, mais cela signifie qu’il faut jouer juste, et pour l’instant chaque montée en régime ou presque se transforme en une perte de balle. À l’inverse les Spurs sont patients et exploitent au maximum les mismatchs. San Antonio débute clairement mieux, avec plus d’adresse en complément d’un jeu plus précis. Pour couronner le tout, New York arrive trop vite dans la pénalité, offrant ainsi des opportunités de points faciles pour les Spurs. Pour compenser, Latrell Sprewell se met en route et trouve le chemin des filets grâce à son agressivité. Comme Allan Houston est aussi dans un bon soir, les Knicks sont maintenant dans le rythme et tiennent tête à leurs hôtes. Et même plus puisque lorsque les douze premières minutes sont écoulées, puisque ce sont les visiteurs qui possèdent un avantage de 6 points, 27-21, dans le sillage de leur duo extérieur à 16 unités.
Un premier membre du binôme – Sprewell – va pour pour sa part souffler un peu pour permettre à Larry Johnson de revenir dans la rencontre. Kurt Thomas quant à lui laisse sa place à Chris Dudley pour une line-up plus classique, plus grande. Ça tient, mais les Spurs se rapprochent. C’est ensuite au tour de Houston de prendre une pause, Sprewell revenant sur le parquet. Est-ce qu’il va réussir à redonner vie à des Knicks incapables de scorer depuis le début de ce quart-temps ? Oui, par l’intermédiaire de Larry Johnson qui enchaîne un lancer et un panier. Malheureusement, comme Marcus Camby quelques instants plus tôt, LJ prend sa troisième faute en forçant son chemin face à Jerome Kersey. De l’autre côté du parquet, c’est Chris Dudley qui semble être touché au bras en voulant provoquer un passage en force. La poisse va-t-elle se poursuivre pour les intérieurs des Knicks ? Cela serait un gros coup dur car s’il n’est pas au niveau de Duncan ou Robinson, le pivot issu de Yale reste un bon morceau de viande à leur opposer et qui se bat au rebond. Finalement rien de grave, il peut continuer de se faire désosser par les Twin Towers. Pour boucler le second quart-temps, San Antonio envoie un 13-2 qui permet aux locaux de prendre huit pions d’avance. Les Spurs rentrent ainsi aux vestiaires avec la main et la dynamique en leur faveur tandis que Larry Johnson, Marcus Camby et Allan Houston sont en foul trouble. Les Knicks ont souffert pour scorer avec seulement dix unités sur ces douze minutes, pendant que Tim Duncan en a mis onze à lui seul.
Les hommes de Manhattan ne sont pas au sommet de la concentration lors de la reprise et les Spurs en profitent pour inscrire des paniers faciles. Est-ce que New York peut profiter du repos accordé à Timmy après sa troisième faute pour renverser la tendance à cet instant du match ? Pas particulièrement. Si les joueurs de Jeff Van Gundy s’accrochent et font jeu égal avec les Texans dans ce quart-temps (26-26), ils ne semblent pas en mesure de se rapprocher. Encore moins quand Duncan est de retour sur le parquet. Larry Johnson a beau donner tout ce qu’il a pour freiner l’intérieur des Spurs, physiquement la lutte est bien trop déséquilibrée. Du coup, les Knicks tentent des prises à deux et les extérieurs de Pop’ se gavent de shoots ouverts lorsque The Big Fundamental – ou David Robinson – ressort la gonfle. Pour ne rien arranger aux affaires new-yorkaises, Marcus Camby semble souffrir à la jambe et prend sa quatrième faute. C’est encore Kurt Thomas qui assure le relais lorsqu’il s’agit de boucher les trous dans la raquette de Big Apple, plutôt de façon productive puisqu’il va finir meilleur rebondeur de la rencontre à égalité avec Duncan, crédité de seize prises dont sept offensives.
Le coach des Spurs s’appuie sur son banc pour débuter le quatrième quart-temps et ses joueurs lui rendent bien cette confiance, en particulier Jaren Jackson auteur de 17 pions ce soir. La différence de profondeur entre les deux effectifs se fait sentir. Steve Kerr et Malik Rose n’ont pas l’apport chiffré de leur coéquipier, mais ils font le taf pour permettre aux titulaires de souffler sans que les Knicks ne reviennent trop dans la rencontre.
Au retour des tauliers, on sent tout de suite que la messe est dite et que sur ce match, New York ne va pas pouvoir faire le poids. Cette première soirée est pliée, 89-77 pour San Antonio.
18 juin 1999, Alamodome
Si le casse-tête de la domination du secteur intérieur des Spurs se posait à Jeff Van Gundy avant le début de la série, le Game 1 a confirmé toutes ses craintes sur ce sujet. Ainsi que le statut de favori de San Antonio.
Les Twin Towers ont semblé inarrêtables, le tout sans forcer en attaque. De l’autre côté du parquet, leur présence a aussi bien fait mal aux Knicks car toute cette taille éloigne les scoreurs du cercle. Les deux jours de réflexion ont-ils permis au coach de Big Apple de trouver des solutions ? Il doit également intégrer les soucis de santé à ses considérations, la forme n’étant toujours pas au programme dans l’équipe. Pour ne rien arranger, la santé n’est toujours pas au programme dans l’équipe. Certes, Larry Johnson déclare que son genou le gêne moins, mais il n’est pas dans un excellent rythme. Chris Dudley est bien présent, mais son bras le fait souffrir après une hyper-extension lors de la première rencontre. Bref, il n’y a pas grand chose qui pousse à l’optimisme. JVG ne change pas son cinq de départ pour autant. Ce qui ne bouge pas non plus, c’est que Tim Duncan ouvre la marque immédiatement face à Larry Johnson. Un LJ qui lui répond avec un tir du parking. Grandmama est attendu ce soir, sans lui Allan Houston et Latrell Sprewell sont trop seuls à pouvoir alimenter la marque. Mais ce départ en fanfare est trompeur, il ne fera vibrer le filet que sur une seule de ses onze autres tentatives de la soirée. Les Spurs se mettent en confiance avec une bonne circulation de balle et tous les joueurs concernés offensivement. L’Amiral et Timmy poursuivent leur intimidation pour protéger le cercle, rendant la vie tellement dure pour Sprewell et Houston, pas aidés par la médiocrité offensive d’un Chris Dudley pourtant peu surveillé. Malgré cela, un 6-0 permet à New York de passer devant au milieu de ce premier quart-temps. Pas pour très longtemps car quelques stops plus tard – cinq minutes sans scorer pour les visiteurs – San Antonio reprend la main. Pour ne plus la lâcher, porté par une intensité défensive impressionnante par moment. Les Knicks sont loin d’être largués, mais de nombreuses opportunités faciles laissées en route font que les Texans bouclent les douze premières minutes avec cinq points d’avance, 20 à 15 après une période jouée à un rythme bien plus élevé que ce que le score laisse penser.
En ayant mis Childs, Thomas et Camby sur le parquet aux côtés de Houston et Johnson pour débuter le deuxième acte, Jeff Van Gundy repose Latrell Sprewell. Mais il mise aussi sur la capacité des trois joueurs extérieurs à marquer du parking pour écarter la défense des Spurs. Pour cela il faudrait de l’adresse, une qualité portée disparue chez les Knicks ce soir-là. Chaque panier validé demande un effort immense aux New-Yorkais. Ils parviennent tout de même à recoller à 24-22, mais le rapprochement se termine vite, Sean Elliott enchaînant cinq de ses dix points de la rencontre pour remettre un éclat qui grossit ensuite jusqu’à neuf unités. Quatre points dans la dernière minute permettent à New York de rentrer aux vestiaires avec le même écart qu’à la fin du premier quart-temps, mais que ce fut laborieux.
Pour battre les Spurs, les Knicks doivent assurer les paniers faciles insiste Jeff Van Gundy à la mi-temps. Mais le début du troisième acte ne va pas le rassurer, ses joueurs continuant de vendanger des occasions en or. À cet instant du match, ils en sont à six points en douze contre-attaques. Une misère pour une équipe qui avait capitalisé sur le jeu rapide pour scorer lors des tours précédents. L’écart ne se creuse pas plus que ça pour l’instant car les Spurs ne jouent pas leur meilleur basket, loin de là. Une habitude pour eux lors des seconds matchs d’une série sur ces Playoffs, toujours laborieux côté texan : défaite face aux Wolves, victoire de trois unités face aux Lakers, victoire d’un point face aux Blazers. Mais sur les dernières secondes du troisième quart-temps, Sean Elliott marque avec la faute. Il rate son lancer, rebond pour Tim Duncan qui ajoute deux unités. On passe donc de +3 à +7 en un clin d’oeil alors que les Knicks ne disposent plus que de douze minutes pour tenter un retour.
On sent vite que cela ne sera pas possible. Gregg Popovich a pu reposer David Robinson et le retour de l’Amiral en début de ce quatrième quart-temps donne un coup de boost aux locaux pendant que les Knicks galèrent toujours autant pour mettre le ballon dans le cercle qu’on nomme panier. Dommage, car cela reste le principe de ce sport. Une disette offensive qui coûte cher car de l’autre côté du parquet, les hommes de Jeff Van Gundy font plutôt le taf en défendant intelligemment et avec agressivité. La tête dépitée de Patrick Ewing en costard résume bien cette situation et on se rend compte de l’importance du pivot en son absence. Un mec capable de rentrer des tirs et d’apporter de la densité dans la raquette ne serait pas un luxe pour la franchise de Big Apple. Pas besoin du Pat de son prime, mais celui vu lors des Playoffs – en seconde ou troisième option offensive – aurait pu changer le déroulement de la rencontre – de la série ? – ou à défaut rendre la tâche plus ardue aux Spurs. Là les Knicks manquent de solutions alternatives quand les Texans s’appuient sur un cinq majeur – le banc étant transparent ce soir – qui contribue de façon bien plus homogène derrière les Twin Towers. Surtout qu’en outre, au moment de jouer juste pour maintenir le contact et espérer un hold-up, les New-Yorkais commettent sept de leur dix pertes de balle du match, dont certaines en sortie de temps-mort. L’art de se saborder.
Les Spurs l’emportent 80 à 67, soit le deuxième plus petit total de points de l’histoire pour un match des Finales NBA depuis l’instauration de l’horloge des 24 secondes. Et encore, on a pu voir les défenses se déliter dans le garbage time, évitant ainsi de peu le record détenu par le Game 5 de 1955 entre les Fort Wayne Pistons et les Syracus Nationals. Pas sûr que cela console les Knicks qui vont rentrer à la maison sans avoir pu gratter un match, ni même donné l’impression de pouvoir mettre des bâtons dans les roues des Spurs.
Injury Report
Si Larry Johnson prétend aller mieux à mesure que la série avance, l’infirmerie new-yorkaise ne désemplit pas. Alors certes, elle n’explose pas non plus puisque les nouveaux joueurs touchés – Chris Dudley et Chris Childs – ne sont que de passage entre les rencontres et tiennent leur rang face aux Spurs. Il n’empêche que les deux sont diminués. Le premier dès l’entame de la série avec une hyper-extension du coude droit, le second à la fin du Game 3 en se tordant le genou. S’ils restent disponibles et serrent les dents pour soulager temporairement les titulaires, ils n’en perdent pas moins leur – faible – impact dans cette série. Pas de quoi baisser les bras pour Larry Johnson :
C’est dur, mais ce sont les Finales. Pas d’excuse.
Pas d’excuse en effet, mais bel et bien des difficultés supplémentaires dont Jeff Van Gundy aurait aimé se passer.
21 juin 1999, Madison Square Garden
Si les Knicks étaient arrivés relativement sereins au Madison Square Garden lors des premières séries en Playoffs, l’ambiance est moins optimiste qu’aux tours précédents cette fois-ci.
D’une part car ils n’ont pas su récupérer l’avantage du terrain, et d’autre part car Jeff Van Gundy n’a pas encore trouvé les solutions pour freiner les Spurs. Ou faciliter la tâche de ses joueurs offensivement. Enfin car si remporter une victoire semble déjà compliqué, un renversement de situation avec trois succès à domicile dans ces Finales au format 2-3-2 est une douce utopie au regard de l’historique de la Ligue. Autant dire que les planètes ne sont pas alignées pour que New York réalise un nouvel exploit. Mais Jeff Van Gundy et ses hommes ne sont plus à un miracle près durant ces Playoffs alors on imagine que Popovich a bien briefé ses troupes : pas de relâchement face à la bête blessée, elle a déjà prouvé qu’elle pouvait encore mordre. I still believe indiquent les pancartes à Big Apple. On se demande s’il s’agit de la réalité ou de méthode Coué.
Le coach des Knicks a compris pour sa part qu’il devait changer sa stratégie pour apporter plus de verticalité face aux Twin Towers. Il mise donc sur Marcus Camby dans le cinq de départ à la place de Chris Dudley, toujours gêné à son coude suite au Game 1. Cette fois-ci le banc est dépeuplé ou pas loin, mais l’immobilisme n’était pas une solution envisageable pour revenir dans la série. Surtout que le coach new-yorkais n’a pas apprécié de voir que son équipe ne jouait qu’à quatre en attaque lors des deux rencontres précédentes, ou du moins que les Spurs laissaient volontairement de la liberté au pivot issu de Yale sans que cela n’ait le moindre impact. C’est de l’autre côté du parquet que ce choix se montre judicieux d’entrée puisque sur la première offensive du match pour les visiteurs, Camby Man tient parfaitement le coup face à David Robinson. Ce n’est qu’une action, mais rien de mieux pour la confiance du jeune intérieur. Et pour chauffer le MSG, prêt à exploser derrière les siens. Est-ce cette ambiance qui perturbe les Spurs et Mario Elie en particulier ? L’arrière grossit sa feuille de stats avec une perte de balle, un échec sur un three ouvert, deux fautes et une technique pour attaquer la rencontre, ce qui pousse Gregg Popovich à l’appeler sur le banc. Son remplaçant Jaren Jackson prend immédiatement le bouillon face à Allan Houston qui score tout de suite au poste sur la gueule du nouvel entrant et ce deux fois consécutives. Les Knicks sont concernés et sérieux, ce qui leur permet de prendre la main sur le match. Houston et Sprewell sont en rythme, Larry Johnson rentre enfin des shoots. Même la sortie pour deux fautes de Marcus Camby – suppléé par Kurt Thomas – ne semble pas dérégler l’équipe de Big Apple. Au contraire, ce sont les visiteurs qui ont du mal à garder leur calme devant des coups de sifflets qui ne tombent pas de leur côté, au point que Pop’ prend lui aussi une technique. Thomas se montre toujours aussi peu malin lorsqu’il s’agit de gérer ses fautes et il se trouve à son tour en foul trouble. Chris Dudley foule le parquet à sa place, chose que Jeff Van Gundy aimerait éviter au maximum. Bon cela ne se passe pas trop mal, et malgré une bombe du parking d’Antonio Daniels avant le buzzer, les Knicks bouclent le premier acte avec onze unités d’avance, 32-21.
Le deuxième quart-temps est plus compliqué et New York laisse filer une partie de cet avantage au début de cette période avec seulement quatre points scorés au cours des quatre premières minutes. Comme régulièrement cette année, les Knicks se trouvent dans une pénurie de panier et cela risque de faire basculer le match. Larry Johnson réveille les siens après un temps-mort. Le retour d’Allan Houston qui a pu souffler suite à quelques instants de repos sur le banc va redonner un minimum de pep’s à l’attaque des locaux. Pas pour longtemps, car New York enchaîne de nombreuses pertes de balle et San Antonio revient à trois longueurs au moment d’aller aux vestiaires, 49-46.
Alors qu’habituellement on se refroidit durant la pause, c’est un Marcus Camby bouillant qui se chauffe avec David Robinson au début de cette troisième période. Rien de méchant non plus, mais les refs ne vont pas laisser dégénérer le match et filent une faute plus une technique à chacun histoire de calmer un peu l’ambiance. Dommage pour l’intérieur des Knicks, il prend juste derrière son quatrième coup de sifflet de la partie qui signifie retour sur le banc pour le préserver. On a connu plus judicieux pour une première titularisation. Heureusement de l’autre côté du parquet Allan Houston ne s’est pas rafraichi lui non plus. Il a toujours la main chaude et continue de martyriser l’arrière adverse au poste, puis du parking – son premier panier à trois points de la série – pour boucler un 7-1 personnel. Les Spurs ne se laissent pas abattre et resserrent leur défense, quitte à faire des fautes comme Mario Elie qui prend à son tour sa quatrième. C’est d’ailleurs sur la ligne que les Knicks réussissent à rester devant car ils passent encore cinq minutes sans panier dans le jeu, jusqu’à un nouveau trois points d’Allan Houston à la fin des vingt-quatre secondes alors que San Antonio vient d’égaliser. Les deux équipes scorent chacune 16 points sur cette période, dont 13 pour le seul numéro 20 des Knicks qui porte son équipe pendant que Latrell Sprewell est en panne d’adresse. Toujours trois unités d’avance donc pour New York, 65-62, malgré un horrible 4/23 au tir pour les locaux durant ce troisième quart-temps.
Cela repart bien mieux pour le dernier acte avec un lay-up venu d’ailleurs pour Spree suivi d’une claquette rageuse de Marcus Camby. De quoi électriser encore plus le Garden mais surtout reprendre un peu d’air au score. Même si l’intérieur ne trouve rien de mieux que prendre sa cinquième faute derrière. Le Camby Man fait donc un nouveau séjour sur le banc. Puis revient finalement sur le parquet, le temps de rentrer un lancer franc, un jumper, contrer Sean Elliott, gober un rebond et entendre son sixième coup de sifflet. Cela peut paraître léger, mais c’est un impact supérieur à celui de Tim Duncan étonnamment muet en attaque lors de ce quatrième quart-temps.
Les Knicks s’imposent finalement 89 à 81 derrière les 34 pions d’Allan Houston. Ils espèrent être enfin rentrés dans leurs Finales en imposant aux Spurs la première défaite à l’extérieur de Playoffs.
Off the court
À 2-0 en faveur des Spurs au moment de rentrer à la maison, les Knicks ont déjà bien mal au crâne pour trouver des solutions et revenir dans la série. Ils se passeraient volontiers d’une distraction inutile servie sur un plateau par un des leurs. Alors qu’il souhaite se concentrer sur son shoot car il manque de rythme et d’entraînement suite à sa blessure, Larry Johnson va donc leur offrir cette précieuse dispersion hors des parquets comme New York sait si bien les proposer. L’ailier se voit rappeler à l’ordre par la NBA lorsqu’il tente de sécher une séance média pour taffer son jeu et son tir. Il finit par répondre avec un langage fleuri, ce qui lui vaut vingt-cinq mille dollars d’amende, la même somme étant également demandée à sa franchise. Par ici la monnaie. Quelques jours plus tard, il se pose donc gentiment derrière les micros pour répondre aux journalistes. Reste que tout ce qu’il balance ne glisse pas comme papa dans maman, en comparant entre autres cette équipe des Knicks à des esclaves rebelles et garnissant encore son discours avec des propos imagés qui ne sont pas du goût de tout le monde. Jeff Van Gundy et le service presse des Knicks tentent alors de calmer le joueur mais celui-ci rétorque
Vous vouliez que je parle à la presse, je leur parle.
À quoi s’attendaient les Knicks de la part d’un joueur qui n’a jamais porté les médias dans son cœur et qui est réputé pour son avis très tranché sur la condition des Afro-américains ? Il enfonce d’ailleurs le clou en traitant tous les journalistes blancs de “descendants d’esclavagistes.”
Un discours qui va rendre hors de lui Bill Walton, déjà en froid avec le joueur. Le consultant, ancien des Blazers ou des Celtics, dézingue alors Grandmama après son Game 4 catastrophique, qu’il qualifie d’ailleurs de pathétique de la part d’un être humain bien triste :
Il est une honte. C’est une honte non seulement pour la Ligue, mais aussi pour la race humaine
Ça tire à balles réelles, et Larry Johnson, averti des propos du rouquin mais surtout toujours armé, demande s’il s’agit bien du hippie qui fumait des joints à UCLA. Le tout avant de proposer aux journalistes présents d’aller rappeler à Bill Walton que
Avery [Johnson] et moi, on est de la même plantation. De la plantation Massah Johnson. Qu’il aille regarder de son côté combien d’esclaves ses ancêtres ont eus.
Plus tard, L.J. prend le temps de replacer sa rage dans son contexte. Oui, la NBA est une opportunité pour les Afro-américains de s’en sortir. Mais très peu y arrivent, ajoutant que tous les gars avec qui il a grandi à South Dallas sont en taule, morts ou drogués. Que s’il est fier de son succès, il ne peut oublier les autres et les inégalités.
23 juin 1999, Madison Square Garden
Les Knicks ont enfin retrouvé l’intensité et le niveau qui leur ont permis de déjouer les pronostics lors des tours précédents des Playoffs. Mais ce Game 3 était-il juste un sursaut d’orgueil ou un retour à la normale qui va leur permettre d’inquiéter encore plus les Spurs ?
Si cette victoire fait du bien aux têtes et de sauver l’honneur, elle n’a pas complètement renversé la tendance : les Texans restent les favoris, et rien ne garantit qu’ils doutent de leur force. Ils seront certainement bien plus concentrés ce soir, comme le laissent penser les visages moins souriants à l’échauffement. Pour les locaux qui rêvent d’un exploit supplémentaire, la montagne est encore plus élevée avec un pépin supplémentaire à gérer. Touché au genou, Chris Childs est diminué et ne s’est pas entraîné depuis la dernière rencontre. Autant dire que les rotations se resserrent encore plus pour Jeff Van Gundy, alors qu’il ne s’appuyait déjà sérieusement que sur huit gars. Pas le meilleur contexte quand on souhaite infliger à San Antonio une seconde défaite consécutive, chose que les hommes de Gregg Popovich n’ont pas connue depuis le 28 février, soit cinquante et un matchs sans deux revers d’affilée. Mais le coach de Big Apple a de quoi motiver ses troupes, agacé par les propos de Sean Elliott et Mario Elie insinuant que si New York a remporté le Game 3, c’est grâce aux arbitres. L’arrière, en foul trouble sur la rencontre précédente, gagne le premier coup de sifflet des refs pour une faute évitable. Probablement encore à cause d’un complot des hommes rayés. Une bonne nouvelle pour lui tout de même, son entraîneur a décidé d’envoyer Elliott au charbon face à Allan Houston qui avait pris le dessus sur ses différents vis-à-vis lors du troisième match. C’est du coup Latrell Sprewell qui prend la charge offensive sur le début de la rencontre, son compère étant ennuyé par la taille de l’ailier des Éperons. Chez les Spurs, on sent que les extérieurs sont plus recherchés pour être mis en confiance, ce qui n’était pas le cas sur les premières confrontations. Dans la catégorie des changements d’habitude, on voit Charlie Ward apporter son écot en attaque alors que lui comme Childs, en dehors du pressing sur le meneur adverse, ont plutôt joué les Casper jusqu’à présent dans la série. C’est d’ailleurs le point guard titulaire des Knicks qui permet à son équipe de prendre l’avantage une minute trente avant la fin du premier quart-temps en interceptant une passe à destination de Mario Elie. Le joueur des Spurs reste au sol sur cette action pendant que Ward conclut tranquillement en lay-up pour atteindre dix unités personnelles. New York boucle cette période en tête, 29-26. Mais peuvent-ils tenir ce rythme alors que le roster est décimé – seul Kurt Thomas est venu faire souffler Larry Johnson et Marcus Camby – et qu’il ne possède pas la puissance de feu offensive des Texans ?
Chris Childs foule finalement le parquet alors que Mario Elie, quant à lui, revient. Plus de peur que de mal pour l’arrière qui a juste pris un coup sans conséquence sur son genou. Les Knicks semblent conserver leur rythme du premier acte. Cependant les extérieurs de Popovich trouvent des solutions contrairement aux premières rencontres, ce qui risque de devenir un souci si New York ne les freine pas et que les Twin Towers montent en régime. La défense n’est pas au rendez-vous et une traditionnelle période de disette offensive des hommes de Big Apple fait que San Antonio prend l’avantage, même si les Knicks s’accrochent pour mettre en place une légère alternance au tableau d’affichage. Jusqu’à ce qu’une nouvelle série d’échecs – en particulier par Larry Johnson ou Allan Houston – et la mise en route de Tim Duncan mieux servi qu’en début de rencontre ne permettent aux Spurs de créer un léger écart sur la fin de cette mi-temps, 50-46.
Les Éperons sont en mode barbelés sur les premières minutes après la pause et passent la barre des dix unités d’avance. Il faut dire que les pensionnaires du Madison Square Garden mettent quasiment quatre minutes avant de scorer dans ce troisième quart-temps. La Mecque du basket ne baisse pas les bras et continue de crier, en particulier sur un dunk de Camby devant Tim Duncan ou encore une contre-attaque de Sprewell. Mais cela n’impressionne pas les Spurs qui ont la main sur le match et un matelas suffisant autour de la dizaine de points pour laisser tomber la foudre sur leur cercle occasionnellement. Ils remportent même ce troisième acte 22-17, 72-63 au total. La mission s’annonce compliquée pour les locaux.
Ils prennent tout de même le dernier acte par le bon bout en trouvant plus facilement le panier. Ils font douter les joueurs de Pop’ en revenant à une unité en milieu de ce quatrième quart-temps, faisant rugir de plaisir le public, enflammé par l’énergie apportée par Latrell Sprewell. Mais David Robinson et Tim Duncan posent alors leurs grosses paluches sur la gonfle pour rappeler qu’ils sont les patrons et que les Spurs ne vont pas laisser filer ce match. Qui plus est face à un backcourt qui s’essouffle de tous les efforts fournis, même s’il refuse de lâcher l’affaire : Ward, Spree et Houston n’ont pas pris de repos de la seconde mi-temps. Bien moins à la fête que ses comparses, c’est épuisé et tête basse que Larry Johnson regagne le banc pour six fautes, laminé par Tim Duncan en défense, incapable de peser offensivement. Son naufrage pèse lourd dans la défaite 96-89.
Menés 3-1 et une nouvelle fois dépassés par Timmy et les siens, les hommes de Big Apple ne se font plus beaucoup d’illusions en rentrant aux vestiaires. Remporter la série paraît désormais un rêve inaccessible pour les Knicks.
25 juin 1999, Madison Square Garden
En arrivant dans les coulisses du Madison Square Garden, les Knicks ont pour objectif de ne pas voir les Spurs célébrer leur titre sur le parquet de Big Apple.
Parce que soyons honnêtes, même si les I still believe s’affichent toujours dans New York, il n’y a plus grand monde pour croire à l’exploit de remporter trois rencontres consécutives face à des Texans qui n’en ont jamais perdues plus de deux à la suite cette saison. Mais qui aurait misé un dollar sur le parcours des Knicks ? Qu’ils seraient le premier huitième spot ever à atteindre les Finales NBA ? Personne. Alors ne comptez pas sur eux pour baisser les bras ou s’avouer vaincus, peu importe les statistiques. On le rappelle, les Warriors ne sont pas encore passés par là pour chocker un 3-1 sur la dernière marche, donc personne n’est revenu d’un tel déficit pour repartir avec le titre. Marcus Camby affirme pour sa part que son équipe est la meilleure présente sur cette série. Bref, les New-Yorkais comptent bien être dans les bagages des Spurs pour retourner à San Antonio. Autant dire que si les Knicks doivent tomber ce soir, ce sera en laissant tout ce qu’ils ont encore dans leur ventre. Surtout après avoir assisté à la préparation de la remise du trophée avant leur échauffement, spectacle qui leur a bien mis les boules.
Comme lors du Game 4, Pop cherche à alimenter ses extérieurs pour offrir une menace plus large, sans grand succès ce soir. Van Gundy, lui, souhaite responsabiliser Larry Johnson en galère sur cette série. LJ doit soulager Sprewell et Houston au scoring, mais se coltiner Duncan des deux côtés du parquet en n’étant toujours pas à 100% est un handicap bien trop conséquent. C’est donc encore le duo de shooting guards qui prend rapidement la charge offensive pendant que Marcus Camby retrouve des soucis de fautes qui limitent son impact. L’adresse n’est pas au rendez-vous. On sent de la nervosité. Et côté Big Apple, une volonté de donner du rythme et mettre un maximum d’intensité. Un joueur a clairement la dalle pour les Knicks, c’est un Latrell Sprewell qui ne doute pas, coupe les trajectoires de passe et attaque le cercle dès qu’il en a l’occasion. Il permet aux siens de virer en tête 23-20 après les douze premières minutes.
En face, Tim Duncan est injouable. Que ce soit à la finition, à la passe lors des prises à deux ou encore en se posant comme muraille, son impact ne peut être négligé et il remet le couvert dès le début du second quart-temps pour alimenter la marque avant d’aller souffler. Les Knicks sont sur une bonne dynamique et malgré le repos de certaines armes – Houston, Camby et Johnson passent sur le banc, Sprewell va y faire un tour aussi – ils parviennent à creuser un peu plus l’écart à la faveur d’un 7-0. Popovich ne peut pas rester les bras croisés et il renvoie son numéro 21 pour remettre de l’ordre dans la maison. Suffisant ? L’effet n’est pas immédiat et jusqu’à quatre-vingt-dix secondes de la pause, New York maintient l’avance obtenue au premier quart-temps. Mais sur cette dernière minute trente, les Spurs scorent cinq pions sans que les Knicks ne parviennent à trouver le cercle adverse. Les visiteurs mènent alors 40-38, les hommes de Big Apple peuvent s’en mordre les doigts puisqu’ils ont eu la main durant près de vingt minutes.
Tout est donc à refaire après le passage aux vestiaires. Sauf qu’en foirant les six premières possessions du troisième acte avec trois échecs au tir et autant de balles perdues, les hommes de Van Gundy ne se mettent pas dans les meilleures conditions. Une période de disette de plus pour la franchise de Manhattan qui fait mal. Elle ouvre surtout une voie royale à San Antonio pour prendre le large à hauteur de neuf unités. L’adresse réapparaissant avec l’agressivité retrouvée pour New York, Latrell Sprewell remet son équipe à une longueur suite à un and-one. Avant de redonner l’avantage à Big Apple sur l’action suivante. Spree est chaud comme la braise et il a décidé de prendre le Madison Square Garden sur son dos. Gregg Popovich essaie de couper cet élan avec un temps-mort qui s’éternise. En effet, l’horloge des vingt-quatre secondes au-dessus du panier des Knicks est hors-service, et il faut la changer. Le coach des Spurs n’est probablement pas mécontent d’avoir du temps en rab pour refroidir Spree. Huit minutes plus tard le basket peut reprendre ses droits. Enfin pas pour Larry Johnson qui est sanctionné de sa quatrième faute. Sprewell lui ne compte pas ralentir pendant que Tim Duncan maltraite Kurt Thomas. Spree et Timmy se lancent dans un mano a mano de haute volée pour cette fin de rencontre. Au moment d’attaquer les douze dernières minutes du match, New York n’est qu’à un point des Spurs.
Preuve que les lascars nommés ci-dessus tiennent le sort de cette confrontation entre leurs mains, le Texan parvient à contrer le numéro 8 sur sa première tentative avant d’aller scorer avec la planche sur Chris Dudley. Sprewell réplique. Et enchaine sur un jump shot avec la faute. Le combat se poursuit entre les deux joueurs, parfois avec un peu d’aide, mais c’est bien ce duel qui rythme les dernières minutes. Même lorsqu’ils ne sont pas à la conclusion, ils créent régulièrement les opportunités ou les espaces pour leurs coéquipiers. Derrière les vingt-cinq points en seconde mi-temps de Spree, New York mène de deux pions à trois minutes de la fin. Mais c’est le début de la chute pour les Knicks. Entre les barbelés posés par San Antonio qui doublent sur Latrell Sprewell et le manque d’inspiration offensive des troupes de Jeff Van Gundy, les hommes de Big Apple ne vont plus scorer. C’est finalement Avery Johnson qui rentre le tir crucial qui permet aux Spurs de prendre une dernière fois l’avantage, sur une errance défensive de Latrell Sprewell justement. Le numéro 8 va disposer derrière de deux ultimes opportunités de valider le billet de son équipe à destination du Texas. En vain.
Il faudra donc supporter la vision des Spurs célébrant au Madison Square Garden devant un public qui fête tout de même ses héros malheureux, les remerciant pour les émotions procurées et le cœur mis dans ce parcours.
Game Time
À quelques centimètres près, le paria devenait le héros. À la fin d’un match où il a porté New York sur ses épaules, Latrell Sprewell échoue à proximité du cercle, cerné par Tim Duncan et David Robinson. Avant de se courber et tenir son short, exténué et déçu. Un symbole de cette confrontation où tout le cœur de Spree et ses coéquipiers n’a pu suffire à contrarier la taille – et le talent – des Twin Towers.
S’il ne lui faut pas trop de temps pour ouvrir son compteur – un peu plus de deux minutes – Latrell Sprewell n’est pas d’une adresse folle en ce début de match puisqu’il va cumuler neuf échecs sur douze tentatives au cours de la première demi-heure. Un manque de rythme qui peut être dû à son arrivée tardive – 20h pour un coup d’envoi à 21h15 – sur Pennsylvania Plaza pour cause d’embouteillage sur le chemin. Il compense cette maladresse par de l’agressivité pour attaquer le cercle, voler des ballons en coupant les trajectoires des passes et provoquer des fautes. Le voilà, le joueur que Jeff Van Gundy était prêt à faire venir au risque de mettre en péril l’harmonie du vestiaire. Un mec qui va utiliser son énergie pour trouver des solutions même dans les périodes difficiles. Avec 10 unités à la mi-temps, il a déjà plutôt bien tenu la baraque dans une attaque des Knicks toujours aussi stéréotypée et laborieuse. Ses paniers en transition maintiennent New York ainsi que le Madison Square Garden en vie. Comme lorsqu’il décolle pour postériser Jaren Jackson – avec la faute en prime – suite à une interception de Charlie Ward. Le regard est noir, concerné et concentré. L’air de dire : suivez moi les gars, ce soir je vous montre le chemin pour l’honneur de la ville. La foule est en phase pour exploser et lui apporter encore plus de jus tandis que ses coéquipiers l’alimentent pour qu’il conserve sa dynamique. De toute façon, ils n’ont pas trop le choix tant ils galèrent pour scorer sans lui. Après les contre-attaques et les lancers, Spree enchaîne à mi-distance, sur catch and shoot ou en sortie d’écran. Puis poste bas. De partout, il paraît indéfendable, trop rapide, trop vif, trop déterminé. Lors du troisième quart-temps, il fait plus que doubler son total de points avec 11 pions supplémentaires sur les 20 inscrits par les siens au cours de cette période. New York n’est qu’à une unité des Spurs, Big Apple veut y croire, peut y croire grâce à Latrell. Il continue sur sa lancée en prenant de vitesse Duncan puis en rentrant un jump shot avec la faute de Malik Rose. Prochaine corde à son arc ? Une ogive du parking alors qu’il remonte tranquillement la balle et qu’aucun défenseur n’est sorti sur lui. New York prend trois points d’avance, Spree vient de mettre les 12 derniers pions des Knicks à cheval sur les deux quart-temps. Sean Elliott ne doit pas être loin de pleurer, car même lorsqu’il défend parfaitement et pousse l’arrière à prendre un shoot compliqué, la ficelle vibre toujours. Le numéro 8 score ses trente-quatrième et trente-cinquième points sur la ligne des lancers francs, portant ainsi sa marque à 25 sur la seconde mi-temps, sur les 39 de son équipe. New York mène alors de deux unités, 77-75. On ne le sait pas encore, mais les locaux ne trouveront plus le chemin du panier et Sprewell, en plus de se perdre sur une rotation défensive qui laisse Avery Johnson donner l’avantage aux Spurs, va échouer à deux reprises pour refaire passer les Knicks devant. Manque de lucidité ? Trop d’énergie dépensée ? Peu importe la réponse, il doit se contenter d’être un beautiful loser, à l’instar de sa franchise. Avec laquelle il déclare vouloir continuer dès l’issue de la rencontre.
Qui aurait pu imaginer, quelques mois plus tôt, que Latrell Sprewell ferait remonter de la sorte sa cote de popularité ? Que celui dont la NBA ne voulait plus entendre parler, suspendu si longtemps, reviendrait sur le devant de la scène au point de porter l’espoir des Knicks ? La route n’a pas été simple, entre l’adaptation à l’équipe, les questions incessantes sur son rôle et une personnalité toujours aussi polarisante. Ceux qui le détestaient pour ce qu’il représente de malsain n’ont certainement pas changé d’avis à son sujet, et ceux qui étaient pour lui offrir une seconde chance sur les parquets ne peuvent que se réjouir de revoir ce joueur si spectaculaire. “People say I’m America’s worst nightmare. I say I’m the American dream” déclare-t-il dans sa pub pour And1. Le débat reste présent. Mais sur le terrain, il n’y a plus de doute, il est de retour à son meilleur niveau et son énergie contagieuse a nourri les rêves de la Grosse Pomme. Pour rien, pense Spree dans la déception de la défaite, lâchant un “all for nothing” qui en dit long sur les tripes qu’il a mis dans sa prestation pour éviter de voir les Spurs célébrer au Madison Square Garden.
Mais qu’il se rassure, le parcours new-yorkais, ses performances lors des Playoffs en général et ses prestations au cours des Finales en particulier, même sans titre au bout, sont bien loin de n’être “rien” aux yeux des fans des Knicks. La rédemption est actée, en attendant les futurs péchés.
Dur retour sur Terre
Alors qu’on leur promettait l’Enfer au milieu du mois d’avril, les Knicks ont finalement échoué aux portes du Paradis. Un revirement de situation historique qui leur laisse tout de même un goût d’inachevé puisqu’ils n’ont pu aller au bout de leur rêve.
Si près. Mais si loin. En arrivant jusqu’aux Finales NBA, les New York Knicks ont touché du doigt le titre alors que quelques semaines plus tôt ils n’étaient pas assurés de composter leur billet pour les Playoffs. L’étiquette de plus gros gâchis de l’histoire allait être tamponnée pour cet effectif à soixante-neuf millions de dollars la saison (le double de la moyenne de la Ligue), complètement déréglé durant la majorité de l’exercice. Jusqu’à ce changement de visage. Miracle ? Temps qui a fait son effet ? Complètement métamorphosés lors de la postseason, les Knicks ont été les premiers à aller jusqu’à la dernière marche en partant du huitième spot et cela malgré les blessures. Mais le miracle symbolisé par le game winner d’Allan Houston à Miami ou encore l’action à quatre points de Larry Johnson contre les Pacers a pris fin face à des Spurs plus complets, plus grands, en meilleur santé et surtout plus forts. Un palier trop conséquent pour une équipe diminuée et qui n’a jamais pu construire sur des certitudes fortes. Qu’en aurait-il été si la franchise n’avait pas changé autant de visage et si les vieux grognards étaient repartis ensemble pour une nouvelle et dernière danse ? Probablement plus de régularité, mais moins de folie. Et aucune assurance d’arriver au même niveau, tant les nouvelles têtes ont apporté une dynamisme différent : imaginez donc les Knicks qui cavalent en Playoffs dans le sillage de Latrell Sprewell et Marcus Camby. Une hérésie à Manhattan ! Mais les joueurs de Big Apple n’étaient plus à un paradoxe près cette saison. Jamais aussi chargé en talent durant les nineties, débarrassée de Michael Jordan, la franchise s’avançait comme un candidat déclaré avant l’ouverture du bal. L’équipe a finalement sombré entre les blessures, les méformes, le manque de plan de jeu clair et les dysfonctionnements internes, au point de passer près de la correctionnelle. Pour se réinventer donc quelques semaines avant les Playoffs et lors de la postseason. Un exercice déroutant, mais conclut comme souvent pour Patrick Ewing, sans bague au doigt, malgré les tripes mises par les siens pour aller chercher ce titre contre tous les pronostics. Aussi triste et brutale fut cette fin, elle n’a pas empêché ce groupe de rentrer dans l’histoire de la Ligue, par son parcours, son caractère comme l’évoque Jeff Van Gundy :
Je suis très déçu par le résultat pour mes joueurs parce que je leur souhaitais vraiment de réussir. Ils ont défendu, pour moi, beaucoup de choses qui devraient être enseignées en NBA et au basket. Quand ils étaient dans le dur, ils n’ont jamais pointé du doigt un responsable.
Dans une saison tronquée et dont le niveau de jeu général a été régulièrement affligeant – et pas seulement à Big Apple – l’exploit des Knicks se révèle comme l’un des rares piments pour relever un plat indigeste qui a fait du mal aux cuistots de la NBA. Mais au lieu de capitaliser sur leur parcours en Playoffs, les pensionnaires du Madison Square Garden ne parviendront pas à retrouver le chemin des Finales NBA. D’une certaine façon, cette saison marque la transition entre les Knicks contenders du passé au cauchemar du futur dont New York a toujours du mal à se relever, même si d’autres exercices assez réussis ont suivi cette épopée. Une génération qui a touché du bout des doigts la consécration pour offrir à Patrick Ewing une bague probablement méritée. Si près. Mais si loin. Si douloureusement loin.
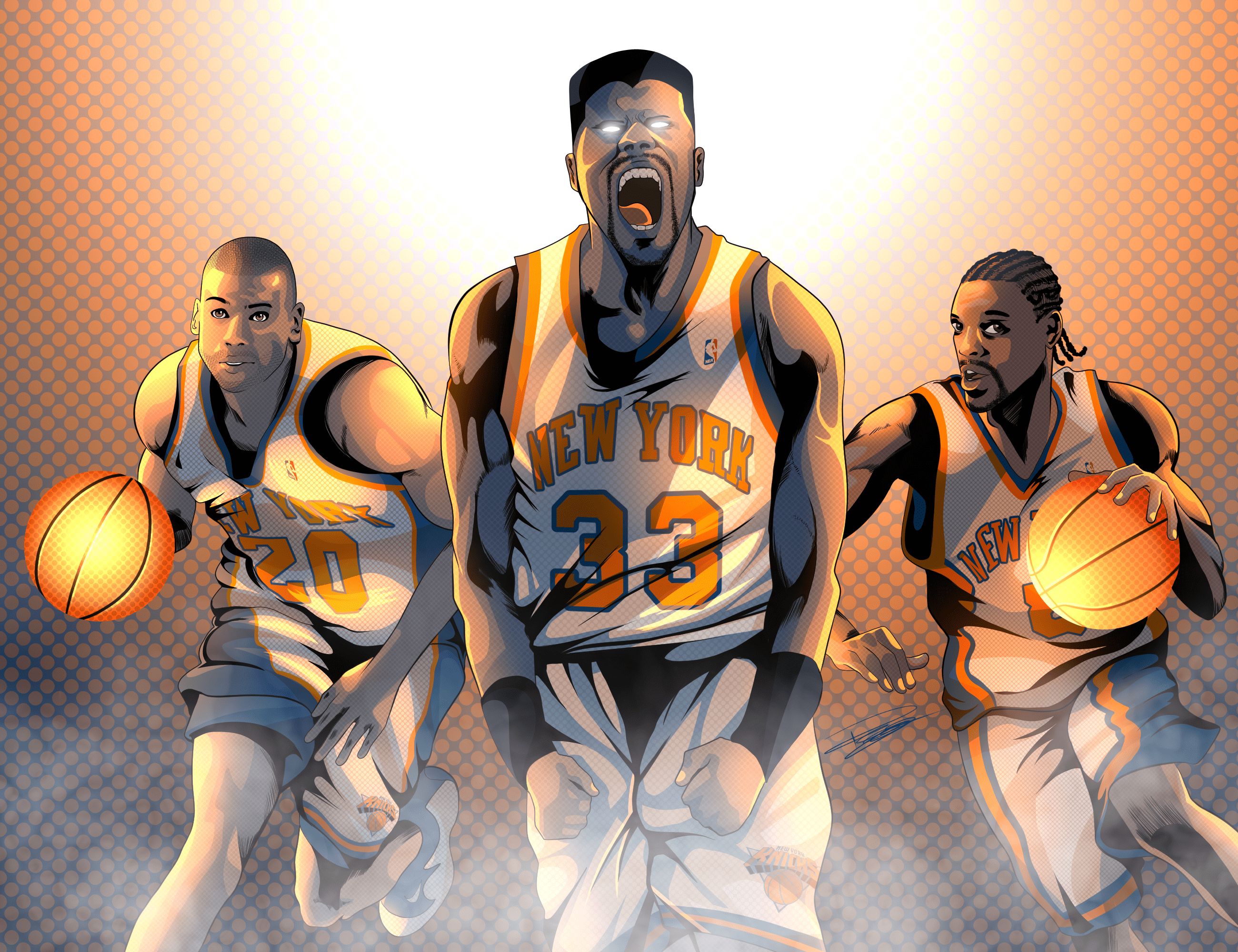
Crédits
Textes, infographies et mise en page par David Carroz
Illustrations par Tiago Danieli
Portraits par QualityBasket
Sources statistiques : 5 Majeur, ESPN et Basketball-Reference
Sources citations : Just Ballin’ par Mike Wise et Frank Isola.
Merci à la team TrashTalk pour la relecture, les coups de main et le soutien. Merci à Pred pour les matchs partagés.